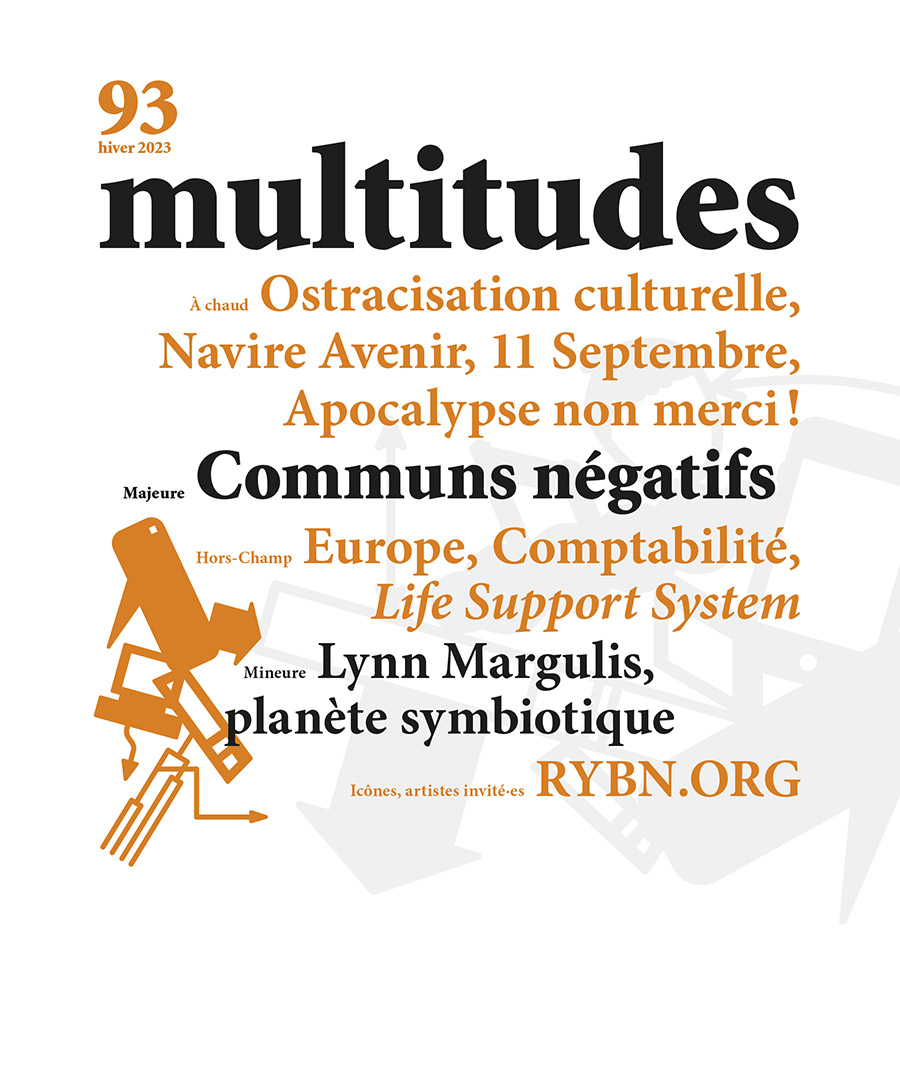Les déchets, l’ultime maillon de notre société de consommation, ce qui reste quand tout est consommé. Des déchets qui jaillissent aussi de l’intérieur des processus de production qui séparent et rejettent tout ce qui est inutile. Plus nos technologies sont sophistiquées, plus les déchets sont nombreux, polluants et quasi éternels. Le cas que je présenterai ici pour parler des conséquences de cette encombrante production est celui d’un village en amont duquel une compagnie minière a construit en 2006 un gigantesque réservoir pour entreposer les déchets générés par sa production de cuivre. J’aborderai ce cas en m’appuyant sur plusieurs concepts déployés par Alexandre Monnin1 pour repenser « le processus de ruine […] initié par la modernité » et en particulier sur sa proposition de réfléchir à une resignification des externalités négatives – ainsi définies par les économistes pour qualifier (voire compenser) les préjudices provoqués aux tiers par les activités industrielles – vers le concept de communs négatifs 2, visant à permettre une réappropriation par les victimes de ce qui peut aussi constituer, à l’instar des communs d’Ostrom3, un commun unificateur et un moteur pour des actions collectives.
Ce village se situe au Chili, premier producteur mondial de cuivre et pays figure de proue dans la région sud-américaine d’un modèle de croissance économique basé sur l’extraction intensive des ressources minières. Je partirai de l’apprentissage de ce cas pour aller vers une lecture des événements qui ont secoué le pays à partir d’octobre 2019 et fait vaciller le crédo extractiviste4 en proposant l’un des textes constitutionnels des plus avancés au monde en matière de droits de la nature. Ce faisant, la question que nous poserons est celle de savoir dans quelle mesure ce concept de communs négatifs peut permettre, aujourd’hui, de réorganiser les référents dominants.
Le poids des déchets : invisibilité, incertitude, violence
Sur le schéma de production5 de la page Web de l’une des plus grandes entreprises de cuivre du Chili, Minera Los Pelambres, du groupe Antofagasta Minerals, figure le circuit de production des minerais. D’un côté le lieu de l’extraction, la mine et l’usine de purification, et de l’autre, le port d’où sera exporté le matériel noble. On peut s’étonner que ne figure pas le réservoir de déchets miniers El Mauro, où sont entreposés tous les résidus de cette production. Cette omission me semble être à l’image du peu de visibilité donnée aux rejets du processus de production minière alors que paradoxalement on estime qu’il est nécessaire d’extraire en moyenne 500 tonnes de roches pour la production d’une seule tonne de cuivre6. Tandis que le concentré de cuivre est exporté vers les États-Unis, l’Asie et l’Europe, les déchets (magma composé de résidus de roches, de métaux lourds et de substances toxiques) restent. Ils sont acheminés vers cet immense réservoir aménagé à ciel ouvert dans l’enceinte d’une vallée, clôturée par un mur de contention de 300 mètres de haut lui-même façonné à partir de déchets solides.
Cette vallée, c’est celle du Mauro au centre-nord du Chili. Elle contient aujourd’hui plus de deux milliards de tonnes de déchets issus de l’extraction minière. Avant d’être vouée à ce sinistre destin, c’était une vallée agricole et boisée qui accumulait des réserves d’eau ; les habitants y vivaient de l’agriculture, de l’élevage, de la production de fromage et du cuir. Le réaménagement de cette vallée a provoqué la disparition de la majorité des affluents et le tarissement de la rivière du Pupio qui traversait le village de Caimanes, situé 10 km plus bas. L’assèchement des cours d’eau a engendré une modification radicale de l’économie de la vallée. Mais à l’instar de l’invisibilité des déchets, les conséquences du projet minier sont niées. La disparition de l’eau est officiellement imputée à la sécheresse. Les rapports scientifiques attestant la contamination de l’eau par les métaux lourds sont eux aussi mésestimés. Loin d’admettre la relation de causes à effets entre le méga réservoir et la diminution de la ressource et les risques quant à sa qualité, l’entreprise et les services d’État vont tenter de pallier ladite sécheresse. Des dizaines de camions citernes vont acheminer chaque jour des milliers de mètres cubes d’eau potable pour alimenter les foyers et approvisionner d’eau non potable les quelques éleveurs qui résistent. À l’incertitude quant au manque et à la dangerosité de l’eau, s’ajoute l’angoisse liée à la fragilité de l’édifice minier. Le réservoir du Mauro est l’un des plus grand du monde et il est situé sur une faille sismique. Les experts, engagés par les habitants, alertent sur la possibilité, en cas d’effondrement, du déferlement du mélange des déchets et d’eau susceptible d’ensevelir leur village en quelques minutes, tout comme cela a eu lieu au Brésil à Minas Gerais en novembre 20157. La compagnie rassure : sa technologie est infaillible. Mais peut-on la croire ? Plus récemment, un nuage toxique survole le village8. Les habitants alertent les médias. La compagnie met du temps à réagir. Acculée par les dénonciations, elle finit par avouer que des poussières toxiques proviennent bien du réservoir mais que cela ne représente aucun danger. Faut-il les croire ?
En quelques années une contrée a été bouleversée, avec elle des vies qui ont vu leurs ancrages territoriaux, leurs liens de voisinage et leurs compréhensions du monde disparaître. Au quotidien en effet, les conséquences indirectes de l’intervention minière se font ressentir : disparition des activités économiques traditionnelles remplacées par le va-et-vient d’activités de services pour les besoins de l’entreprise comprenant une majorité d’emplois précaires pour des employés souvent venus d’ailleurs, installés dans le village ou à proximité ; zizanies entre les habitants désormais divisés entre ceux qui profitent de la présence minière et ceux qui refusent de se soumettre ou encore ceux qui adoptent des stratégies changeantes ; malaise de voir leur village envahi par la présence de cette occupation ; spéculation provoquée par l’arrivée de travailleurs, etc. La destruction du tissu social, les sentiments d’angoisse, de rage et d’impuissance reviennent dans toutes les bouches comme des maux profonds apportés par la compagnie. Pourtant, paradoxalement, l’état de mal-être est toujours relativisé. Finalement, le réservoir tient toujours debout, finalement personne ne semble être mort ni de l’eau contaminée ni du nuage toxique, finalement les agriculteurs spoliés car une terre sans eau n’est plus rien, peuvent toujours s’adresser à l’entreprise qui acceptera de leur donner de l’eau via des camions citernes à condition qu’ils ne participent pas à des actions de mobilisation contre l’entreprise. Finalement les habitants de ce territoire colonisé par cette présence externe, bien qu’ils aient perdu indépendance et autonomie peuvent toujours solliciter l’entreprise pour accéder à quelques bénéfices : une bourse d’étude, une entrée au concert, le financement d’un projet… Finalement les peurs et les angoisses que ne viennent à succéder une catastrophe ou d’avoir perdu leur tranquillité sont réprimés dans le for intérieur de chacun des villageois, et en guise d’auto-dérision, on finit même par en rire. Le chercheur Rob Nixon a proposé le concept de Slow violence9 comme grille de lecture pour nommer cette souffrance diffuse, difficilement palpable qui semble secondaire en comparaison de la violence physique directe, mais qui est décrit comme un état de blessure permanent qui mine lentement les êtres en les dépossédant du sens qu’ils ont du monde et en empoisonnant les rapports humains.
Le cheminement de la résistance
Comment un tel projet, qui allait modifier si profondément le métabolisme social, s’est-il installé sur ce territoire ? Puis comment s’est structurée une résistance face à ce projet ?
En novembre 2012, lors d’un procès engagé par l’entreprise minière contre les habitants accusés d’association illicite alors qu’ils avaient engagé un cabinet d’avocats pour dénoncer les impacts du projet minier dans leur vallée, le gérant de la compagnie déclarait que le choix du lieu s’était porté sur un territoire éloigné des zones peuplées et caractérisé par une absence d’infrastructures et de services10. Ce faisant, il omettait de mentionner qu’une centaine de personnes vivaient au Mauro, à l’endroit destiné à la construction du réservoir, et qu’à seulement 10 km plus bas se trouvait le village de Caimanes, peuplé de 2000 habitants vivant de l’agriculture et de l’élevage. Ce choix de s’établir sur une vallée agricole pour entreposer des déchets miniers fut pris en fonction des moindres dommages estimés. De plus, à la faible densité et à l’éloignement des services, on pourrait ajouter un autre élément déterminant : la vulnérabilité des habitants. Les habitants de la vallée du Mauro vivaient sur des terres dont ils ne possèdent pas les titres de propriété et se décrivent comme étant « isolés de la Nation, pauvres et peu éduqués », fait qui facilitera leur expulsion en échange de compensations financières minimes pour faire place au projet minier. Des études comme celle de Ramiz Keucheyan11 et Robert Nixon12 sur les inégalités écologiques, relèvent que ce type de projet à valeur négative se situe systématiquement dans des zones pauvres.
C’est après l’expulsion des anciens habitants de la vallée du Mauro qu’une opposition va s’organiser dans la zone d’impact proche du projet. Au début des années 2000, la compagnie minière et l’État présentent le projet sous l’angle d’une mise en valeur du territoire, mais les habitants de Caimanes font appel à des experts pour étudier les risques sur les ressources en eau. Ils apprennent alors que les atteintes sur les ressources en eau seront irréversibles. Dès lors une résistance s’installe : Non, ce projet n’est pas désirable, car il risque de mettre en péril leur vallée et ses ressources. Reprenant le concept de A. Monnin, on peut dire qu’une communauté va se constituer autour de la compréhension de ce commun négatif qui va les lier et leur permettre d’organiser des actions collectives. Ces actions vont s’appuyer sur le référentiel du « droit de vivre dans un environnement sans contamination » inscrit dans la Constitution chilienne et prendre des formes pacifiques, respectueuses de l’État de droit pour tenter de faire entendre leur refus du projet. Les opposants font appel à l’État chilien qui jouit pour eux de légitimité et parce qu’ils attendent de lui un rôle d’arbitrage face à un événement ressenti comme les privant de droits. Toutefois, on peut observer qu’à l’inverse de cette demande de reconnaissance de citoyenneté et de droits, la décennie qui va suivre va se caractériser par une répétition de dénis de justice puisqu’alors que les décisions de justice vont toutes donner raison aux habitants, aucune ne sera appliquée.
Vivre avec ? Conflits, pouvoir, inclusion
Durant 20 ans, la communauté de Caimanes va être en proie à des conflits opposant des habitants au projet minier. Aux périodes de mobilisations intenses vont succéder des arrangements ponctuels sans qu’il ne semble y avoir de solution capable de résoudre les problèmes de fond. On peut même observer une répétition cyclique des formes des conflits voire leur normalisation13. Or, s’il est compréhensible qu’une communauté s’oppose à une entreprise occupant son territoire, comment de son côté, ladite entreprise conçoit-elle la poursuite de ses activités au sein d’un perpétuel conflit ?
Selon le chercheur Eduardo Gudynas, les conflits miniers ne sont pas simplement les conséquences d’impacts sur des communautés mais ils en constituent les conditions nécessaires pour le développement des projets miniers14. Gudynas considère que pour que des projets aussi violents puissent s’imposer sur des territoires, une condition première est l’installation de conflits. Sans prétendre aller complètement dans ce sens, l’observation du cas de Caimanes montre comment le conflit peut servir l’entreprise. On constate par exemple que le sujet des conflits est abordé sous le chapitre « gestion communautaire » et que sont présentés différents mécanismes de compensation dans le but de garantir « de bonnes relations avec la communauté », ce qui se trouve être une façon détournée d’évoquer le conflit. On peut en déduire que les conflits deviennent des sujets normalisés de gestion, au côté des processus techniques d’extraction et qu’en définitive, ils deviennent des lieux de création d’un type de rapport direct entreprise/habitants pour les besoins des localités situées sur le territoire impacté, ce qui va servir à renforcer la présence de la compagnie.
Un exemple quasi caricatural des conséquences de ce type de rapport direct entreprise/territoire visant à utiliser les conflits comme monnaie d’échange s’est déroulé en 2015 alors que la compagnie minière avait perdu un procès de taille contre la communauté et qu’elle avait été condamnée à « restituer le cours naturel et non contaminé de l’eau. […] Dans le cas contraire ordre avait été donné à l’entreprise de démolir la méga infrastructure minière. » En cette année 2015, le contexte national est critique. Des centaines de conflits explosent un peu partout au Chili, directement liés à des mégaprojets extractivistes affectant les ressources en eau (INDH)15. Pourtant, dans le même temps, il fait consensus au sein du gouvernement et d’une grande partie de la société chilienne que la croissance du pays repose sur l’extraction minière et que les impacts sur l’eau sont malheureusement inévitables. Au sein de cette crise, le consortium minier cherche à freiner ce qu’il dénonce comme une tendance à la judiciarisation des conflits menaçant la croissance chilienne. C’est ainsi que naît l’organisation Valor Minero, dans le but de coordonner les efforts publics-privés pour mettre au point des stratégies pour résoudre à l’amiable les conflits miniers. Cette concertation d’acteurs réunissant lobbies miniers et des ministres du gouvernement chilien (mais pas la société civile ni les affectés) va suivre un corpus méthodologique axé sur des stratégies managériales basées sur le dialogue et la démarche participative pour rétablir la confiance des communautés affectées. Ce corpus nommé Mines vertes, vertueuses et inclusives va être appliqué dans la région du Choapa et notamment à Caimanes, autorisant l’entreprise minière à organiser librement elle-même la gestion de résolution de son conflit.
Mobilisés depuis 75 jours pour demander l’exécution de la décision de justice qui devait leur restituer l’eau, les habitants de Caimanes se voient ainsi proposer de participer à un processus de dialogue avec l’entreprise afin de trouver ensemble des solutions pour que la décision de justice s’applique au plus vite. Des tables de discussion s’installent dans ledit « processus d’entente et de conciliation » supervisé par l’ONG Chile Transparente (Transparency International). L’utilisation de techniques visant à transformer le mode de relation de victimes en partner rappelle les stratégies décryptées par Sezin Topcu sous le concept de gouvernement de la critique16. Il s’agit d’associer les habitants, de leur donner des rôles dans le projet minier à condition qu’ils s’y intègrent. Des expéditions sont organisées pour visiter les installations minières, assister à des analyses de conductivité de l’eau, vérifier la sécurité des infrastructures. Pour la première fois les habitants ont l’impression d’être écoutés, consultés. Un des épisodes de ce processus d’entente et de conciliation met en scène un véritable scénario catastrophe pour réfléchir ensemble avec les responsables de la compagnie aux voies de secours si les déchets déferlaient dans la communauté. Cette manière de préfigurer une potentialité de la mort vise-t-elle à préparer ensemble le désastre ?
En réalité, les limites éthiques de cette stratégie de l’inclusion sont mises à nu dès lors que les solutions proposées par la communauté sont systématiquement rejetées17 et que les membres critiquant les termes des « accords » sont brutalement exclus. En revanche, pour l’entreprise, l’accord de conciliation obtenu la libère des décisions de justice. Il aura permis à la compagnie de neutraliser les opposants et de renverser les victoires juridiques obtenues par la communauté18.
L’enjeu de la reconnaissance
Les méandres de l’histoire de Caimanes illustrent combien il aura été difficile pour une communauté bouleversée par un projet minier de faire entendre sa voix et qu’il n’aura même pas été suffisant de gagner en justice. Au front d’habitants unis dans la dénonciation par ce commun négatif, s’est imposé un pouvoir dans un rapport de force par trop inégal qui a fait fi du référent justice et semble avoir réussi le tour de force d’absorber les critiques sous l’aune de l’acceptation et de la résilience19. Le triste nom donné par Valor Minero au réservoir de déchets miniers inclusif semble marquer l’échec du droit comme référent d’arbitrage et le recours à sa place à une conciliation forcée des victimes dans un récit ordonnateur intransigeant. Loin d’avoir contribué à un équilibre de partage d’espace et de vision du territoire comme le laissait croire le terme de dialogue, l’inclusion des victimes, comme l’achat des conflits ont permis le renforcement de la présence minière. De nombreux chercheurs font état de la destructuration et des déséquilibres de régions tout entières, provoquées par leur subordination à cette logique extractiviste. Alberto Acosta observe une déterritorialisation 20 lorsque les entreprises se substituent à l’État jusque dans ses fonctions régaliennes et que l’économie repose sur un système basé sur la création d’enclaves et de circuits déconnectés des besoins des territoires. Eduardo Gudynas parle de géographies fracturées 21 comme conséquence de ce modus operandi d’ordre colonial. Rob Nixon évoque la disparition des paysages vernaculaires 22, lorsque la vocation des ressources naturelles est externalisée et cesse de participer à la dynamique socio-environnementale du territoire.
La difficulté semble être celle de construire des référents puissants pour faire entendre les voix des laissés pour compte de ce type de méga projets et comprendre l’ampleur irréversible des destructurations. Cependant, si l’échec de l’aboutissement de la quête de Caimanes en fonction d’un appel au droit peut être interprété comme l’absence d’un référent propre, voire une carence de politisation, entendue comme élaboration d’un énoncé au-delà de la défense territoriale, c’est en revanche ce nouveau référent qui a été à l’œuvre dans l’expérience d’écriture de la nouvelle Constitution cinq années plus tard. Au Chili, l’historique crédo dans l’épistémé extractiviste résidait dans la perception par les populations d’être inclus et de pouvoir ainsi participer à la grandeur d’un pays. Or il apparaît que ce récit qui soutenait aussi le traditionnel respect chilien de l’institutionalité s’est trouvé fortement ébranlé dès lors qu’un peu partout sur le territoire surgissaient des autodénommées « zones de sacrifice » et que des habitants découvraient brutalement n’être que « des citoyens de seconde classe ». Dès lors que depuis des décennies, le mode de gouvernance avait offert des pans entiers de territoire à des multinationales pour des projets extractivistes, c’est soudain à la manière d’un boomerang que l’ampleur des destructions engendre en retour une remise en question du mythe du miracle chilien et va alimenter le contenu d’un nouveau projet constitutionnel. On avait l’expérience de ce qui avait été détruit. Il ne restait plus qu’à l’écrire et à réorganiser différemment. L’eau : privatisée, séparée de la terre, monopolisée ; la vocation des territoires : malmenés, pillés, vampirisés ; les habitants : reniés, maltraités, déplacés, amputés de leur liens territoriaux et politiques étaient désormais placés au cœur des débats pour l’écriture du nouveau texte réorganisateur 23.
À la recherche de nouveaux référents
Le « réveil chilien », nom donné au mouvement social d’octobre 2019 au Chili parce qu’il a représenté une secousse ébranlant le statu quo jusqu’alors opérant, a ainsi eu pour effet de faire émerger de nouveaux possibles là où tout semblait verrouillé 24. Cet élan collectif massif a permis de créer de nouveaux rapports de force dans lequel des populations jusque-là marginalisées (peuples indigènes, femmes, mouvements politiques non affiliés à des partis) ont pris place pour proposer de nouveaux référents au pays. C’est ainsi tout d’abord sous le sceau de la rupture que ce chemin a pu se construire : rupture avec un imaginaire qui fut celui de la construction nationale héritée du colonialisme qui avait déjà révélé sa nature excluante et s’opposait à l’imaginaire populaire (Dario Montero, 2016)25. Rupture qui a permis un affranchissement pour penser autrement. Et parmi les acteurs moteurs de la dynamique du mouvement social chilien, le mouvement féministe propose de rompre avec la logique patriarcale entendue de manière globale comme une logique de domination sur le vivant, illustrée par exemple par la dénonciation de la violence patriarcale de l’extractivisme26 sur la terre nourricière. Une pensée redéfinie comme écoféministe qui affirme une volonté d’établir un autre type de rapport avec la nature. Et là où il est question de reconsidérer les relations avec la terre, l’eau et les éléments naturels, prend aussi toute sa place la pensée inspirée des peuples indigènes, jusqu’alors exclus du grand récit national chilien. La Convention constituante chargée d’écrire la nouvelle Constitution est en effet intégrée par des représentants des peuples indigènes et placée sous la présidence d’Elisa Loncon, académicienne mapuche. Les débats animant l’écriture du texte ont montré une volonté de renouer avec une conscience territoriale communautaire amplifiée aussi du rapport avec les éléments non humains, permettant ainsi par exemple d’appréhender sous formes de relations réciproques la dynamique des écosystèmes et leur circularité. Cette pensée aura permis la proposition de nouvelles règles et nouveaux droits comme celui du droit de la nature qui fera partie du texte final de la Constitution. Par ailleurs, ces nouveaux repères s’accompagnaient aussi d’une nouvelle exigence de démocratie entre les territoires, les besoins de productions pour un rééquilibrage non plus inféodé aux seuls besoins de production pour la croissance mais engageant une véritable prise en compte des acteurs locaux et du devenir des environnements.
Pourtant, contre toute attente, ce projet de Constitution a été rejeté par un référendum en septembre 2022. À l’heure où j’écris ces lignes, un autre projet, élaboré par une commission d’experts et dont l’esprit se trouve être très différent du précédent va être soumis à un nouveau référendum dans les semaines à venir. L’échec du projet d’aboutissement d’une Constitution basée sur une prise en compte des Communs ne doit pourtant pas amoindrir l’esprit qui l’a animé, né d’une vision d’un changement de paradigme vécu comme nécessaire. Il va sans dire que les bouleversements qu’aurait signifiés une mise en pratique de ces nouvelles règles axées sur une reconquête des communs auraient pu profondément modifier l’échiquier chilien et que les avancées de ce texte ont été ressenties par les secteurs dominants comme un risque pour la logique productiviste à l’œuvre basée sur les coûts et l’efficacité.
Ce qui reste néanmoins, c’est l’élan collectif qui a poussé à la création d’un récit commun, à partir de nouveaux référents donnant place à plus de démocratie locale, à de nouveaux modes de relation avec les « ressources naturelles » renommées « Biens communs naturels », reconsidérant les territoires comme des ensembles vivants organiques. Et ainsi donnant lieu à l’un des textes constitutionnels des plus avancés et ouverts en matière de droit de la nature et de démocratie. S’il a vu le jour c’est parce qu’une « communauté » a surgi pour tenter de construire à partir de la reconnaissance de ce commun négatif et que ce sujet collectif muni de ces référents politiques a réussi à acquérir une légitimité sociale importante et à peser fortement dans le rapport de force. À suivre…
1Emmanuel Bonnet, Diego Landivar & Alexandre Monnin, Héritage et fermeture, Éditions divergences, Paris 2011, p. 22.
2Op. cit., p. 29.
3Elinor Ostrom, La gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles, De Boeck, 2010, et Bonnet, Landivar, Monnin, op. cit., p. 24.
4Eduardo Gudynas, Las narrativas que construyen un sentido comun extractivista, in Pensamiento critco Latinoamericano p. 110-130 – São Paulo 2019.
5Elif Karakartal Le réservoir de déchet minier de Camaines, chronique d’un territoire sacrifié, Une Seule Planète, Paris, 2018 https://uneseuleplanete.org/Mecanisme-d-implantation-du-projet-sur-le-territoire
6Source de l’économiste Alfredo Gudynas, citée in Bednik, Anna Bednik, Extractivisme. Exploitation industrielle de la nature : logique, conséquences, résistances, Le passager clandestin, Paris 2016. p. 36.
7https://uneseuleplanete.org/Mise-en-danger-de-la-vallee
8www.franceameriquelatine.org/chili-caimanes-injustice-poussiere-mega-mines-elif-karakartal-nuestra-republica-fal-33
9Rob Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor, Cambridge, Harvard University Press, 2011.
10https://uneseuleplanete.org/Le-reservoir-de-dechets-miniers
11Razmig Keucheyan, la nature est un champ de bataille, Paris, La Découverte, 2014.
12Rob Nixon – 2011, op. cit.
13https://uneseuleplanete.org/La-Justice
14Eduardo Gudynas, Extracciones, extractivismo y extrahecciones, un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales, in Observatorio del desarrollo, 2013.
15Instituto Nacional Derechos Humanos, mapa de conflictos ambientales en Chile, https://mapaconflictos.indh.cl
16Il s’agissait dans ce cas de méthodes mises en place pour favoriser l’acceptation du nucléaire, Sezin Topcu, la France nucléaire : l’art de gouverner une technologie contestée, Seuil, Paris 2013.
17Caimanes / Minera Los Pelambres: Discusión estéril, www.youtube.com/watch?v=VLVLf_FeQEI
18emol.com/noticias/Economia/2016/08/08/816376/Corte-de-Apelaciones-deLa-Serena-revoca-orden-de-demolicion-del-tranque-de-relaves-El-Mauro.html, voir aussi https://web.pelambres.cl/nuestros-compromisos/nuestro-compromiso-con-las-comunidades/acuerdo-caimanes
19Bonnet, Landivar & Monnin, op. cit.
20Alberto Acosta El extractivismo como categoría de saqueo y de devastacion, in Negotiating nature : imaginaries, interventions and resistance. p. 25-33, Forum for inter-american research, Bielefeld University 2019.
21Eduardo Gudynas, Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas Revista del Sur no 160 | Abril / Junio 2005.
22Rob Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor, Cambridge, Harvard University Press 2011.
23Cecile Falies, Audrey Sérandour, Chloé Nocolas-Artero, Solène Rey-Coquais, Au Chili, changer la Constitution pour repenser l’accès aux ressources ? Article paru dans The Conversation, déc 2019 https://theconversation.com/au-chili-changer-la-constitution-pour-repenser-lacces-aux-ressources
24Elif Karakartal, Caimanes. Rompre l’inacceptable, un chemin encore difficile à se frayer au Chili, 2016, France libertés https://fondationdaniellemitterrand.org/caimanes-rompre-linacceptable-un-chemin-encore-difficile-a-se-frayer-au-chili
25Le chercheur relevait déjà en 2016 cette « crise de légitimité » et ce conflit entre « un imaginaire libéral-individualiste teinté d’éléments autoritaires hérités de la période coloniale (entre en conflit) avec un imaginaire populaire démocratique […] qui affirme la valeur de la communauté et de la participation citoyenne au niveau local ». Dario Montero « La culture démocratique chilienne : des origines à la crise de légitimité contemporaine » in Problèmes d’Amérique Latine no 102, p. 35 à 52, 20016/3.
26Cette pensée du patriarcat associé à la l’extractivisme se retrouve sur tout le continent latinoaméricain et a été développée au Chili par des chercheurs comme Francisca Fernandez Drogett, membre du MAT (movimiento Agua y territorio). Cf. « Extractivisme et patriarcat : défense des territoires et des corps », in Violence des Genres et résistance, ouvrage collectif direction Aurélie Leroy, Édition Syllepse, 2021.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)