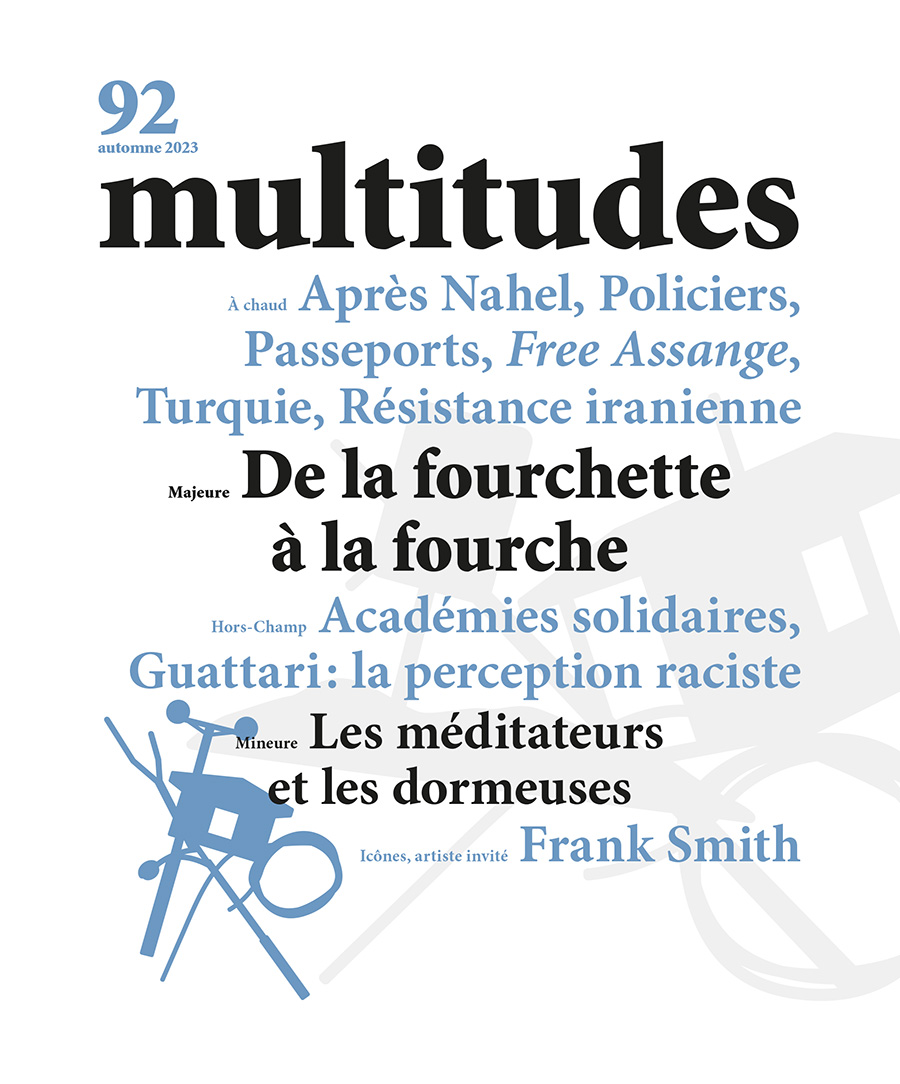Depuis quelques décennies, les activités d’élevage sont mises en cause en raison de leurs effets sur l’environnement naturel et social. Selon la plus ancienne de ces critiques, le développement des activités d’élevage rendrait difficile de nourrir l’ensemble de la population humaine. L’argument était déjà avancé par René Dumont dans les années 1960, avant même qu’il ne soit devenu écologiste : puisqu’il faut en moyenne 7 à 9 kilocalories (Kcal) végétales pour obtenir 1 Kcal animale, consommer des animaux (et des produits animaux) diminue la quantité de calories disponibles pour les humains. Si l’on prolonge les tendances actuelles (une consommation trop élevée dans les pays industrialisés et qui augmente fortement dans les pays émergents), on va se trouver dans la situation de ne plus pouvoir produire une quantité de nourriture suffisante pour l’humanité, une part croissante des superficies cultivées étant consacrée à nourrir bovins, porcs et volailles. Si l’on ajoute à ce manque de disponibilités globales en calories végétales le constat que les superficies agricoles tendent à diminuer du fait de l’urbanisation et de l’érosion, cela va rendre plus difficile de nourrir l’humanité.
Une précision s’impose sur le sens des termes employés : il sera ici question d’agriculture et d’élevage productivistes. « Productiviste » signifie « dont l’objectif est d’augmenter la productivité… du capital et du travail ». C’est une qualification descriptive, elle correspond bien à ce qui a été fortement suggéré aux agriculteurs dès le lendemain de la Seconde Guerre Mondiale : une ardente obligation de moderniser l’agriculture par l’augmentation des rendements à l’hectare, des performances du cheptel et de la productivité du travail. Comme l’expression d’« agriculture intensive », celle « d’élevage intensif » s’avère être trop imprécise pour être employée. Une agriculture que les organisations professionnelles qualifient volontiers d’« intensive » emploie intensivement des facteurs de production fournis par l’industrie : en ce sens l’agriculture et l’élevage productiviste sont intensifs en capital1. Les systèmes de polyculture-élevage et l’élevage traditionnel pouvaient être considérés comme relevant d’une démarche « intensive en travail ». Enfin certains auteurs comme Michel Griffon parlent d’agriculture « écologiquement intensive2 » pour désigner la mobilisation de processus naturels de l’agro-écologie. Quand il est question d’agriculture « intensive » ou d’élevage « intensif » il faudrait donc préciser « en capital » « en travail » ou en « mobilisation de processus naturels ».
L’élevage représente-t-il un handicap pour nourrir le monde ?
Une remarque préliminaire. Amartya Sen et Jean Drèze3 ont montré que si 800 millions de pauvres souffraient encore de faim à la fin du XXe siècle, ce n’était pas dû à la quantité d’aliments disponibles – largement suffisante et même au-delà – mais à une distribution très inégalitaire des ressources et à un gaspillage considérable de la part des consommateurs riches. Nourrir le monde supposerait d’abord de lutter contre les inégalités sociales avant de chercher à développer une production déjà excédentaire.
Ensuite, il est à souligner que la moyenne de 7 à 9 Kcal pour produire 1 Kcal de production animale ne signifie pas grand chose. Il faut ainsi 4 Kcal végétales pour produire 1 Kcal de porc ou de volaille en élevage industriel, 11 Kcal végétales pour produire 1 Kcal de mouton ou de bœuf en élevage productiviste, 25 Kcal végétales pour obtenir 1 Kcal de mouton ou de bœuf en élevage extensif. Cela pourrait conduire à penser qu’il vaut mieux consommer des porcs et volailles des élevages industriels plutôt que des animaux (et des produits animaux) issus d’élevages moins productifs ou extensifs. Mais ce serait oublier que, sur les 11 Kcal végétales nécessaires pour obtenir 1 Kcal de bœuf ou de mouton en élevage productiviste et, a fortiori dans les 25 Kcal nécessaires en élevage extensif, il y a une proportion non négligeable d’herbe… et que les humains ne mangent pas d’herbe.
L’argumentation mérite en outre d’être nuancée. Rappelons qu’il y a de vastes régions où ne peuvent pousser que de l’herbe, des ligneux bas ou des peuplements forestiers. En France, ce sont les hautes terres du Massif Central, des Alpes, du Jura et des Pyrénées (disons, au delà de 800 à 900 mètres d’altitude), mais aussi certaines zones humides où, à défaut d’opérations de drainage (coûteuses et dommageables pour la diversité biologique), on ne saurait pas cultiver. Ces régions (qui couvrent une proportion non négligeable de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord et s’étendent au Sahel) ne peuvent contribuer à l’approvisionnement de l’humanité que par l’élevage. Abandonner l’élevage priverait l’approvisionnement des populations locales – mais aussi de l’ensemble de l’humanité – en calories et protéines qui, sans élevage, seraient perdues. Il y a donc des régions où l’élevage se maintiendra nécessairement.
Enfin, remarquons que si l’élevage productiviste concurrence la production vivrière, l’élevage peut contribuer à maintenir la fertilité des sols sans avoir besoin d’épandre de fortes quantités d’engrais. Michel Griffon plaide ainsi dans son ouvrage Nourrir la planète en faveur d’une « révolution doublement verte4 » et d’un scénario de développement agricole à la portée des paysans les plus pauvres et fondé sur l’« écologie et l’équité ».
Se déprendre de l’agriculture productiviste
Il s’agit en fait de se déprendre des formes d’agriculture productiviste des pays industrialisés et de celles qui sont issues de la « révolution verte » qui s’est imposée dans les pays chauds et de les remplacer par des formes d’agro-écologie5. L’agriculture productiviste des pays industrialisés (comme la « révolution verte » dans les pays chauds) a remplacé les fonctionnalités naturelles que savaient utiliser les agricultures traditionnelles, par l’utilisation massive de produits d’origine industrielle. Les engrais se sont substitués au fumier et aux mécanismes naturels de reproduction de la fertilité, au prix d’une diminution de la matière organique du sol et donc de ses capacités de rétention de l’eau. Pour permettre aux semences hautement productives sélectionnées en champs expérimentaux de manifester toutes leurs potentialités, il a fallu modifier l’environnement. Bien souvent, il a donc fallu irriguer pour réaliser les rendements espérés, et systématiquement épandre généreusement des engrais, mais aussi des herbicides et pesticides pour protéger les cultures des adventices et des ravageurs. Avec cette conception de l’agronomie, la nature n’est plus ce dont on apprend à se servir, ce que l’on cherche à manipuler, à piloter, pour se procurer des denrées. Elle, est à l’inverse, perçue comme une menace parce qu’elle est à la source de perturbations que l’on va s’employer à contrer. Il faut alors maintenir la nature à distance.
Certes, les formes d’agriculture productiviste ont rendu les services que l’on attendait d’elles. Elles ont largement contribué à assurer l’alimentation d’une population humaine en forte croissance au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Mais il est devenu de plus en plus évident qu’elles ont eu des conséquences tant sociales qu’environnementales assez désastreuses. Les pays qui ont développé ces formes de production inondent le reste du monde de leurs surplus à bon marché. S’ensuivent l’absence de possibilité de développer des marchés nationaux dans les pays déficitaires, la destruction de leur paysannerie, l’encombrement de leurs bidonvilles et autres favelas par les paysans ruinés. Exigeant des investissements (mécanisation, irrigation, bâtiments) et des achats (semences sélectionnées, engrais, insecticides, herbicides et fongicides) la révolution verte s’est ainsi traduite par la paupérisation de ceux qui n’ont pas eu les moyens de l’adopter – ou qui n’ont pas pu suivre. Ces formes d’agriculture ont, en outre, de très mauvais rendements énergétiques et leurs exportations en direction des pays déficitaires (mais aussi entre pays exportateurs) supposent des transports lourds et volumineux, si bien que l’on ne saurait poursuivre dans cette voie si l’on veut effectivement diminuer les émissions de gaz à effets de serre. Il s’agit enfin de formes de production très polluantes, ayant des effets dommageables sur les capacités productives des sols (érosion, salinisation, perte de matière organique) et la diversité biologique. On assiste ainsi dans les pays européens et en Amérique du Nord à un effondrement des populations d’insectes6 avec pour conséquence une forte diminution des effectifs d’oiseaux des champs. Ainsi, de 1989 à 2018, les effectifs d’oiseaux communs des champs ont diminué de 38 % en France. De même a-t-on à déplorer une forte dépression des populations de chauves-souris : de 2006 à 2016 leur effectif aurait diminué de 46 % dans les campagnes françaises.
La démarche agro-écologique
associe élevage et cultures
À l’inverse, l’agro-écologie consiste à agir avec la nature et non contre elle, à prendre la nature comme partenaire. Il s’agit de promouvoir des formes de pilotage des processus naturels, ce qui suppose d’étudier les fonctionnements des agrosystèmes en n’oubliant jamais qu’ils s’insèrent dans un complexe d’écosystèmes (le paysage dont ils font partie) avec lesquels ils entretiennent un ensemble d’interactions.
Considérer toute parcelle cultivée comme un écosystème complexe suppose ainsi de ne plus considérer le sol comme un simple support que l’on travaille pour faciliter l’enracinement des plantes et que l’on enrichit d’engrais pour « forcer » leur alimentation. Dans la conception agronomique qui a guidé le modèle productiviste, la vie du sol, avec sa faune, sa flore et sa mycoflore détritivores, avec ses bactéries qui minéralisent la matière organique et qui, pour certaines, fixent l’azote atmosphérique… bref, le sol, en tant que système écologique avec ses interactions complexes, est une boîte noire. Il s’agit donc d’ouvrir la boîte noire, et de comprendre, pour en tirer parti, les mécanismes biologiques qui président à la reproduction de la fertilité, ainsi que ceux qui contribuent à maintenir une structure et un taux de matière organique favorables à l’enracinement des cultures et à la rétention de l’eau.
La démarche agro-écologique suppose enfin d’associer l’élevage aux cultures et d’introduire dans l’assolement des légumineuses (cultures fourragères ou lentilles et haricots) qui fixent l’azote atmosphérique. Comme cela fut le cas des systèmes de polyculture-élevage, les rotations complexes des cultures sur la même parcelle doivent alors permettre de briser les cycles de reproduction des espèces qui concurrencent les récoltes et de celles qui les ravagent. On parviendrait ainsi à maîtriser les « mauvaises herbes », les parasites et les ravageurs avec une utilisation minimale, voire nulle, de produits phytosanitaires. Un pilotage fin des flux d’éléments fertilisants et des rotations culturales devrait limiter l’impact de l’agriculture sur la flore et la faune sauvage. N’exigeant pas l’acquisition massive de moyens de production fournis par l’industrie, ces formes d’agro-écologie sont en outre à la portée des paysans qui n’ont pas eu les moyens d’adopter les formes d’agriculture productiviste ou la révolution verte.
S’inspirer des fonctionnalités naturelles et en tirer parti devrait ainsi permettre de substituer à l’agronomie qui s’est imposée au siècle précédent une agronomie qui soit capable d’aider à mieux habiter la nature et à en utiliser les ressources et les services sans la détruire. Mais cela conduira nécessairement à une grande diversité de systèmes adaptés à la diversité des environnements naturels et humains. Il ne saurait y avoir un « modèle » ou un petit nombre de modèles d’agro-écologie. L’agro-écologie est un ensemble de principes d’action à appliquer avec créativité dans un milieu donné selon les capacités de travail, les savoirs et les besoins économiques des paysans.
Nourrir l’humanité nécessitera sans doute une diminution de la consommation de viande et de produits laitiers dans les pays riches, mais l’élevage conservera sa place dans certaines régions dans un scénario de transition du productivisme à l’agro-écologie – il ne s’agira plus alors d’élevages productivistes en grandes unités de production.
L’élevage contribue-t-il à l’érosion de la biodiversité ?
Il convient d’abord de prendre conscience que la biomasse totale des humains et de leurs animaux domestiques excède largement celle de l’ensemble des vertébrés sauvages. Celle des humains est 8,6 fois supérieure à celle des mammifères sauvages, et celle du bétail l’est 14 fois plus7. On a calculé qu’à tout moment de l’année, la biomasse totale de la volaille (principalement des poulets de chair) est trois fois plus importante que celle de l’ensemble des espèces d’oiseaux sauvages8. Le poids des humains et des animaux domestiques qu’ils élèvent est tel qu’ils exploitent l’essentiel des ressources disponibles. Les mammifères et les oiseaux sauvages n’en utilisent que ce qui reste. En outre, les activités d’élevage ont des impacts négatifs, à différentes échelles spatiales, sur les effectifs et la diversité des espèces.
Les activités d’élevage consomment des quantités croissantes de maïs et de tourteau de soja. L’extension de la culture du soja (dont l’essentiel est composé de soja transgénique) en Amérique du Sud a des conséquences écologiques (mais aussi sociales et culturelles) dommageables9. Les conditions politiques et sociales qui le promeuvent, étendent sa culture au détriment de cultures vivrières qui pourraient améliorer l’alimentation des habitants du sous-continent, et plus encore, au détriment de la forêt amazonienne et des Amérindiens. Le soja est ainsi à l’origine d’une injustice sociale et d’une catastrophe écologique. Le défrichement de la forêt équatoriale conduit à la disparition de nombreuses espèces endémiques. Mais ce n’est pas l’élevage en tant que tel qui est en cause : c’est le modèle technique de l’agriculture productiviste dans son ensemble.
Si l’on se préoccupe maintenant des pollutions du sol, des nappes phréatiques et des cours d’eau ainsi que des nuisances olfactives du voisinage, on ne peut qu’en accuser le développement des élevages et de l’agriculture productivistes. Partout où il s’est imposé et où les élevages industrialisés hors-sol sont nombreux et concentrés ces milieux sont particulièrement dégradés. La pollution des cours d’eau par les lisiers, les engrais, les herbicides et les pesticides nuit aux populations de poissons et d’autres organismes aquatiques. Elle s’étend aux estuaires et aux plages et sont à l’origine de pullulations d’algues vertes en Bretagne, qui nuisent à la faune et sont à l’origine de fermentations exhalant des gaz toxiques.
Enfin, au delà des estuaires et des plages, la pollution fécale importante des élevages industriels par diffusion de nutriments azotés et phosphorés affecte les eaux continentales et des zones océaniques de plus en plus étendues. D’où le développement de zones hypoxiques, biologiquement mortes où la concentration d’oxygène dissous est insuffisante pour permettre à la majorité des plantes et des animaux aquatiques de survivre. On retrouve de ces zones hypoxiques en Mer Baltique, dans la Mer Noire, en Mer du Japon, en Mer de Chine et en Méditerranée ; celle du golfe du Mexique n’atteignait que 100 km2 dans les années 1990, mais couvrait déjà plus de 22 000 km2 en 2017 !
L’élevage nuit-il à la santé ?
L’élevage a toujours été source de zoonoses passant des animaux aux humains et vice-versa. Dans les pays qui pratiquaient l’élevage depuis le début de l’Holocène, les populations avaient acquis des défenses immunitaires. Lorsque les Européens colonisèrent le Nouveau Monde, ils diffusèrent parmi les populations amérindiennes qui ne pratiquaient pas l’élevage des germes pathogènes contre lesquels elles n’étaient pas immunisées. Les Amérindiens se sont révélés particulièrement vulnérables à ces zoonoses que connaissaient bien les Européens : la tuberculose et la variole ou des maladies aussi banales chez nous que la grippe. Ce fut d’autant plus fatal aux populations amérindiennes qui les contractaient que les pratiques thérapeutiques qu’elles maîtrisaient étaient sans effet sur ces maladies inédites. L’échange colombien conduisit à une véritable hécatombe – comme on n’en a jamais connu en Eurasie, même au cours de la grande peste médiévale. Le même effondrement démographique se retrouve en Amérique du Sud (principalement en Amazonie). Ce que les Américains qualifient de wilderness, ce ne sont pas des forêts vierges ou primitives, mais des espaces jadis utilisés par les Amérindiens et qui se sont reboisés en raison de l’effondrement de ces populations autochtones10.
L’élevage industriel, une aubaine
pour les maladies infectieuses
et l’antibiorésistance
De nos jours, les élevages industriels, rassemblant d’importants effectifs d’animaux ayant une faible diversité génétique, sont une « aubaine » pour les maladies infectieuses (grippes aviaires et porcines, listérioses, salmonelloses, infections à Escherichia coli, à streptocoques, etc.11). C’est ainsi qu’un rapport de l’OMS, de l’OIE (Organisation internationale des épizooties) et de l’USDA (Département américain de l’agriculture) de 200512 conclut : « En termes simples, en raison de la révolution de l’élevage, les risques mondiaux de maladies augmentent ». Ainsi la grippe H1N1 est issue d’un élevage industriel de porc en Caroline du Nord. Elle s’est répandue très vite du sud des États-Unis au Mexique, puis au monde entier jusqu’à ce que l’OMS déclare en juin 2009 l’état de pandémie.
Il est enfin important d’insister sur la progression de l’antibiorésistance. Depuis quelques décennies, l’antibiorésistance des bactéries n’a cessé de progresser, si bien que, selon le rapport Carlet13, il s’agit d’un grave problème de santé. Or, l’innovation antibactérienne n’est pas rentable, son retour sur investissement est très faible et les industries pharmaceutiques ne s’y intéressent plus guère. Alors que l’antibiorésistance progresse, pas une nouvelle molécule d’antibiotique n’a été découverte depuis 20 ans ! Selon l’ANSES14, « L’antibiorésistance est un problème majeur en termes de santé humaine et animale au niveau international15 ». À partir des années 1940, un développement considérable de l’usage des antibiotiques en médecine humaine a favorisé l’émergence et la diffusion de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques qui remettent en question l’efficacité des traitements.
Mais l’élevage n’est pas en reste dans cette banalisation de l’usage des antibiotiques et dans la sélection consécutive de souches résistantes. Dès les années 1950, l’utilisation des antibiotiques s’est fortement développée en élevage. Elle le fut d’abord pour des usages curatifs. Mais avec le développement des élevages industriels susceptibles d’héberger une liste impressionnante d’infections diverses, des antibiotiques ont été généreusement distribués à titre préventif. Enfin, un effet secondaire favorisant la croissance ayant été découvert en 1946, des antibiotiques ont été largement distribués, mélangés aux aliments composés du bétail pour augmenter leur productivité16.
Par le truchement des effluents issus des hôpitaux, des particuliers traités aux antibiotiques et des élevages qui en sont abreuvés, les bactéries résistantes passent dans le sol et les eaux où leurs gènes de résistance se transmettent à d’autres bactéries, et ainsi de suite. C’est pourquoi l’Union européenne a interdit en 2006 l’usage des antibiotiques en élevage à des fins productives. Néanmoins, la directive européenne est encore inégalement appliquée en Europe : l’élevage de certains pays consomme encore de grandes quantités d’antibiotiques (Italie, Espagne, Allemagne). Pire, l’Europe est bien seule à entamer cet effort : la Chine, le Brésil, l’Inde, le Mexique utilisent encore largement les antibiotiques pour des usages zootechniques… et les États-Unis bien sûr, où l’élevage porcin consomme à lui seul plus d’antibiotiques que l’ensemble de la population humaine du pays. Les aliments du bétail avec complément antibiotique sont enfin largement distribués de par le monde, y compris aux petits élevages.
En raison de leurs conséquences sur la biodiversité, il serait souhaitable que les élevages industriels hors sol disparaissent et que se développent les élevages familiaux associés aux formes d’agro-écologie, en lieu et place des formes d’agricultures et d’élevages productivistes. La viande et les produits animaux coûteraient plus cher, les consommateurs en mangeraient moins : cela préserverait les forêts équatoriales et laisserait des superficies consacrées aujourd’hui à l’élevage intensif (soja, maïs) disponibles pour les cultures vivrières. Mais on a des raisons de craindre que la tendance actuelle se poursuivra et que les pouvoirs publics persisteront à financer les élevages industriels et à dispenser l’agrobusiness du principe pollueur-payeur. Sera d’abord avancé que cela supposerait que tous les pays forts consommateurs de produits animaux et disposant d’élevages industrialisés s’y mettent, ce qui semble exclu à court et moyen terme. Ensuite parce que l’élevage productiviste permet d’exporter des productions animales et que la contribution de l’agroalimentaire au PIB est important. Enfin parce que les pouvoirs publics n’ont pas envie d’avoir leurs préfectures noyées dans du lisier !
1Pour qualifier les formes productivistes d’élevage je parlerai parfois d’« élevages industriels ». En effet, comme dans la production industrielle, les modèles techniques qui se sont développés essentiellement en élevage de porcs, de volailles et de veaux (et de plus en plus en élevage bovin) ont eu pour objectif le contrôle de l’environnement des ateliers de production ainsi que la standardisation des animaux et du travail.
2Michel Griffon, Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive ? Versailles, Quæ, 2013.
3Dreze J., Sen A., Hunger and Public Action, Oxford, Oxford University Press, 1989, Dreze J., Sen A., The Philosophical Economy of Hunger : selected essays, Oxford, Clarendon Press, 1995.
4Michel Griffon, Nourrir la planète – pour une révolution doublement verte, Paris, Odile Jacob, 2006.
5La suite de ce paragraphe reprend l’argumentation et des fragments du chapitre suivant : Raphaël Larrère « Prendre la nature pour partenaire », dans Bernard Hubert et Denis Couvet (dirs) La transition agroécologique – Quelles perspectives en France ? Paris, Presses des Mines, collection Académie d’agriculture de France, 2021. pp. 369-378.
6Voir sur ce sujet : Foucart S., Et le monde devint silencieux – Comment l’agrochimie a détruit les insectes. Paris, Seuil, 325 p, 2019.
7Yinon M. Bar-On, Rob Phillips &Ron Milo, « The biomass distribution on Earth », PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (25): 6506-6511, 2018. Selon la Synthèse FRB, État et tendance, Répartition globale de la biomasse au sein de la biosphère (juin 2018) : La biomasse des mammifères sauvages s’élèverait aujourd’hui à ~ 0,007 Gt C, loin derrière l’homme (~ 0,06 Gt C) et ses cheptels bovins et porcins (~ 0,1 Gt C).
8Bennett Carys E., Thomas Richard, Williams Mark, Zalasiewicz Jan, Edgeworth Matt, Miller Holly, Coles Ben, Foster Alison, Burton Emily J. and Marume Upenyu, « The broiler chicken as a signal of a human reconfigured biosphere », R. Soc, open sci. 5 : 180325-180325, 2018.
9Fabrice Nicolino, Bidoche. L’industrie de la viande menace le monde, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2009.
10William Balee, « Indigenous transformations of Amazonian forests : an exemple from Maranhão, Brazil » in Anne Christine Taylor & Philippe Descola (eds), « La remontée de l’Amazone » L’Homme, 33 (2-4), 1993, p. 235-258 ; Darell Posey, « A preliminary report on diversified management of tropical rainforest by the Indians of the Brasilian Amazon », Advances in Economic Botany, 1, 1984, p. 112-126 ; Laura Rival, « Amazonian historical ecologies »in Journal of the Royal Anthropological Institute, 12 (s1,) 2006, S79-S94.
11Voir Serge Morand, op. cit., p. 96.
12Rapport commandé par le Council for Agricultural Science and Technology (CAST), Global Riks of Infectious animal Disease, Issue Paper no 28, 2005.
13Jean Carlet et Pierre Le Coz, Tous ensemble sauvons les antibiotiques, Rapport du Groupe de travail spécial pour la préservation des antibiotiques remis à Marisol Touraine en juin 2015. Il y est précisé qu’en « France, chaque année, plus de 150 000 patients développent une infection liée à une bactérie multi-résistante, et plus de 12 500 personnes en meurent. »
14Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
15ANSES, L’antibiorésistance, une problématique transversale à l’agence. 2019.
16Serge Morand L’homme, la faune sauvage et la peste. Paris, Fayard, 2020, chapitre 6 « Un monde sous antibiotiques » pp. 117-143.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)