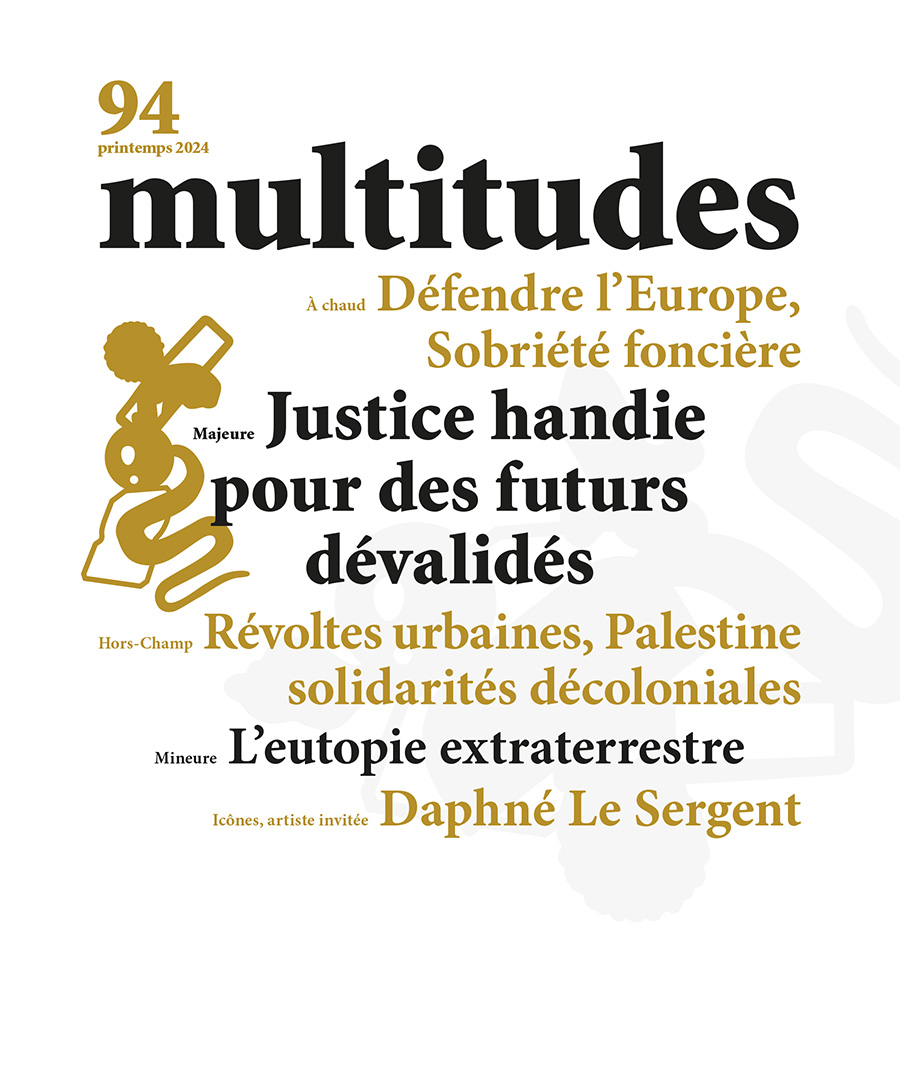Dans un récent et très intéressant rapport sur « La sobriété, fil vert de la transformation1 », un groupe de travail du Comité 21 réuni autour de sa présidente fondatrice, Bettina Laville, aboutit à la conviction que la sobriété est la promesse d’« une véritable rupture avec les siècles écoulés, qui peut nous conduire à vivre harmonieusement sans porter atteinte perpétuellement à notre environnement et aux droits humains d’une partie de la population […] la valeur fondatrice d’un nouvel humanisme […] un nouveau modèle de comportement […] l’apprentissage d’un vivre ensemble harmonieux et équitable qui permet à tous l’accès à un minimum de ressources afin d’accéder à une vie digne », etc. (page 51 et suivantes).
La sobriété, nouveau mantra de sociétés d’abondance
Menant une discussion approfondie qui convoque, dans l’ordre, les Grecs anciens (Sénèque, Diogène, Epicure), les trois religions du Livre ainsi que l’hindouisme et le bouddhisme, l’Évangile selon Saint-Paul, Saint-Thomas d’Aquin, le protestantisme, Montaigne, Rousseau, Le Club de Rome, Ban Ki Moon, le pape François, Jacques Ellul, Ivan Illitch, André Gorz, le Shift Project, Dominique Bourg, Serge Moscovici, Michel Maffesoli, et quelques autres, le rapport ne cache pas, au passage, sa fascination fondamentale pour « des modes de vie simples, basés sur une agriculture de subsistance et une connexion forte à la nature […] exemples de vies sobres qui fonctionnent avec une économie fondée directement sur la durabilité tels que le peuple Qashqai et les Bantous d’Afrique australe » (p. 11).
Rappelons que le Comité 21 est une association française créée en 1995 dans la foulée du Sommet de Rio, dont les 450 adhérents à ce jour regroupent aussi bien des entreprises, dont les plus grandes2, des groupements d’employeurs3, des ONG et des associations4, des universités et des écoles supérieures publiques et privées, des services centraux de l’État5, des collectivités territoriales et leurs lobbies (Association des maires de France, des départements de France, etc.), que des citoyens organisés. En somme, c’est probablement aujourd’hui en France le plus large réseau d’acteurs porteur de la cause et de la vigilance écologiques, présent à la fois sur la scène des transitions aux échelles mondiale (les COP et leurs engagements), nationale (l’œuvre législative) et locale (les politiques territoriales, les initiatives, projets et expérimentations).
Avec la sobriété, le Comité 21 a semble-t-il trouvé l’expression la plus convaincante à ses yeux de ce qu’il s’agit de promouvoir désormais partout, à toutes les échelles et dans tous les domaines, après l’épuisement sémantique et/ou opératoire de la notion de développement durable et au-delà de la métapolitique de la transition écologique vers un monde décarboné : le monde d’après sera sobre ou ne sera pas. Pour ne s’en tenir qu’à elle, la sobriété foncière, c’est-à-dire la limitation drastique de l’artificialisation de nouveaux terrains, est une des dimensions de ce nouveau référentiel global d’action publique et collective, en même temps que modèle comportemental à l’usage de tout un chacun.
Le feuilleton du ZAN
Or, nous venons de vivre en France un épisode de la mise en œuvre de la sobriété foncière qui rappelle toute la différence qu’il y a entre un énoncé quasi philosophique qui joue le rôle d’un mantra, et une politique publique. L’application de la disposition de la loi Climat et Résilience portant sur « la lutte contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes6 » a ouvert un feuilleton politico-législatif sur le sujet qui dure depuis plus de deux ans et n’est probablement pas terminé. En résumé, les termes en sont les suivants :
− Sous l’impulsion de la convention citoyenne pour le climat (octobre 2019 − juin 2020), et à partir d’avancées législatives dans d’autres pays européens suite à l’année mondiale des sols (2015), le Parlement français a adopté le 22 août 2021 un objectif dit de « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050, visant à diminuer par deux au cours des trois prochaines décennies, jusqu’au bilan net nul, la consommation foncière réelle, c’est-à-dire la différence entre les espaces transformés par l’urbanisation sous toutes ses formes, et ceux qui, selon un processus inverse, sont restitués à un fonctionnement naturel.
− S’en est suivi une intense et riche controverse à la fois scientifique, médiatique, technique et politique sur les instruments et les échelles de mesure de l’artificialisation en question, sur sa nature même (imperméabilisation ? dénaturation ? perte de fonctionnalités écologiques ?), sur la répartition de l’effort à réaliser selon les territoires et leur contexte, et finalement, en filigrane, sur le caractère réel ou fantasmé de l’urgence écologique concernant la gestion de la ressource foncière et des sols en France.
− Moyennant quoi, une nouvelle loi adoptée le 12 juillet 2023, « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et renforcer l’accompagnement des élus locaux » est venue grosso modo détricoter l’édifice précédent, sous l’impulsion vigoureuse de la droite sénatoriale, relayant la très médiatisée « inquiétude des maires ruraux », et, à travers eux, les lobbies des divers acteurs de l’immobilier, qui n’avaient pas besoin du ZAN pour se sentir dans l’impasse ces temps-ci.
− Cahin-caha, la politique du ZAN progresse malgré tout, en premier lieu par sa traduction dans toute la cascade réglementaire (du niveau régional jusqu’au niveau communal) que constituent en France les documents de planification : Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), Schémas de cohérence territoriaux (SCoT), Plan locaux d’urbanisme, intercommunaux (PLUI) ou pas (PLU).
− Sans oublier de rappeler que cette politique progressera d’autant plus qu’au cours de la génération qui vient, la France va rentrer progressivement dans un cycle probablement long de stagnation puis de déclin démographiques avec une apogée de peuplement qui devrait s’établir autour de 70 millions d’habitants en France métropolitaine ; que ce cycle a déjà commencé dans de larges parts du pays déjà en décroissance (un tiers des aires urbaines par exemple) ; et qu’il sera dans ces conditions un peu plus facile de constater les progrès de la sobriété foncière à l’avenir.
Comment avance-t-on ?
Entre le basculement civilisationnel annoncé autant qu’espéré par le Comité 21 avec l’appui des voix autorisées qu’il invoque, et la réalité sociopolitique française du passage à l’acte de la sobriété foncière, il y a donc un sérieux écart qui mérite qu’on s’y attarde. D’un côté, le mouvement sociétal (européen ? universel ?) vers la sobriété est incontestable et le rapport du Comité 21 en relève 1 001 preuves et traces. Il est d’ailleurs significatif de voir les grandes firmes du capitalisme mondialisé parmi les plus attentifs à cette évolution rapide des opinions publiques, des idéologies, des aspirations individuelles et des marchés. De l’autre, lorsqu’on concrétise le rendez-vous par l’engagement d’une politique territorialisée de sobriété foncière, on se heurte à une mobilisation dont les arguments peuvent laisser sans voix, tant ils sont excessifs, fantasmés, injustifiés, voire de pure provocation. Le ZAN empêcherait en France les territoires les moins denses d’envisager tout développement, les priverait d’avenir, signerait la mort de la ruralité au bénéfice des villes triomphantes, tout en aggravant la désindustrialisation du pays et ruinant l’économie immobilière. Autrement dit : le ZAN, non, la sobriété foncière, oui (en souvenir du fameux sketch de Bourvil sur l’alcool et l’eau ferrugineuse).
On peut certes se dire qu’aucune avancée sociale (aujourd’hui sociale-écologique), aucune conquête de droits nouveaux, et a fortiori aucune bifurcation politique majeure ne se sont jamais réalisées sans une phase d’hostilité et de résistance, de mobilisation d’abord minoritaire mais toujours conquérante, de lutte de convictions, d’instauration d’un rapport de forces avant de finir par l’emporter : hier, progressistes de toute obédience contre conservateurs et réactionnaires, aujourd’hui, écologistes unis contre un assemblage confus d’attentistes, d’autistes et de négationnistes, qui ne font que retarder l’avènement d’une ère nouvelle. La sobriété serait donc l’étendard de cette ère, et la sobriété foncière une de ses batailles. Il y en a et il y en aura d’autres, et l’essentiel est de tenir le cap de la grande transformation, de conquérir les esprits un à un et de rassembler toujours plus largement, comme dans toute épopée militante. C’est bien la fonction d’un mantra, dont acte.
Mais on pourrait aussi tirer profit de l’histoire longue et foisonnante de ces luttes de conquêtes sociales, désormais sociales-écologiques. Elles ont toujours été portées par un récit, souvent messianique, et le mantra de jadis (la fin de l’exploitation de l’homme par l’homme, la libération et l’avènement d’un homme nouveau) valait bien en idéalisme celui d’aujourd’hui. Quelles que soient les contradictions, les errements, les impasses et les paradoxes de ces luttes, reste que si les choses ont avancé, c’est parce que du mantra (récit, idéal, référentiel militant), on a su négocier des traductions politiques et législatives concrètes, des dispositifs sociaux régulateurs, émancipateurs, solidaires, qui ont permis les avancées et conquêtes que l’on sait dans le champ de la grande question de l’époque, la question sociale.
Aujourd’hui, la grande question est la question écologique, et, bien qu’autrement plus complexe parce que planétaire et systémique, son sujet est toujours le même : comment avance-t-on, concrètement ? C’est là qu’on peut s’interroger sur la performativité du mantra au regard de la médiocrité actuelle de certaines traductions sociopolitiques, par exemple dans le domaine de la sobriété foncière, et sans laisser entendre pour autant que la bataille du ZAN est déjà perdue.
Elle ne l’est pas, et il faudra sans doute une ou deux décennies pour en convenir. De même, probablement pour la bataille de l’eau
(préservation, régénération, partage), la bataille de la décarbonation contre les émissions de gaz à effet de serre, la bataille des ZFE (zones de faible émission) et de la qualité de l’air dans les grandes villes, la bataille du glyphosate, la bataille de la pollution par les plastiques, la bataille contre les perturbateurs endocriniens, et tant d’autres dont celles que nous ne connaissons pas encore. À chaque fois, à travers la bataille, c’est une politique publique qui se met en place : la définition d’objectifs et de normes nouvelles, d’indicateurs et d’outils de mesure, un corps technique, de médiation et de contrôle pour appliquer les principes collectifs, et tout ce que la science politique a décrit dans le second XXe siècle en même temps que se forgeait dans la pratique le principe de politique publique. Et à chaque fois, cette technicisation de l’action publique est en même temps une histoire politique parce qu’elle résulte d’âpres négociations, de compromis, d’ajustements successifs entre intérêts bousculés, de réagencements, de progrès et de reculs. L’instauration du ZAN en témoigne : c’est bien ainsi que les choses finissent par avancer.
Alors le mantra ? Il est nécessaire mais pas suffisant. Et il prend parfois le risque par sa prétention morale ou sa quête irénique de devenir suffisant mais pas nécessaire. Il faut un grand récit justificateur de la sobriété, et le Comité 21 est dans sa fonction lorsqu’il y contribue et documente la montée de ce récit dans divers sphères de la société. Mais il faut avant tout veiller à la traduction du mantra en politiques publiques, c’est-à-dire en dispositifs politiques et techniques pour prendre à bras-le-corps les conflits que génère toute proposition de transformation sociale et/ou écologique et pour les convertir en avancées négociées. Faute de quoi l’écart se creuse entre l’envolée du mantra, porté aux idéaux les plus élevés par une élite culturelle touchée par la nouvelle grâce, et ce qui se passe concrètement dans la société en transformation toujours imparfaite.
Avec la sobriété et particulièrement la sobriété foncière, on a, de ce point de vue, un cas d’école. Le discours en faveur de la sobriété prend vite une tournure éthique, morale, voire spirituelle. Le rapport du Comité 21 la revendique en consacrant de nombreuses pages au comportement des individus, à ce qui se passe dans leur cerveau qui doit se départir des habitudes de consommation débridée d’une société dite d’abondance. Au-delà de ce seul rapport, qui n’est après tout qu’une toute petite partie de la production du Comité 21, une large part de l’écologie politique, en France plus particulièrement, a toujours surinvesti l’approche comportementaliste individualisée et ses motifs éthiques, philosophiques ou moraux, et considéré avec soupçon la fabrique des politiques publiques basée sur la négociation et le compromis.
Or, c’est de fait à travers ces négociations que la sobriété foncière qui suppose une révolution des formes d’affectation des sols et qui réorganise fondamentalement l’espace, va progresser avec le dispositif du ZAN, aussi maladroit et martyrisé soit-il.
De l’incantation à l’opération
Dans l’immédiat, rendre opératoire et pas seulement incantatoire l’objectif de sobriété foncière à travers la mise en œuvre du ZAN dépend de trois choses :
1. Un dispositif bancaire de crédit public à très long terme pour que les établissements publics fonciers nationaux, régionaux et locaux (36 EPF à ce jour) soient en capacité, par l’endettement, de porter longtemps et massivement le foncier mutable en zone déjà urbanisée, afin d’en faire désormais le champ prioritaire et accessible du développement urbain consistant à refaire la ville sur la ville. Ce foncier déjà urbanisé est 1 000 fois plus cher que le foncier agricole qui sert depuis un siècle de gisement de déploiement de la rente foncière urbaine. Il faut pouvoir le réinjecter dans la fabrique immobilière sans la lester d’une charge foncière de départ qui explique l’essentiel de l’envolée des prix du logement ces dernières années. Autrement dit, il faut progressivement retirer du marché le sol urbain mutable, pour le dégager des logiques spéculatives séculaires qui ont nourri des générations de rentiers, et le mettre à disposition d’une production immobilière accessible. Faute de quoi il sera impossible de construire en ville pour d’autres catégories d’acheteurs ou d’occupants que ceux du dernier décile de revenus (les 10 % des ménages les plus aisés), et même parfois du dernier centile (les 1 %). Mais pour cela, il faut des EPF aux reins très solides, véritables sociétés publiques foncières, adossées à un marché du crédit privilégié et garanti par l’État sur le très long terme, ces sociétés publiques se rémunérant progressivement sur les loyers fonciers, sur le mode du bail réel solidaire.
2. Une économie rémunératrice pour les usages du foncier non bâti et qui doit le rester, y compris en ville, intérêt écologique oblige. Cette économie rémunératrice doit s’affirmer dans le domaine alimentaire (agriculture urbaine et périurbaine), métabolique (contribution à la restauration de la biodiversité, champs de captage, zones d’infiltration des précipitations, zones de dépollution naturelle) et climatique (contribution au rafraîchissement). Elle rappelle que le foncier n’est pas qu’une surface, mais d’abord une épaisseur, et qu’à condition que cette épaisseur reste vivante, elle rend des services écosystémiques inégalables. Lesquels ne sont jusqu’à présent que rarement, très peu ou très indirectement rémunérés. Pour qu’ils puissent l’être, tout en n’ouvrant pas un nouveau chapitre de la marchandisation des sols, il faut inventer et soutenir une économie publique ou coopérative locale à partir des intérêts et bienfaits des sols vivants non bâtis, expression concrète de la sobriété foncière. Ce qui appelle des structures porteuses de ces biens publics ou biens communs, la reconnaissance de marchés solidaires les concernant, et le soutien aux innovations sociales qui ont déjà largement entrepris de les investir. Faute de quoi, le beau mantra de la sobriété foncière risque de se traduire en une ultime étape de colmatage urbain et de sur-densification, la croissance extensive étant de moins en moins possible. En urbanisme aussi, l’enfer est pavé de bonnes intentions.
3. Une obligation faite aux communes et à leurs intercommunalités de réaliser le ZAN à une échelle qui permette de négocier la réciprocité des intérêts ou au contraire, des renoncements locaux qu’il implique. Plus on descendra en échelle, jusqu’à celle de la commune, moins l’équation du ZAN sera tenable. Il va falloir organiser des transactions de développement durant les trente prochaines années au cours desquelles le bilan net de consommation foncière devra diminuer drastiquement mais laissera encore des marges de manœuvre à mutualiser impérativement. Ce qui interpelle toute l’architecture des pouvoirs locaux, encore très municipale en France. En réalité, le ZAN implique une France résolument intercommunale et même intercommunautaire. C’est bien ce qu’ont compris ses opposants, qui se sont empressés d’exiger et d’obtenir par la loi du 12 juillet dernier une « garantie rurale » d’un hectare par décennie et par commune, ce qui revient à accélérer la consommation foncière en invoquant la sobriété. Bourvil avait raison.
De la morale à la politique publique
Avec ces trois conditions ou leviers de la politique de sobriété foncière en France, on s’éloigne du champ comportemental du rapport à l’abondance, à la consommation, à la possession, et des nécessités de s’en guérir. La sobriété peut, certes, être abordée en tant que concept philosophique aux fins de l’introspection du mode de vie de chacun. La sobriété foncière appelle pour sa part une solide économie politique, si l’on veut faire bouger des fondamentaux aussi moralement investis, eux aussi, que le droit à la propriété et le droit au développement. Le problème de l’approche morale du sujet, c’est que non seulement, elle tend à détourner les efforts d’un champ crucial pour l’action transformatrice, à savoir le champ des politiques publiques, mais qu’elle excite en outre les crispations tout aussi morales, éthiques et spirituelles (mais pas issues du même système de valeurs) de la part de celles et ceux que la transformation rebute. Ils sont nombreux et ont eu tôt fait de présenter la sobriété foncière et son ZAN comme des lubies de bobos citadins richement dotés de leur confort urbain et incapables de comprendre le besoin des campagnes.
Ce genre de clivage est absurde et catastrophique. Il peut faire perdre de précieuses années à l’urgente transformation écologique. Celle-ci n’appelle pas une évangélisation accélérée afin que les convaincus de la sobriété heureuse soient un peu plus nombreux, enfin libérés de l’esclavage de leur insoutenable mode de vie. On ne transformera pas la société contre une partie d’elle-même. La sobriété ne doit pas être une église. Les églises rassemblent des communautés. Au-delà d’elles, la société tient ensemble en tant que construction politique. Lorsque une transformation vitale la travaille toute entière, il faut encore plus de politique pour que la construction demeure, pour le meilleur et parfois pour le pire, à surmonter. Sobriété foncière ? Passons du mantra à la politique publique !
Pour aller plus loin
Daniel Béhar, Sacha Czertok, Xavier Desjardins, 2022. « Zéro artificialisation nette : banc d’essai de la planification écologique », AOC, mis en ligne le 5 juillet. https://aoc.media/opinion/2022/07/04/zero-artificialisation-nette-banc-dessai-de-la-planification-ecologique
Zoé Chaloin, Cyriel Pelletier, Laurent Pinon, 2023. « Les outils de la sobriété foncière en Europe. Benchmark des politiques de lutte contre l’artificialisation des sols en Allemagne, Belgique, Italie et Espagne ». Les dossiers FNAU, no 57, 24 pages. www.fnau.org/fr/publication/les-outils-de-la-sobriete-fonciere-en-europe
Bettina Laville, Sarah Dayan, Clara Beauvoir, 2022. La sobriété, fil vert de la transformation. Comité 21, 55 pages. www.comite21.org/ressources/etudes/index.html?id=14512
Raphaël Languillon-Aussel, Maxence Naudin, 2023. « Sobriété foncière, évolutions et perspectives comparées : France, Suisse, Angleterre et Japon ». La Fabrique de la Cité − Note d’auteur.
www.lafabriquedelacite.com/wp-content/uploads/2023/10/Note_La-sobriete-fonciere_perspective-internationale_compressed-6.pdf
Didier Locatelli, 2023. « Le ZAN au service des centralités rurales », Telos, mise en ligne le 8 novembre. www.telos-eu.com/fr/societe/le-zan-au-service-des-centralites-rurales.html
Jean-Marc Offner, 2022. « ZAN, contre-enquête De l’impasse légaliste de l’arithmétique foncière à l’ambition régulatrice de la gouvernance des sols », Urbanisme, mis en ligne le 22 août.www.urbanisme.fr/debat/zan-contre-enquete-de-limpasse-legaliste-de-larithmetique-fonciere-a-lambition-regulatrice-de-la-gouvernance-des-sols
Jean-Marc Offner, 2023. « ZAN saison 2 : Un mode d’emploi alternatif du “zéro artificialisation” », Urbanisme, mis en ligne le 3 avril. www.urbanisme.fr/debat/zan-saison-2-un-mode-demploi-alternatif-du-zero-artificialisation
Jean-Marc Offner, 2023. « La standardisation des politiques publiques locales : une renationalisation tacite », La Grande Conversation, mis en ligne le 25 septembre. www.lagrandeconversation.com/ecologie/la-standardisation-des-politiques-publiques-locales
Martin Vanier, 2023. « La controverse du ZAN », Telos, mise en ligne le 16 mai. www.telos-eu.com/fr/societe/la-controverse-du-zan.html
Martin Vanier, 2023. « Zéro artificialisation nette : premières leçons », La Grande Conversation, mise en ligne le 7 septembre. www.lagrandeconversation.com/ecologie/zero-artificialisation-nette-premieres-lecons
Martin Vanier, 2023. « Intercommunalité : ce qu’exige l’urgence écologique ». Horizons publics, no hors-série, Berger Levrault, p. 17-21. https://martinvanier.hypotheses.org/files/2024/01/HS-AUTOMNE-2023-Vanier.pdf
1Bettina Laville, Sarah Dayan, Clara Beauvoir, 2022, La sobriété, fil vert de la transformation, Comité 21, 55 pages. www.comite21.org/ressources/etudes/index.html?id=14512
2Bouygues, Veolia, Vinci, Naval Group, EDF, Engie, SNCF, TotalEnergies, Schneider Electric qui a soutenu la réalisation du dit-rapport, etc.
3UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie), UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction), etc.
4La Fonda, Humanité et Biodiversité, La Fresque du climat, etc.)
5ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement), Office Français de la Biodiversité, etc.
6Chapitre III du titre V « Se loger ».
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)