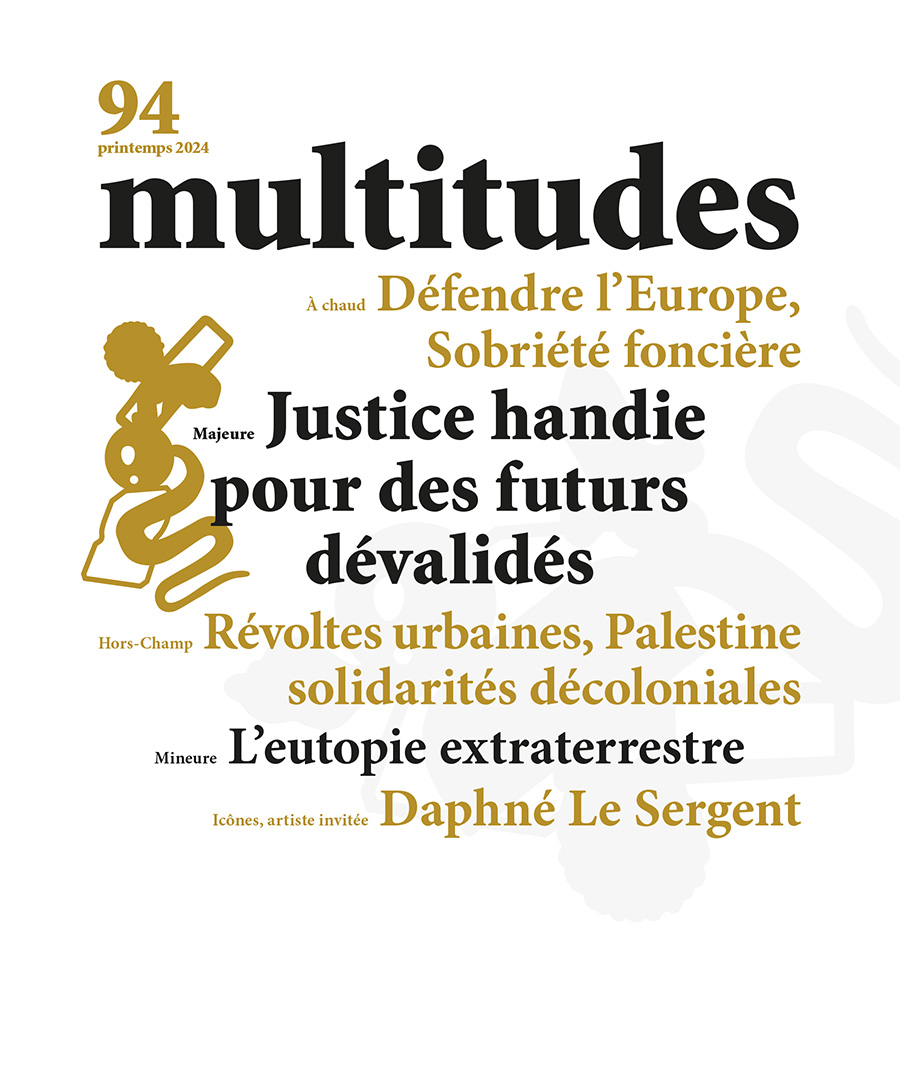La mort de Nahel. M, 17 ans, abattu par un tir policier lors d’un contrôle de véhicule à Nanterre mardi 27 juin au matin, a déclenché une série d’émeutes dans plusieurs communes populaires d’Île-de-France et une vague d’indignation parmi un certain nombre de jeunes des « quartiers » à travers destructions et dégradations dans l’ensemble du pays. Ce scénario se répète inlassablement depuis les années 1980 : une interaction entre jeunes d’un quartier et la police qui tourne mal. Certes les émeutes qui se sont déroulées en ce début d’été − comme « celles de novembre 2005 » − font figure d’exceptions dans l’ampleur des dégâts et la nature géographique de leur propagation. Mais le synopsis reste à peu de chose identique. Comment se fait-il que nous assistions depuis plus de quarante ans à des révoltes urbaines de la part d’adolescents et de jeunes originaires des quartiers populaires urbains contre les forces de l’ordre et plus généralement les institutions ? Il est toujours difficile de répondre à cette question bien que la littérature sociologique soit abondante sur ce phénomène. C’est pourquoi nous allons proposer un nouvel éclairage sur les émeutes urbaines juvéniles désormais répétitives entre continuités avérées et changements hypothétiques dans une société postindustrielle en mutation désormais plus qu’incertaine.
Des continuités émeutières depuis les années 1980
Comme nous l’avons indiqué dans notre courte introduction, la grande majorité des « émeutes urbaines » se déclenchent à la suite de la mort d’un jeune, conséquence le plus souvent d’une interaction chaotique de jeunes adultes avec les forces de l’ordre. Des échauffourées entre jeunes et policiers s’ensuivent les nuits suivantes, déclenchant des blessés de part et d’autre et des arrestations massives hypothéquant encore un peu plus l’avenir des jeunes ou adolescents appréhendés par les forces de l’ordre sur le moment. En deux ou trois nuits, la cité est mise à feu et à sang et un certain nombre de biens publics sont brûlés et vandalisés : commissariats et bâtiments publics sont directement visés pour désigner l’État comme responsable de la situation. Des écoles et autres dispositifs liés aux services publics ont connu le même sort qu’en 2005. Autrement dit des équipements de services publics comme ceux de l’école ont été saccagés par les jeunes parce que l’école est perçue comme une institution officialisant la sélection sociale et à l’origine de la relégation de beaucoup de jeunes adultes évoluant dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville1. Beaucoup d’institutions républicaines présentes sur des territoires en lien avec les habitants des cités HLM sont appréhendées en effet, à tort ou à raison, comme des structures véhiculant des éléments culturels de la classe moyenne, humiliantes pour les pratiques sociales des jeunes en situation d’échec professionnel et scolaire2. Beaucoup d’institutions comprenant des dimensions scolaires ou culturelles font l’objet d’attaques de la part des jeunes en raison des rapports de domination culturelle qu’elles exercent sur des jeunes en voie de relégation sociale. Enfin, une marche silencieuse est organisée par les militants du quartier et la famille du défunt afin de soutenir les proches et appeler au calme. Dans la majorité des cas des marches funèbres clôturent les épisodes émeutiers sans éteindre pour autant les colères.
Mais comme lors des « émeutes de novembre 2005 », la marche funèbre organisée à Nanterre le 29 juin 2023 n’a pas ponctué le scénario émeutier. Cette dernière émeute a perduré et s’est étendue non seulement à d’autres quartiers populaires urbains (parfois dans des villes moyennes de province réputées calmes et bucoliques) mais aussi dans les centres-villes plus huppés jusqu’à la capitale durant le week-end émeutier. Les réponses des membres du gouvernement ont été au départ différentes de celles de 2005 car ils ont porté le discrédit sur l’agissement du policier et proposé une minute de silence à l’Assemblée Nationale contrairement à Sarkozy qui s’était montré provocateur et avait menti à la suite de la mort de Zyed et Bouna. En revanche la rhétorique des éditorialistes sur les chaînes d’information continue se résume davantage aux laïus condamnatoires désormais convenus : stigmatisation des jeunes renvoyés à leurs « origines » et réponses répressives par un « couvre-feu », arrestations massives avec comparution immédiate ayant de lourdes conséquences pour certains jeunes et remontrance envers des parents jugés responsables de leur mauvaise éducation. Et la question des rapports entre les jeunes des « quartiers » et la police n’a guère évolué depuis les années 1970.
Aussi à la fin des années 2000, nous avions répondu avec mes collègues à un appel d’offres financé par la Halde qui portait sur le discernement policier. Il était question de travailler sur le comportement des policiers à l’égard des jeunes des « quartiers sensibles ». Le contrat obtenu, nous avions enquêté dans des quartiers populaires d’Évreux et de Marseille pour ce qui concerne les « quartiers sensibles » et à Châtelet-Les-Halles afin d’observer les interactions jeunes/police dans un espace névralgique et touristique3. Nous avions interrogé une quinzaine de gardiens de la paix, trois commissaires et cinq lieutenants de police, des formateurs de policiers et un certain nombre de jeunes rencontrés sur les trois terrains. Puis nous avions proposé une dizaine de préconisations dans un rapport remis et présenté à la présidente de la Halde devant préfets et hauts gradés de la police en octobre 2012. Ce rapport a permis la publication d’un ouvrage collectif publié en 2013 intitulé Casquettes contre képis 4. Par la suite nous n’avons jamais eu de retour concret et pratique de ce travail de recherche, qui a duré tout de même plus de deux ans.
Des quartiers populaires urbains confrontés à des mutations structurelles
Historien de formation, je me suis attelé à la fin des années 1990 à mener des recherches sur le devenir d’enfants d’ouvriers et d’immigrés (pour beaucoup) qui ne peuvent plus devenir ouvriers5. Les générations ouvrières précédentes − du métallo de l’entre-deux-guerres à l’ouvrier spécialisé des Trente Glorieuses − évoluaient dans un espace difficile et parfois en conflit avec la police et les différentes autorités politiques. Mais ces différentes générations ouvrières étaient perçues, malgré la dangerosité politique, sociale et culturelle que ces ouvriers pouvaient symboliser pour les différents pouvoirs en place6, comme l’avenir de la société industrielle contrairement aux générations post-ouvrières à partir des années 1980 incarnées par les jeunes de banlieue appréhendés au mieux comme inutiles, au pire comme dangereux.
Ainsi nous pouvons énumérer six facteurs importants qui sont à l’origine de la détérioration des modes de vie des nouvelles générations post-ouvrières dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville : 1/ la fin de l’encadrement de la jeunesse populaire liée au déclin des syndicats et des socialismes d’une manière générale ; 2/ la construction politique d’un nouvel ennemi intérieur véhiculé par les « jeunes de cité », notamment issus de l’immigration maghrébine et d’Afrique subsaharienne appréhendés comme musulmans ; 3/ la relégation sociale de ces enfants d’ouvriers et d’immigrés qui ne peuvent devenir ouvriers et sont, de surcroît, perçus comme inutiles et dangereux pour la cohésion nationale ; 4/ le constat, dans des logements sociaux paupérisés et enclavés, que les « classes moyennes » et les milieux populaires supérieurs ont déserté les « quartiers », ce qui renforce le stigmate et le sentiment d’abandon dans les constructions identitaires des jeunes observés dans les cités populaires ; 5/ des tensions à répétition avec les forces de l’ordre en raison d’un traitement d’exception dans les quartiers populaires qui remonte aux années 1970 et qui se traduit ces deux dernières décennies par des violences ritualisées et des rancunes personnalisées plus tenaces ; 6/ un manque de débouchés politiques et donc de perspectives susceptibles de canaliser les contestations, les colères et les mécontentements des générations post-ouvrières des quartiers populaires urbains.
Une troisième génération d’émeutiers ?
Il est toujours difficile pour un sociologue de réagir « à chaud » à ce type d’événements plutôt spectaculaires et ultramédiatisés. Commenter l’actualité même si c’est son objet de recherche alors que nous ne sommes pas présents sur le terrain et que nous n’avons pas rencontré les différentes personnes en action sur le moment reste aléatoire. De plus le rôle des journalistes, des politiques et autres éditorialistes qui commentent, ergotent et spéculent sur les chaines infos ajoutent de la « pollution rhétorique » à des images violentes et spectaculaires le plus souvent décontextualisées. Pour autant nous pouvons essayer de dégager quelques nuances observées avec les émeutes précédentes bien qu’il faille insister surtout sur les héritages. Nous avons donc essayé ici de repérer un ensemble de changements en comparaison des dernières grandes émeutes urbaines qui ont eu lieu, rappelons-le, en 2005 :
Nous sommes entrés désormais de plain-pied dans le XXIe siècle et ne nous a pas échappé le rôle central joué par les réseaux sociaux. Si une étude sociologique approfondie rigoureuse reste à engager sur l’importance des Instagram, Snapchat, Tik Tok ou Twitter dans le déroulement et la propagation des échauffourées juvéniles estivales, nous observons que le phénomène émeutier s’est diffusé dans un certain nombre de villes a priori peu concernées par la « bavure » policière de Nanterre comme Montargis. Le rôle des réseaux sociaux a sans aucun doute un impact dans la manière de diffuser les images et d’inciter ainsi d’autres jeunes des « quartiers » à participer à ses événements de manière rapide.
Un second changement constaté, en lien avec le précédent, qui fait suite à des échanges informels avec quelques adolescents durant le week-end émeutier du début juillet 2023 (des enfants des jeunes rencontrés dans les années 1990). S’il est bien difficile de déterminer l’influence des jeux vidéo chez les insurgés dans le vandalisme constaté, l’influence du rap game constitue sans aucun doute une piste à creuser puisque quatre jeunes m’ont parlé des clips du rappeur Kaaris et d’un autre rappeur un peu moins connu Ninho qui évoque dans son clip « 25 grammes7 » une voiture jaune grosse cylindrée conduite par des jeunes sans permis qui se font arrêter par la police. L’arrestation tourne d’ailleurs au drame dans le morceau évoqué. Ce clip sorti trois semaines avant les événements est suggéré de manière spontanée par les adolescents rencontrés. Ces jeunes m’ont également parlé du film Athéna diffusé sur la plateforme Netflix qui met en scène une guérilla urbaine entre policiers et jeunes dans une cité HLM qui fait également suite à la mort d’un jeune. Il est bien difficile d’évaluer l’influence du rap game ou des films comme Athéna chez les adolescents et jeunes adultes qui ont participé activement aux émeutes, mais il semblerait que ces productions artistiques font partie du répertoire culturel et de la mémoire collective des adolescents rencontrés ici comme le furent NTM, IAM ou Assassin pour le rap ou Ma cité va craquer ou La haine au cinéma pour les générations de jeunes de cité précédentes8.
Si l’État à travers ses équipements comme les commissariats, les écoles et autres bâtiments publics hébergeant des structures d’encadrements juvéniles a été une fois de plus assailli (comme en 2005), nous avons pu observer l’attaque plus intense de centres commerciaux, de certains commerces lucratifs comme les bars PMU ou des magasins de vêtements de marques ou plus rarement des banques. Des symboles de la société de consommation et du monde capitaliste se sont ainsi vu piller par certains émeutiers (qui ne composent pas tous les jeunes de cité). Si certains jeunes se sont adonnés à des vols de cigarettes dans les bars-tabacs (devenues onéreuses sur le marché) ou de vêtements de marques probablement pour les revendre, d’autres personnes se sont rendues dans des supermarchés vandalisés pour chaparder des biens de consommation de première nécessité comme des packs de laits ou des paquets de céréales. Ce constat mérite d’être creusé davantage sur les effets négatifs d’une société de consommation à l’origine de souffrances et de frustrations pour beaucoup de jeunes des milieux populaires urbains précarisés depuis trois générations maintenant.
De plus, ces « nouvelles émeutes » de grande ampleur interviennent après une série d’états d’urgence qui ont affaibli la légitimité des institutions auprès des Français en général et des classes populaires en particulier : 1/ les répressions faisant suite aux attentats de 2015 qui se sont focalisées, une fois de plus, sur certains habitants des quartiers populaires urbains ont sans aucun doute approfondi des ruptures symboliques entre certains des habitants des cités HLM et les institutions9 ; 2/ le mouvement des Gilets jaunes a écorné l’image positive de la police auprès des classes populaires en France qui représentent, rappelons-le, plus de 60 % de la population totale ; 3/ plus récemment, le traitement par les institutions de l’épidémie de Covid, notamment le confinement, a également amplifié le sentiment d’injustice chez certains jeunes obligés de rester enfermés dans des logements sociaux exigus pour beaucoup10 ; 4/ enfin la réforme des retraites oblige un grand nombre de Français à travailler plus longtemps et a des effets concrets sur les habitants des quartiers populaires urbains qui occupent le plus souvent des emplois subalternes, difficiles et peu rémunérés11. Les grands-parents ou parents de ses adolescents en colère sont ainsi concernés par ces mesures qui dégradent davantage des conditions de vie des classes populaires déjà difficiles. Tout ceci produit un climat d’incompréhension, de trahison et de haine à l’égard de certains représentants politiques de premier plan (de droite et parfois de gauche), mais aussi à l’encontre d’élus locaux. Le fait de s’en prendre à des mairies ou à des élus en particulier matérialiserait en quelque sorte un sentiment de revanche à l’égard d’institutionnels que certains adolescents ou jeunes adultes estiment méprisants à l’égard de leurs difficultés12. Ces différentes « crises politiques » successives se déroulent dans un contexte néolibéral économique qui déstructure un peu plus chaque jour les services publics et les rapports sociaux entre citoyens de milieux sociaux modestes et institutions. Les adolescents évoluant dans des quartiers populaires urbains ressentent les effets économiques et sociaux, parfois de manière indirecte, en raison des difficultés subies par leurs parents, leurs proches ou dans leurs voisinages immédiats.
Enfin la mise en concurrence des classes populaires françaises constitue une nouveauté depuis les années 2010. La thèse « guilluyenne » qui oppose les classes populaires de territoires ruraux et périurbains très éloignés des centres-villes et donc des pouvoirs politiques, économiques et sociaux aux habitants des banlieues populaires ayant bénéficié des politiques de la ville et de rénovations urbaines récentes13 fait des « habitants de banlieue » paradoxalement des privilégiés du « système ». Cette thèse fortement mise en avant par l’extrême droite et désormais certains élus de droite a tendance à minorer les difficultés vécues par la majorité des habitants des quartiers populaires puisqu’appréhendés comme capricieux en comparaison de classes populaires également déprolétarisées, mais abandonnées dans des territoires isolés péri-urbains ou semi-ruraux. Cette thèse contribue au climat délétère à l’égard des habitants des banlieues dont les difficultés économiques, discriminatoires et sociales sont désormais occultées par une partie des élus en raison d’une comparaison plutôt fallacieuse entre les « bonnes classes populaires blanches » appauvries également, mais silencieuses et les mauvaises à savoir les habitants des cités, turbulents, « biberonnés » aux politiques de la ville et donc aux subventions d’État.
Repolitiser les colères juvéniles dans un contexte de délitement institutionnel
La question politique est d’emblée évacuée par les « discoureurs-tout-terrain » commentant sans cesse les scènes de violences des adolescents sur les chaines d’informations continues. Les discours moralistes et autres propos stigmatisants sur les parents emportent déjà l’adhésion des « chroniqueurs ». Néanmoins on note un changement important : l’appel des maires et accessoirement des élus de premier plan à faire front commun le lundi 3 juillet à midi sur le fronton des mairies directement concernées par les dégâts provoqués par les émeutes. En effet depuis le mouvement des « Gilets jaunes », les élus de la République se sentent directement menacés par les « colères populaires » de plus en plus récurrentes. Et les révoltes urbaines estivales ne font plus exceptions à la règle : des émeutiers ont agressé quelques élus comme le maire de l’Haÿ-les-Roses en Seine et Marne dont le domicile a été attaqué par une voiture bélier. Cet assaut constitue sans aucun doute la goutte d’eau qui fait déborder le vase chez nombre de représentants de la République qui se sentent désormais visés personnellement.
Certains adolescents ont visiblement participé à ces émeutes pour partager des sensations en groupe avec les copains et pour faire partie d’une aventure collective. Les premiers jugements à comparution immédiate s’étant déroulés quelques semaines après les émeutes, un certain nombre de procès-verbaux ont indiqué que certains adolescents ont participé activement aux violences sans connaître pour autant les circonstances réelles des événements déclencheurs à savoir la mort d’un jeune tué par la police à la suite d’un délit de fuite. Les travaux de Gustave Le Bon qui ont fait date sur la psychologie des foules pourraient ainsi à nouveau être mobilisés dans notre analyse. Mais la dimension psychologique a sans aucun doute montré ses limites depuis. En effet des travaux plus récents ont dévoilé l’idée que la participation active à des émeutes est une épreuve vécue comme un accomplissement politique pour les protagonistes en dehors du temps quotidien appréhendé comme un échec ou une soumission à un pouvoir ou des institutions perçues comme répressives, car les émeutiers sont confrontés à la réalité du pouvoir en se défoulant physiquement auprès des forces de l’ordre perçues comme les défenseurs d’un système appréhendé par les jeunes comme corrompu, injuste et inique. L’émeute permet ainsi à des adolescents évoluant dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville d’exprimer en un laps de temps très court leurs espoirs et leurs volontés14 malgré les risques encourus. Bien entendu certains adolescents n’ont pas participé aux émeutes dans un but révolutionnaire ou pour réformer la société, mais sans aucun doute dans une volonté tangible de s’affranchir des contraintes économiques, sociales, culturelles et identitaires qui structurent leurs existences quotidiennes confrontées à une école sélective, un marché du travail humiliant et une société de consommation exclusive et compétitive15.
Aussi il ne faut donc pas escamoter, une fois de plus, la dimension politique dans les agissements même violents ou « incivils » de certains jeunes de banlieue16. Ces comportements qualifiés d’« inqualifiables » par les discoureurs professionnels médiatiques et politiques traduisent quelques fois le désarroi quotidien des parents, les déceptions d’un voisin de palier parfois militant ou engagé dans une association de quartier ou l’amertume d’une sœur ou d’un frère aîné diplômé du supérieur, mais confronté durablement à la précarité. Et s’il n’y a pas consensus au sujet de la structuration politique des émeutes parmi les sociologues puisque certains les définissent comme « protopolitiques17 » en raison de l’absence de structure et de porte-parole, et d’autres comme « infrapolitiques18 » puisqu’inaudibles par les canaux politiques institutionnels conventionnels ou encore comme « métapolitiques19 » à cause de la volonté des émeutiers d’utiliser directement le langage des pierres, du feu et des mortiers en court-circuitant tout interlocuteur politique identifié comme tel car perçu comme illégitime, la question politique reste bien évidemment centrale. Derrière la volonté de beaucoup de jeunes d’en découdre à travers une confrontation risquée et physique avec les forces de l’ordre, l’intérêt pour l’émeute entend dénoncer un pouvoir politique humiliant, les réduisant à l’impuissance politique20 depuis plus de quarante ans maintenant.
1D. Lapeyronnie, « Révolte primitive dans les banlieues françaises. Essai sur les émeutes de l’automne 2005 », Déviance et société, 4, 30, 2006, p. 431-448.
2D. Merklen, Pourquoi brûle-ton des bibilothèques ?, Paris, Presses de l’Enssib, 2013.
3E. Marlière, « La marginalité juvénile à l’épreuve de la présence policière à Châtelet-les-Halles », Sociétés et jeunesses en difficultés, 17, 2016, p. 1-23, sejed.revues.org/8266
4M. Boucher, M. Belqasmi, É. Marlière, Casquette contre képis. Enquête sur la police de rue et l’usage de la force dans les quartiers populaires, Paris, 2013, L’Harmattan, coll. « recherche et transformation sociale ».
5E. Marlière, Les recompositions culturelles chez les jeunes issus de l’immigration dans une cité HLM de Gennevilliers, thèse de troisième cycle, Université de Paris 8, 2003.
6L. Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris, Plon, 1958 ; H. Rey, La peur des banlieues, Paris, Presses de Sciences-po, 1996.
7www.youtube.com/watch?v=2i4HHcL2cVM
8L. Mucchielli, « Le rap de la jeunesse des quartiers relégués. Un univers de représentations structuré par des sentiments d’injustice et de victimation collectives », in M. Boucher et A. Vulbeau (dir.), Émergences culturelles et jeunesse populaire. Turbulences ou médiations ?, Paris, L’Harmattan, p. 325-355.
9H. Seniguer, La république autoritaire. Islam de France et illusion républicaine, Lormont, Le bord de l’eau, 2022.
10Caroline Courty, Éric Marlière, « Des jeunes de rue d’un quartier populaire urbain à l’épreuve du confinement. Une mesure d’enfermement qui accentue le sentiment d’injustice », Pensée Plurielle, 53, 2021, p. 159-173.
11Si cet épisode douloureux n’est pas en lien avec l’état d’urgence en tant que tel, il s’est avéré particulièrement douloureux pour beaucoup de Français qui n’ont pas forcément digéré la manière dont le gouvernement a procédé avec le 49-3.
12E. Marlère, La France nous a lâchés ! Le sentiment d’injustice chez les jeunes de cité, Paris, Fayard, 2008.
13Voir notamment C. Guilluy, La France périphérique, Paris, Flammarion, 2013.
14R. Huët, Le vertige de l’émeute. De la ZAD aux Gilets jaunes, Paris, PUF, 2019.
15E. Marlière, « Les recompositions culturelles des « jeunes de cité » à l’épreuve des déterminismes sociaux et des effets du chômage, de la discrimination et de la ségrégation urbaine », Lien social et politique, 70, 2013, p. 103-117.
16E. Marlière, Les quartiers (im)populaires ne sont pas des déserts politiques. Incivilités ou politisation des colères par le bas ?, Lormont, Le bord de l’eau 2013.
17G. Mauger, L’émeute de novembre 2005. Une révolte protopolitique, Broissieux, Ed. du croquant, 2006.
18D. Merklen, Quartiers populaires. Quartier politique, Paris, La dispute, 2009.
19A. Bertho, Le temps des émeutes, Paris, Bayard, 2009.
20J. Talpin, Bâillonner les quartiers. Comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, Lille, Les Étaques, 2020.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)