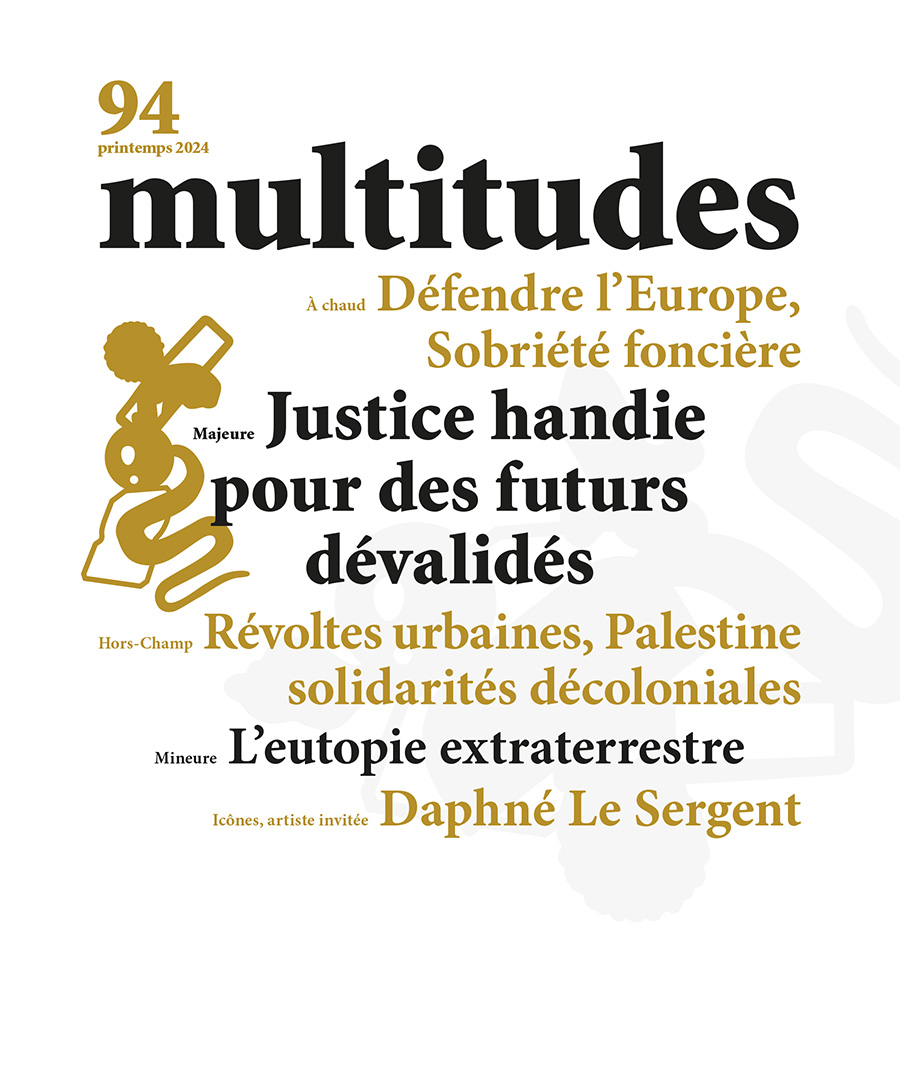Nous sommes nombres, parmi les autaires et pensaires de la SF, à appeler de nos vœux (et de nos expérimentations) des récits qui proposent d’autres choses qu’une structure héroïque (le fameux « monomythe » de Campbell). Différentes approches et appellations coexistent :
− Ursula K Le Guin parlait de « fictions paniers »
− Alice Carébadian d’« utopies radicales » (qui consistent à « créer des gouffres […] Infiniment »),
− Ketty Steward de « récits transformateurs » (considérés comme tels « en fonction de [leur] capacité à : Ouvrir des perceptions nouvelles, Rendre possible un futur, Coexister avec d’autres, Se combiner avec d’autres »).
Dans toutes ces approches, on retrouve une même insistance sur la pluralité. C’est-à-dire qu’au-delà même d’une diversité de représentation, un effort est fait pour penser, au niveau structurel de la narration, des parcours et des expériences multiples.
Ainsi, puisqu’ils doivent prendre en compte plusieurs dimensions, les récits transformateurs sont nécessairement à l’intersection des récits féministes, décoloniaux, queer, et crips. Cela ne veut pas dire qu’ils abordent toutes ces thématiques avec le même degré de détail. Mais même quand ils abordent un seul de ces enjeux, ils le font en ayant conscience que les autres existent.
Pour donner un contre-exemple : le roman Herland, de Charlotte Perkins Gilman, est réputé pour être une des premières utopies matriarcales. Paru en 1915, le livre est souvent présenté comme un classique de la SF féministe. Mais le monde idéal que décrit Perkins Gilman advient au sein d’une communité de femmes qui sont toutes blanches (elles vivent pourtant dans la forêt amazonienne, on ne peut pas imputer leur blancheur à un contexte géographique) cis (reproduction asexuée par parthénogénèse oblige), hétéro (celles qui sont attirées par d’autres femmes choisissent, comme les criminelles, de ne pas se reproduire), et valides (la « pureté » de leur lignage étant venu à bout de « toutes les maladies »).
L’ennui, c’est que pour être à l’intersection de plusieurs littératures, il faut que ces littératures existent. Or les SF handies/crips peinent à émerger, au point que même les récits qui parlent spécifiquement de soin ne laissent que peu (voir pas) de place à ses premierrs usagerrs, aka les populations les plus fragiles en raison du handicap, de la maladie longue, ou de l’âge.
Dans ce cadre, il est parfois difficile de se figurer à quoi la SF crip (et à fortiori la SF transformatrice) pourrait ressembler. Quelques pistes cependant se dessinent.
D’abord, la question du handicap ou de la maladie doit être traitée, non pas comme une métaphore pour parler d’autres maux, mais comme un sujet à part entière, avec ses propres enjeux. Il existe à ce compte quelques dystopies où les corps handicapés sont utilisés comme des ressources biologiques : Greffe de vie (Sonya Dorman), La réunion (Frederick Pohl et C. M. Kornbluth), Ventres d’Airain (Sylvie Miller) ou À crocs perdus (Lauriane Dufant).
Ensuite, le handicap pose nécessairement la question de la dichotomie entre le normal et le pathologique. Or la limite est loin d’être nette, ce que mettent en lumière des nouvelles comme Lozapéridole 50mg comprimée pelliculée (Ketty Steward) Et je lui donnerais pour nom Emmanuel (Jean-Pierre Fontana).
Enfin, certains textes proposent des sociétés alternatives, ou sont prise en compte la pluralité des personnes avec leurs neuroatypies, folies, handicap, maladies, difficultés ou traumatismes. Ainsi, la novela Résolution (Li-cam), met en scène une société créée par une personne autiste qui imagine la fin des discriminations. Centré sur le système de soin, le roman L’école des soignantes (Martin Winckler) ou la nouvelle Le dernier des possibles (Chloé Chevalier) proposent de repenser les relations soignantts/soignéés pour prévenir les violences médicales, grâce notamment à plus d’horizontalité et à la prise en compte du savoir des patientts.
Par ailleurs, le validisme étant au croisement de nombreux enjeux, ces propositions d’utopies crip bénéficient souvent à toustes.
Le texte qui, à mon sens, donne le plus remarquable aperçu science-fictif de toutes ces idées (et d’autres encore) est le roman de Marge Piercy, traduit tardivement en France : Une femme au bord du temps. On y suit une femme internée de force et maltraitée par l’institution psychiatrique raciste, homophobe et classiste. Et, en parallèle et en contraste, son évasion mentale dans un futur utopique basé sur le respect de la pluralité.
Les récits de science-fiction qui se saisissent des enjeux du handicap existent donc bien, et constituent peut-être les prémisses de cette SF crip et transformatrice dont, en tant que lectaire et autaire d’imaginaire, j’attends l’émergence.
Références
Carabédian, A. Utopie radicale : par-delà l’imaginaire des cabanes et des ruines, Seuil, 2022.
Le Guin, U. K. « La théorie de la Fiction-Panier » (1986), terrestres.org, 14 octobre 2018.
Steward, K. Le futur au pluriel : réparer la science-fiction, Inframonde, 2023.
Et à lire (en plus
des textes cités)
Elsa Sjunneson & Dominik Parisien (ed.) « Disabled People Destroy Science Fiction », Uncanny Magazine, #24, 2018.
Mia Mingus. « Hollow » in Octavia’s Brood. Science Fiction Stories from Social Justice Movements, (eds.) adrienne maree brown et Walidah Imarisha, Chico (CA), AK Press, 2015 ; traduit de l’anglais par Emma Bigé et Harriet de Gouge, multitudes.net, 2024.
Li-Cam. Visite, La Volte, 2023.
Sturgeon, Th. Les plus qu’humains, (1953), Gallimard, 1957.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther