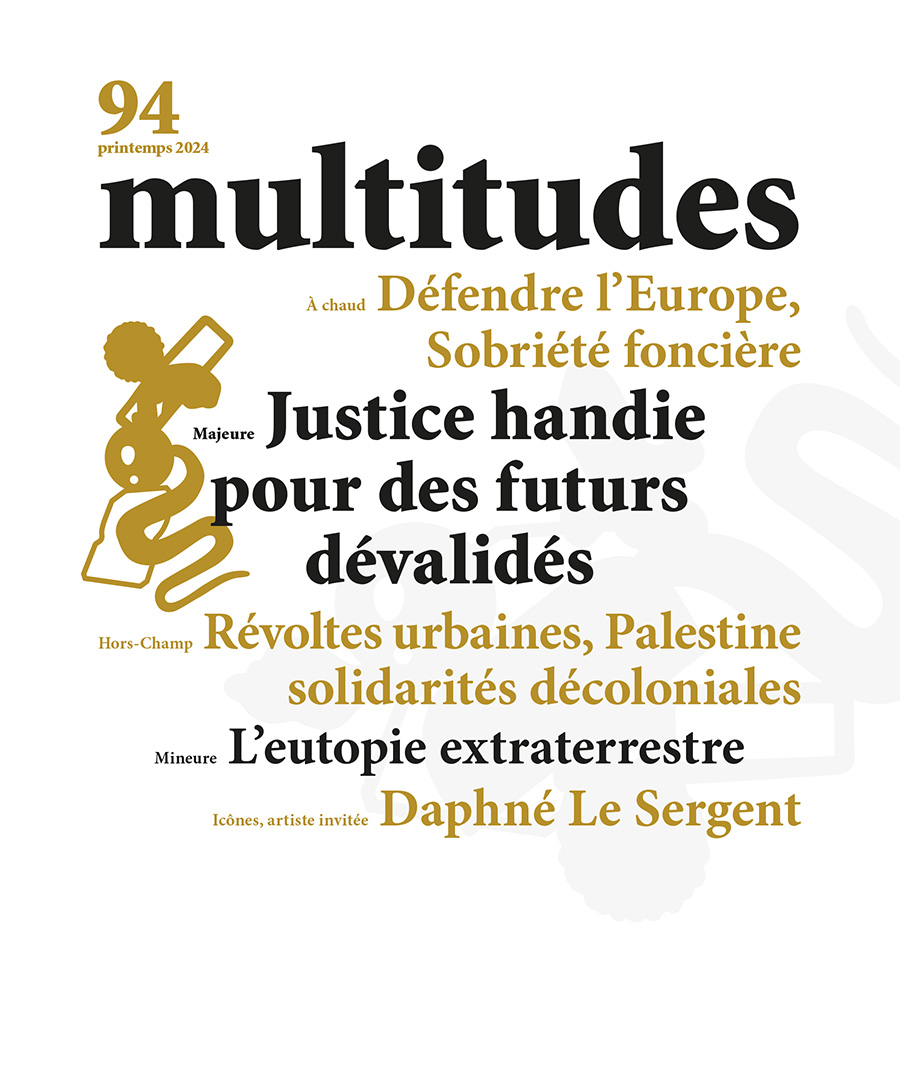Livre majeur de Kim Stanley Robinson, Le Ministère du futur est sorti en France fin octobre 2023. Cet écrivain de science-fiction californien y imagine un « ministère » mondial pour sauver l’humanité du désastre climatique d’ici le milieu du siècle, après les vingt millions de morts en 2025 d’une terrible canicule en Inde, avec aussi un terrorisme écologique et des mouvements d’opposition qui font peu à peu fléchir les banques centrales puis les gouvernements. Depuis Les Menhirs de glace en 1984 et sa célèbre trilogie martienne dans la première moitié des années 1990, Kim Stanley Robinson a toujours interrogé l’exploration spatiale comme moyen d’émancipation. Mais sur ce terrain de l’aventure extraterrestre, il est devenu de moins en moins optimiste au fil des enquêtes scientifiques qu’il mène pour ses livres, au point d’être aujourd’hui l’un des critiques les plus justes des rêves enfantins de colonisation de Mars d’Elon Musk. Nous l’avons rencontré le 4 novembre 2023, à l’occasion des Utopiales de Nantes, plus important festival de science-fiction en Europe.
Ariel Kyrou (Multitudes) : Pour la Majeure Planétarités du no 85 de Multitudes, Dominiq Jenvrey et moi-même avions longuement conversé avec Bruno Latour, et nous avions profité de cette occasion pour lui offrir la version poche de votre roman de space opera critique et écologiste Aurora. C’était en mars 2021, un an et demi avant son décès. Il ne vous connaissait pas et nous a confié alors ne pas lire de science-fiction. Pourtant, le 24 janvier 2022 au matin sur France Inter, voilà qu’il cite The Ministry for the Future, votre dernier ouvrage, à l’époque pas encore traduit en français. Vous-même, vous citez d’ailleurs dans ce livre la « théorie de l’acteur-réseau » de ce même Latour…
Kim Stanley Robinson : Ses deux essais La vie de Laboratoire (1979) et La Science en action (1989) ont été essentiels pour me permettre de comprendre, en tant qu’auteur de science-fiction, comment fonctionne le monde de la science. Et plus récemment, Face à Gaïa (2015) m’a inspiré pour trouver des réponses au « nouveau régime climatique ».
A. K. : Pourtant, dans Face à Gaïa, Bruno Latour apostrophe le capitaine Kirk, premier grand personnage de la série Star Trek aux côtés du Vulcain Spock : il écrit que le vaisseau Enterprise « doit rentrer au bercail », sur Terre donc, car dans l’immensité de l’espace intersidéral il ne trouvera rien de semblable à nous, humains, « seuls avec notre histoire terrestre et terrible ». Êtes-vous d’accord avec cette apostrophe de Latour au capitaine Kirk, vous dont beaucoup de romans évoquent les perspectives de l’exploration spatiale ?
K. S. R. : Aussi surprenant que cela puisse paraître, je suis globalement d’accord avec lui. Nous sommes des créatures biologiques, indissociables des écosystèmes, de la faune, de la flore et plus largement des agents de la Terre avec lesquels nous avons coévolué : comme je le montre dans Aurora, la vie est une manifestation planétaire. Lorsqu’ils arrivent à destination après deux cents ans de voyage, ceux des humains de l’arche spatiale de ce roman qui s’installent sur une lune de Tau Ceti dont l’atmosphère est pourtant comparable à la nôtre, sont décimés par une simple micro-protéine, qui se révèle pathogène pour l’espèce humaine. Il n’existe pas de planète B qui pourrait remplacer la nôtre pour l’Humanité : c’est ce que dit Bruno Latour, et c’est ce que je raconte également dans cette fiction.
A. K. : Il me semble en revanche que vous ne partagez pas la conclusion du film Ad Astra (2019) de James Gray avec Brad Pitt, comme quoi nous serions « seuls dans l’univers » ?
K. S. R. : Je pense en effet qu’il y a de fortes chances qu’il y ait d’autres vies, pourquoi pas « intelligentes », dans certaines des milliards de milliards de lunes et de planètes du cosmos, notamment dans notre galaxie, mais à des distances qui resteront à jamais pour nous incommensurables. Y créer des histoires, c’est comme se projeter dans la Terre du Milieu du Seigneur des anneaux de Tolkien, au cœur d’un monde de pure invention pouvant se révéler un passionnant miroir du nôtre. J’aime beaucoup, sous ce regard, les romans et nouvelles du cycle de l’Ekumen d’Ursula K. Le Guin. Ils se situent dans un très lointain avenir, bien postérieur à l’expansion de l’espèce humaine dans des planètes de la galaxie, au point que les civilisations de ces territoires désormais sans relations a priori les uns avec les autres ont toutes évolué de façon différente, sur les plans physiologiques autant que sociaux et anthropologiques, intellectuels et spirituels. Cette astuce remarquable de l’autrice permet d’imaginer les relations complexes entre des mondes et des individus totalement étrangers les uns aux autres, qui sont en quelque sorte cousins éloignés. Mais il s’agit de métaphores, de mondes d’imagination : d’un point de vue réaliste, les exoplanètes où se déroulent ces histoires nous sont en effet inatteignables et le resteront vraisemblablement toujours.
A. K. : Et ce d’autant que les atteindre suppose la découverte de l’ansible, une technologie permettant aux vaisseaux spatiaux de voyager à une vitesse proche de la lumière…
K. S. R. : Même le système de Tau Ceti, où va l’arche spatiale d’Aurora, à « seulement » douze années-lumière de la Terre, c’est-à-dire à deux pas de chez nous à l’échelle de l’immensité de l’univers, est une destination mille fois trop éloignée. La plupart des étoiles se situent à des centaines de milliards de milliards de kilomètres de nous. Si la distance d’ici à Jupiter était d’un centimètre, celle d’ici à Tau Ceti serait de l’ordre de milliers de kilomètres. Le système solaire, ce ne sont pas les étoiles. Notre voisinage, le seul potentiellement accessible, mais inhabitable en l’état, c’est Mars, Vénus, Mercure, les lunes de Jupiter, de Saturne ou de Neptune comme Triton, les astéroïdes aussi. C’est la raison pour laquelle mes romans n’interrogent pas la présence humaine au-delà du système solaire, à l’exception d’Aurora, justement pour raconter les impasses d’une aventure aussi lointaine.
A. K. : Sur un autre registre, vous condamnez les perspectives de « conquête » ou de « colonisation » spatiales, mais vous continuez néanmoins à défendre l’importance d’une « exploration » de l’espace, uniquement à des fins de connaissance.
K. S. R. : Contrairement à beaucoup de militants écologistes radicaux − comme je le suis moi-même − je ne pense pas qu’explorer l’espace ne soit qu’une distraction hors de prix. C’est un moyen d’étudier la Terre. L’idée de « coloniser » une planète littéralement empoisonnée comme Mars, d’en faire un refuge pour l’humanité, est absurde. En revanche, exactement comme nous le faisons dans l’Antarctique, il serait légitime d’y envoyer des scientifiques. Ils n’y seraient surtout pas des colons. Ils pourraient s’y relayer tous les cinq ans au sein d’une station, pour y étudier les multiples environnements en rapport aux nôtres et à l’histoire de notre planète. De fait, les humains sont de meilleurs scientifiques que les robots, plus agiles, à même d’improviser des solutions en fonction du terrain. Pour l’exploration des étoiles proches, à l’inverse seul un minuscule vaisseau spatial entièrement robotisé et à très grande vitesse, par exemple grâce à un dispositif laser, pourrait être envisageable. Pendant plus d’un siècle, cette sonde enregistrerait et prendrait des photos d’autres systèmes que le nôtre…
A. K. : Nous garderions donc les yeux levés vers les étoiles, sans en éteindre le rêve.
K. S. R. : C’est d’ores et déjà ce rêve que cultive le télescope James Webb, avec des résultats qui seront de plus en plus impressionnants, pour comprendre ce qu’est la matière noire, appréhender le Big Bang, ou pourquoi pas, comme le pense Roger Penrose, découvrir des mondes d’avant le Big Bang, etc. Nous avons énormément à apprendre de l’observation de l’univers, mais sans aucune nécessité de nous y rendre physiquement.
A. K. : La quête de connaissance que vous décrivez est de l’ordre de la science, mais ne doit-elle pas être complétée par un autre type de savoir : les songes, les images, les contes que tissent, pour nous humains, des « utopies extraterrestres » ? L’imagination d’ailleurs radicaux n’est-elle pas indispensable pour faire comprendre que sont envisageables d’autres mondes que ceux que les pouvoirs nous présentent comme les seuls réalistes ?
K. S. R. : J’espère bien, car c’est là l’ambition des utopies que j’écris. Ce type de fiction permet aux publics de réaliser que les choses peuvent être très différentes de ce que nous appelons « réalité », que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans un système capitaliste prédateur et extractiviste tel que le nôtre, et que nous avons les moyens d’agir pour que la société change. C’est la grande leçon de Fredric Jameson1, qui a été mon professeur et le directeur de ma thèse sur Philip K. Dick. Les autrices et auteurs ont la capacité de dessiner des horizons alternatifs, comme ceux de la société martienne de ma trilogie. Mais il y a des écueils. Mon roman SOS Antarctica décrit l’un d’entre eux : la création de ce que j’appelle des « utopies de poche », en l’occurrence ici dans le monde polaire. Car qu’est-ce qu’une utopie bâtie pour quelques-uns dès lors que le reste du monde reste dans la misère, sinon un espace pour privilégiés ? C’est pourquoi l’enjeu majeur est non seulement d’ébaucher les contours d’utopies situées, mais de construire des ponts vers des rivages de cet ordre : imaginer les circonstances, les conditions d’un passage vers un autre type de société, comme j’ai essayé de le faire dans Le Ministère du futur.
A. K. : Comme quoi les fictions peuvent créer des horizons alternatifs et des chemins pour les atteindre, ceux-ci changeant en retour ces mêmes horizons…
K. S. R. : Pour Fredric Jameson, l’une des missions les plus émancipatrices de la science-fiction est de dessiner des « cartes cognitives » à même d’aider le lecteur à imaginer des tactiques, des stratégies de changement. Ces cartes mentales nous aident à comprendre là où nous sommes, puis à nous orienter vers des destinations alternatives ainsi qu’à trouver ou creuser nous-mêmes des chemins pour nous en approcher.
A. K. : Vous concevez vos romans un peu comme de telles cartes mentales ?
K. S. R. : D’une certaine façon, car aucun roman ne peut dessiner concrètement une ou de telles cartes à lui tout seul. Il le fait avec d’autres textes, des actions aussi, etc.
A. K. : Est-ce pour nous aider dans ce type d’orientation que vous avez inventé dans 2312 une historienne fictive de l’un de nos futurs possibles ? Dans sa chronologie a posteriori de son année 2312, elle décrit 2005 à 2060 comme le temps de la « Grande indécision », puis il y a la « Crise » de 2060 à 2130 et enfin seulement le « Grand retournement » de 2130 à 2160, avec un rôle moteur de l’exploration spatiale dans cette douloureuse sortie de crise…
K. S. R. : J’ai écrit 2312 autour de 2010, dans l’idée d’imaginer un futur où l’humanité aurait trouvé des solutions dans le système solaire, mais aurait échoué à préserver les conditions d’habitabilité de la Terre. Avec le recul, il me semble que cette chronologie pêchait par excès de pessimisme. Même si nous allons vivre demain de rudes batailles contre les hordes du monde d’hier, avec en leur sein les défenseurs des énergies fossiles, je suis plus optimiste dans Le Ministère du futur, et je le suis plus encore depuis la défaite de Trump fin 2020 et la pandémie de Covid-19, postérieurs à l’écriture du roman. Il y a eu prise de conscience des dangers qui menacent notre biosphère, et l’humanité a enfin la capacité, dans les trente ans à venir, d’inverser la tendance au réchauffement climatique.
1Critique littéraire et théoricien politique marxiste qui utilise la science-fiction dans ses analyser et pour marquer l’importance et les modalités de grands changements de société.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther