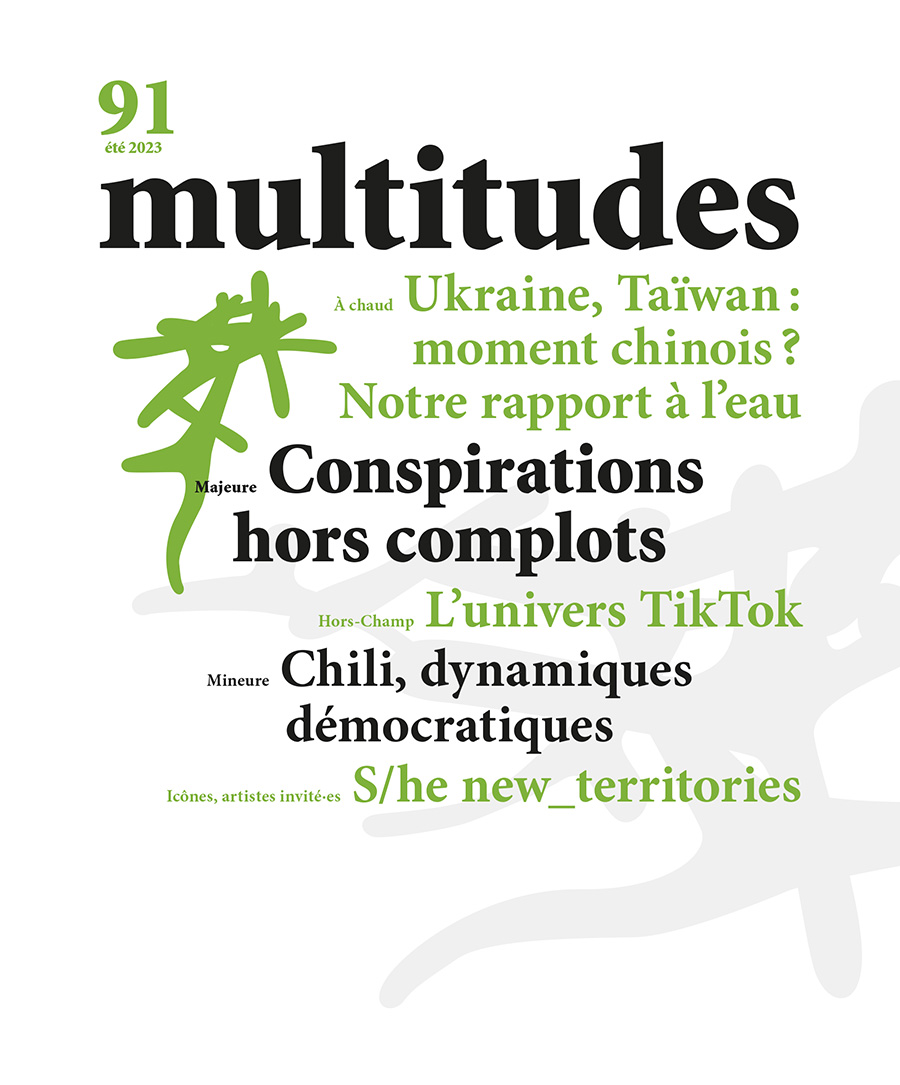Le 18 octobre 2019 est inscrit dans l’histoire contemporaine du Chili comme le jour où la précarité de sa structure politique a explosé et où des alternatives au sens social proposées par des marges de notre culture hégémonique se sont manifestées. Depuis lors, les lectures que nous pouvons faire du « commun » ont rendu indéniable l’hétérogénéité des visions, des identités, des discours, des pratiques politiques et éthiques qui composent le « Chilien ». Mais après la défaite de l’« Apruebo », le populaire, cet organisme anonyme et fragmentaire, qui produisait l’énergie nécessaire pour faire exploser le sens social, a été mis à nu dans sa condition la plus fondamentale : être un lieu de rencontre et non d’(auto)définition.
Au cours de cette période, le besoin d’expression historique et de participation de la dissidence, de la résistance et de la résilience de ceux qui ont été repoussés ou exclus du discours officiel, a confronté cette république aristocratique, fière de sa démocratie et de ses réalisations économiques, à l’épée à double tranchant de son arme la plus puissante : l’étalage massif de sa véritable complexité. Diversité dans l’expérience de la vie quotidienne, dans le caractère de ses revendications, dans les références culturelles de ses langues, dans la pertinence de l’éducation reçue, dans l’avenir imaginé, dans la violence incarnée, dans les dommages assumés, dans le silence accumulé, dans l’éthique de sa résistance, dans sa mémoire, dans la joie de ses festivités et dans la ritualité de ses deuils.
La normalité démocratique vénérée a été balayée par la volonté de participer à la (dé)construction symbolique de la réalité nationale. Les rues et les réseaux sociaux ont été déclarés territoire de coïncidence dans cette volonté, et la somme des désillusions civiles et des brutalités néolibérales a incendié des trains, des bus et des églises, pillé des supermarchés, des pharmacies et méprisé l’autorité de l’établi à partir de cette journée où elle mettait en marche les centrales électriques de la créativité populaire.
Le texte qui suit se veut un guide d’écoute du geste esthético-musical des communautés déployées dans la révolte sociale chilienne. Ainsi, en sélectionnant et en donnant accès à des exemples et des références de la production sonore des trois premiers mois de l’explosion sociale chilienne, il vise à penser les relations micro-politiques nécessaires pour que de telles productions puissent exister, circuler et participer à l’explosion sociale dans la plénitude de ses différences. Nous espérons avec ces écoutes contribuer à la compréhension de ce qui s’est passé dans notre pays, en rappelant que les forces du mouvement social ne sont pas seulement venues d’une prise de conscience soudaine du malaise, mais aussi des milliers d’instances communautaires qui ont mûri autour de leurs propres besoins, de leurs propres expériences et réflexions politiques, de leur éthique de travail et des gestes esthétiques auxquels elles participent.
Soixante-douze heures seulement après le début de la révolte sociale, l’artiste Ana Tijoux a publié sa première version de « Cacerolazo1 », une production audiovisuelle créée à partir des vidéos réalisées pendant les premiers jours de protestation et envoyées par ses partisans à la célèbre rappeuse nationale par l’intermédiaire des réseaux sociaux2. La collection d’images passe en revue de ce qui a traversé l’œil social pendant les premiers jours du processus. La nature privée des enregistrements (principalement des caméras de téléphones portables) a fait du montage de ces regards le geste artistique-créatif prédominant. Dans sa version finale, « Cacerolazo » ajoute des images d’archives qui complètent un cadre de références qui ont donné un sens à l’un des vers les plus vifs de la chanson et de l’histoire nationale contemporaine : « no son treinta pesos, son treinta años » (ce n’est pas trente pesos, c’est trente ans).
Un « Cacerolazo » est une protestation basée sur le bruit, un geste sonore qui cherche à briser le paysage acoustique de notre vie quotidienne, en le remplissant de cris de mécontentement, de revendications sociales, politiques et culturelles ; de mémoire historique, d’urgence civique, de rage et de joie populaire ; d’unité improvisée et soudaine dans l’action. Une tentative de mise sous pression sonore l’écoute de l’habituel, jusqu’à ce que celui-ci, puisse dénoncer le quotidien lui-même comme complice de nos maux. Et tout cela au son du métal des casseroles, des poêles ou du mobilier public ; d’un vieux tambour, d’une grosse caisse ou d’un sifflet. Tout ce qui fait du bruit et peut se rapporter à la tonalité musicale qui articule la protestation : Pum ! Pum ! PumPumPum !
Marmites et casseroles, cris, rires, sirènes de police, coups de feu, vendeurs ambulants, spectacles, troupes musicales, murmures de centaines de milliers de personnes : le son de la rue est redevenu un monde inouï.
Ce fut la matière première de la chanson d’Ana Tijoux et de centaines de productions d’artistes chiliens dont le travail offrait une possibilité d’autoréférence aux expressions et aux expériences de cette nouvelle vie quotidienne nationale qui s’était forgée au cours des premiers mois de la révolte. L’ analyse des paroles du « Cacerolazo » peut être considérée comme une continuité parfaite entre les cris, les chants et les revendications qui, chaque après-midi, secouaient les artères des villes du pays. Des agglomérations populaires spontanées, autoconvoquées et enregistrées par l’œil anonyme des citoyens, devenu l’espace où se partageaient de nouveaux affects, le moment où l’écoute était subvertie et surtout l’espace où l’appartenance n’était pas une dérivation de l’identité mais de la participation.
« Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne, qui est prêt à utiliser la violence et le crime sans limite3 ». Après quarante-huit heures de manifestations dans tout le pays, le président de l’époque Sebastián Piñera, flanqué du chef de la défense nationale de l’armée, a déclaré que l’État était en guerre contre un « ennemi puissant et implacable ». Ennemi qu’il n’a jamais situé politiquement, territorialement, culturellement ou idéologiquement. Son discours a officialisé la politique répressive avec laquelle le gouvernement chilien désorienté a affronté le mouvement social spontané, laissant un bilan historique de morts et de mutilations qui n’a fait qu’alimenter la tristesse et l’incendie.
La semaine suivant les déclarations présidentielles, le vendredi 25 octobre, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la Bibliothèque nationale (Santiago) pour interpréter la chanson « El derecho de vivir en paz » de Víctor Jara, en guise de réponse publique à l’action officielle4. L’ invitation à cette rencontre avec la musique de l’un des artistes les plus importants de la culture chilienne de résistance a été lancée par l’organisation du festival « Mille guitares pour Víctor Jara », un événement qui réunit chaque année des milliers de personnes pour interpréter son répertoire dans des formats instrumentaux géants composés aussi bien d’artistes confirmés que de citoyens intéressés dans son œuvre. Une choralité de rue formée par une histoire culturelle vivante et soutenue par la gestion d’une initiative partagée entre la Fondation Víctor Jara et une municipalité dotée de solides programmes de promotion de la mémoire, de la pensée et de la culture populaire (Recoleta)5.
Parallèlement, et sur la même musique, un groupe d’artistes nationaux, reconnus sur la scène locale et internationale, regroupés dans le collectif Musiciens du Chili, avec le soutien de la Fondation Víctor Jara, a lancé une version de « El derecho de vivir en paz » qui, en quelques jours, a atteint un millier de reproductions6. Les artistes invités proviennent de générations, de styles musicaux et de circuits de participation culturelle très différents. Cette version réunit des représentants de la Nueva Canción Chilena (dont Víctor lui-même est l’initiateur), le genre urbain le plus actuel, du hip-hop, de la cumbia, du rock, de la pop et des chansons d’auteurs-compositeurs-interprètes, mêlant le son traditionnel de la quena à l’AutoTune qui caractérise la Trap ; ou encore une variété de styles vocaux et une édition audiovisuelle qui finit par nous rappeler les singles de charité des années 80, tels que We Are the World. Les paroles de la chanson ont été modifiées afin de rendre la nouvelle version plus universelle, contingente et attrayante. Dans le texte original 7 (1971), le droit revendiqué de vivre en paix était évoqué en solidarité avec un peuple vietnamien confronté à la puissance militaire américaine ; mais le nouveau texte remplace toute référence à ce moment historique, et à ses résonances politiques, par des valeurs universelles telles que l’unité, la conscience, la dignité, l’éducation, la liberté et une invocation difficile à situer culturellement, territorialement ou idéologiquement : « un nouveau pacte social ». La massivité atteinte par cette version peut être pensée comme la somme d’un renouveau politique et conceptuel, de la renommée des artistes et du pouvoir rassembleur d’une œuvre qui a permis à des milliers de personnes de participer à cette choralité de rue. Les versions de rue n’ont cependant pas adopté ces modifications. Les interprétations spontanées entendues dans les marches ont continué à faire référence à la lutte de libération nationale vietnamienne et, un mois après la publication de la version des Musiciens du Chili, elle a été utilisée, avec la répudiation des auteurs, dans la propagande officielle du gouvernement bolivien de facto, au milieu d’un moment de violence politique qui a commencé avec l’éviction d’Evo Morales8.
Le cas de « El derecho de vivir en paz » en tant que chanson qui a rassemblé les sensibilités soulevées et déployées dans les rues du Chili n’est pas unique. L’ espace acoustique est devenu un lieu de récolte d’une autoréférentialité qui avait jusqu’alors habité l’écoute privée ou les concerts de masse, mais jamais l’espace public. « El baile de los que sobran9 » de Los Prisioneros, « Plata ta tá10 » de Mon Laferte, « El pueblo unido11 » de Sergio Ortega et Quilapayún, « Cacerolazo » d’Ana Tijoux et l’œuvre omniprésente de Violeta Parra que l’on entendait dans les comparsas et performances12 étaient des exemples de rencontre conçus et exécutés par des collectifs de personnes qui reconnaissaient dans cette musique une possibilité d’appartenir à un peuple en train d’exploser.
Mais comment cette participation devient-elle possible ? Quel type de savoir socialisé est nécessaire pour conquérir ces instances de rencontre ? Quels niveaux d’institutionnalisation sont nécessaires pour atteindre ces résultats sonores ?
Au début du mois de décembre 2019, un groupe de créateurs et de performeurs associés à la musique expérimentale et à l’art sonore a lancé un (auto-)appel à se réunir afin d’apporter une contribution sonore aux manifestations qui avaient lieu tous les vendredis sur la Plaza de la Dignidad (Santiago). L’ intention était d’ajouter à l’ennui et à la volonté de changement une création spontanée oscillant entre le bruit et l’improvisation libre : une barricade sonore13.
Au début, les invités appartenaient à un monde plutôt homogène qui, très vite, grâce à la systématisation des appels hebdomadaires à travers les réseaux sociaux tels que Whatsapp, Facebook et Instagram, s’est élargi pour inclure des musiciens d’autres horizons référentiels (folk, rock, jazz). Ainsi, inévitablement, les instruments de musique des performeurs ont fini par partager la rue et l’artisanat de l’inaudible avec les casseroles, les sifflets, les voix et les cris des personnes qui ont rejoint la barricade, devenant une partie du tissu organique de la protestation, un tissu qui s’est étendu dans son exercice sonore, s’est replié face à la répression policière et est revenu se jouer dans l’horizontalité du bruit.
À l’origine de leurs gestes esthétiques, vibrait l’Ethos qui canalisait les efforts de la Barricada Sonora. Rainer Krause commente ces principes : « On part d’un concept issu de l’improvisation libre, on écoute les autres et on essaie de contribuer à une scène sonore générale ou à un environnement sonore, sans que [personne] n’ait un rôle de leader particulier ou continu. Écouter les autres, accepter leurs interventions et y réagir14 » (Archives of Resistance, 2020).
Ces slogans éthiques sur l’écoute et la participation ont conduit cette Barricada à créer des pratiques de dialogue avec le matériel sonore d’autres collectivités. Cacerolazos, performances, fanfares, batucadas et supporters de clubs de football ont été leur contrepartie dans le dialogue sonore. Heureusement, la volonté d’organisation des participants à ce collectif a permis l’enregistrement et la publication de ces interventions15, ainsi que la systématisation de leur propre expérience dans des documentaires16 et des conférences sur la mémoire et les archives de l’explosion sociale.
Le geste collectif le plus médiatisé de l’explosion sociale, est probablement la performance « Un violador en tu camino » (Un violeur sur ton chemin) créée par le collectif féministe LASTESIS. Le 20 novembre 2019, en différents points du port de Valparaíso, les vers d’une chanson qui allait faire le tour du monde ont été entendus pour la première fois, convoquant dans l’espace public les corps et les voix de femmes qui dénonçaient en chœur la violence quotidienne dont elles font l’objet et l’impunité systématique. Cinq jours plus tard, le vendredi 25, le même jour de « Le droit de vivre en paix » devant la Bibliothèque nationale à quelques rues de là, cette performance basée sur l’œuvre de la théoricienne argentino-brésilienne Rita Segato a été créée et enregistrée dans la capitale avec la participation de ses créatrices17. L’ enregistrement a circulé sur les réseaux sociaux, la télévision publique et les réseaux internationaux de solidarité féministe jusqu’à ce qu’il soit adopté, traduit et joué par d’autres collectifs à travers le monde18.
Parmi les innombrables versions de « Un violeur sur ton chemin », nous aimerions partager celle qui a rassemblé plus de 10 000 femmes devant le stade national19. L’ invitation s’adressait aux plus de 40 ans, sans restriction, mais avec l’intention de rassembler une génération qui avait naturalisé la violence de genre et une autre disposée à lutter pour une transformation politique et juridique de cette société patriarcale. La performance a eu lieu devant le plus grand centre de torture et prison politique de la dictature et dans un contexte où la violence institutionnelle déchaînée contre les manifestants de l’explosion endeuillait à nouveau nos consciences. Les viols, les mutilations et les morts dénoncés par les organisations internationales étaient représentés par les vêtements noirs et les foulards rouges de femmes de tous âges qui résistaient par la danse et le chant. Dix organisations ont participé à la convocation du spectacle qui s’est déroulé dans le stade national. Que font ces organisations ? Comment sont-elles constituées ? À qui font-elles appel ? Quel a été leur parcours ? Combien de ces organisations ont été nécessaires pour rendre possible l’explosion sociale chilienne ?
En décembre 2019 la maison d’édition Cuaderno y Pauta a publié un livre intitulé « Se oía venir – cómo la música advirtió la explosión social en Chile20 » (« On le voyait venir – comment la musique a prévenu de l’explosion sociale au Chili »). Le texte, édité par le journaliste David Ponce, offre un récit journalistique collectif sur la manière dont la musique chilienne a participé au développement de discours politiques populaires au cours de nos « trente dernières années » de démocratie. Du hardcore-punk à la cueca21 féministe, de la musique électronique à la diversité des manifestations sonores de l’explosion sociale, le texte offre des références et des histoires sur les relations micro-politiques qui ont rendu possible une production symbolique si importante et si diverse et comment celles-ci, au cours de ces trois mois de lutte sociale, ont été capables de s’autoconvoquer et d’offrir un lieu d’appartenance22.
La participation collective à ces musiques a permis à notre peuple de créer, d’expérimenter et d’appartenir à ce nouveau quotidien jusque-là inaudible. L’ explosion a été un processus plein de possibilités pour incarner la transformation de l’espace public et la création symbolique, et pour expérimenter le collectif comme pouvoir social. Mais pour l’expliquer, la seule coïncidence des malaises collectives ou la crise de la démocratie représentative ne suffisent pas, comme l’ont prétendu nos analystes. La réactivité citoyenne au système économique et politique chilien existait déjà et s’est développée plus ou moins dans les mêmes termes depuis la « transition démocratique ». Nous voyons dans ces entreprises sonores la possibilité d’accorder un crédit aux structures communautaires qui ont soutenu la rencontre populaire dans les rues ; des structures communautaires fonctionnelles qui possédaient déjà leurs propres connaissances techniques, approches éthiques, référentiels esthétiques et expériences territoriales de participation et qui, déployées au fil du temps, avaient éduqué non seulement leur public mais aussi de nouveaux créateurs, managers, musiciens, danseurs, interprètes. L’ étude et la compréhension de ces petites entreprises collectives et communautaires permettent de s’interroger à nouveau sur la « défaite » du processus constituant. Selon notre analyse alternative, ce qui a permis à l’explosion sociale de mettre en échec la structure politico-culturelle peut être considéré comme la réapparition du populaire dans sa volonté de (re)construire sa propre histoire. Cependant, le populaire ne peut être dérivé d’un axiome idéologique, il n’est pas une somme de caractéristiques culturelles ou de revendications sociales, mais un organisme anonyme et fragmentaire qui s’appartient à lui-même dans la participation collective de ses pratiques et de ses gestes.
Les organisations, les réseaux, les pratiques et les loyautés qui ont rendu possible ce changement radical dans la culture chilienne sont encore en train de mûrir et continueront à le faire. L’ écoute de leurs créations peut nous permettre de participer à des futurs que nous ressentons comme nôtres.
1Les « cacerolazos » se sont répandues durant le régime militaire comme une manière invisible de manifester. Cela se faisait pendant les couvre-feux depuis les maisons, la nuit, en tapant sur des casseroles.
2Première version : https://www.youtube.com/watch ?v=tVaTuVNN7Zs. Version définitive : https://www.youtube.com/watch ?v=lItbHicquo4.
3Sebastián Piñera, domingo 20 de Octubre 2019. https://www.youtube.com/watch ?v=r8BrqEDLEIs
4« El derecho de vivir en paz » – Biblioteca Nacional. https://www.youtube.com/watch ?v=B0N0tYE6jg8
5Cartelera actual de la corporación cultural de Recoleta. https://culturarecoleta.cl/
6« El derecho de vivir en paz », Músicxs de Chile. https://www.youtube.com/watch ?v=wlfAf2AibA8
7« El derecho de vivir en paz », VÍctor Jara. https://www.youtube.com/watch ?v=6vi7wEH3pVA
8Comunicado público de rechazo – Fundación Víctor Jara. https://web.facebook.com/FundacionVJ
9« El baile de los que sobran » – Biblioteca Nacional. https://www.youtube.com/watch ?v=tMaJ3ctXoAI
10« Plata ta tá », Mon Laferte. https://www.youtube.com/watch ?v=J1JEjF5zR3E
11« El pueblo unido » – Plaza de la Dignidad. https://www.youtube.com/watch ?v=Cuzl_QTBlWI
12Arauco tiene una pena » – Plaza de la Dignidad. https://www.youtube.com/watch ?v=mtTXiiY5Cm0
« Miren como sonrien » – Barrio Yungay. https://www.youtube.com/watch ?v=N_jod-stP6k
13Barricada Sonora – Pileta Parque Bustamante. https://www.youtube.com/watch ?v=ONCj79E0OZY
14Rainer Krause (responsable del archivo de la Barricada Sonora) – ÉCFRASIS/ Patrimonio Comunitario ; cruces transdisciplinarios entre archivos y colecciones. ARCHIVOS DE LA RESISTENCIA : Barricada Sonora. https://www.youtube.com/watch ?v=YQXE4GoVnAs
15Barricada Sonora Chile – Archivo Souncloud. https://soundcloud.com/user-864271440
16« Barricada Sonora (el origen no es falla) » – https://www.youtube.com/watch ?v=_ku1ZR0BeLg&t=258s
17« Un Violador en tu camino », LASTESIS – Santiago 25 de noviembre de 2019. https://www.youtube.com/watch ?v=aB7r6hdo3W4
18« Le violeur, c’est toi », hymne de la lutte féministe. https://www.youtube.com/watch ?v=CVa9O2HRtyE
19« Un Violador en tu camino », LASTESIS – Santiago 4 de diciembre de 2019. https://www.youtube.com/watch ?v=fnpmOO5y4T0
20Ponce, D. (Ed.). (2019). Se oía venir – cómo la música advirtió la explosión social en Chile. Cuaderno y Pauta.
21Danse folkorique et populaire chilienne.
22« Despertar: Chile », Despertar. https://despertar4chile.bandcamp.com/album/despertar-chile
« Chile no está en guerra v.2 », varios artistas. https://chilenoestaenguerra.bandcamp.com/album/chile-no-est-en-guerra-v-2
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)