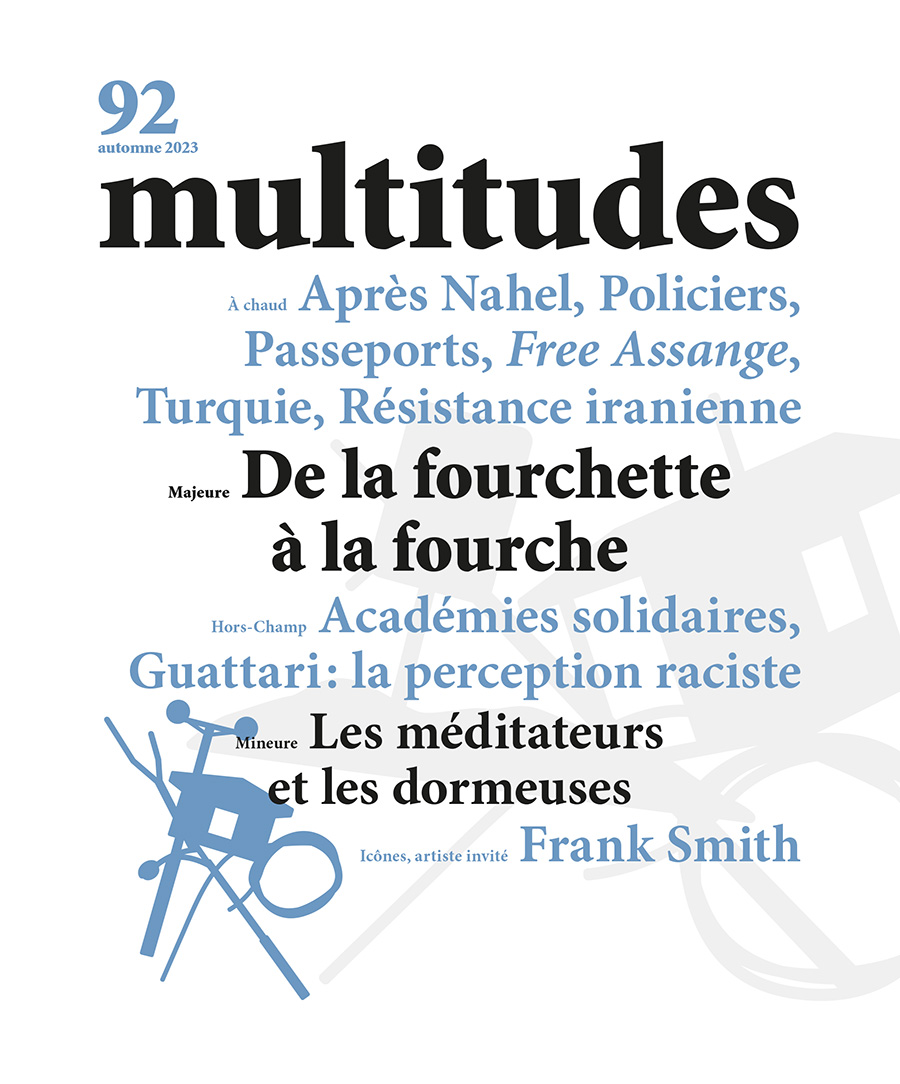En mai 2023, nous nous sommes rendux à Albi, en Occitanie, en prenant dans notre sac les pensées végétariennes de Jean Antoine Gleïzès1. Nous nous demandions ce qu’il restait, au pied de la Montagne qu’on appelle noire, de l’épopée pionnière du végétarisme qui y avait été décrite dans les premières années du XIXe siècle.
« Vers le midi de la France et parallèlement à la Méditerranée s’élève une chaîne de montagnes inculte et solitaire. Ses plantes, ses rochers, ses cavernes lui ont fait donner le nom de MONTAGNE NOIRE, qu’elle mérite encore par la profondeur de ses vallées, par le bruit de ses eaux, et par sa position qui la présente obliquement au soleil, et la dérobe pour ainsi dire à la lumière de cet astre. »
Le philosophe Gleïzès, au lendemain de la Révolution française, défendait l’idée que notre empathie envers l’humanité devait s’étendre aux animaux des autres espèces. En un mot, il ne fallait pas plus exploiter les bêtes que les humains et il fallait cesser de les abattre pour s’en nourrir. Il articulait souci d’égalité, abolitionnisme et végétarisme. Son frère Auguste était imprégné de ses idées ; il avait rejoint le groupe des Méditateurs et des Dormeuses à Paris et avait sans doute influencé leur mode de vie, importé l’abstinence de viande au sein du groupe d’artistes qui cherchait aussi à pousser plus loin la révolution commencée par Jacques-Louis David, mais restée inaboutie à leurs yeux.
« Je vous jure qu’il n’aura existé sur la terre d’homme véritablement juste que celui qui n’aura opprimé aucune créature. »
Or, une semaine avant notre départ, les Soulèvements de la terre diffusaient l’annonce d’une manifestation d’ampleur pour protester contre l’extension de l’autoroute entre Toulouse et Castres, au pied de la Montagne noire.
« 22-23 AVRIL –
CASTRES TOULOUSE –
SORTIE DE ROUTE POUR l’A69
Au pied de la Montagne noire, réservoir d’eau du sud du Tarn, une coulée de goudron menace de se déverser à travers la vallée du Girou. Le projet d’autoroute A69 Castres-Toulouse condamnerait 400 hectares de terres agricoles, de zones humides, de forêts et autres formes de vie. Un désastre environnemental pour un gain de temps dérisoire. Vieux de 40 ans, ce projet archaïque bordant une route nationale est un caprice du géant pharmaceutique Pierre Fabre, et est porté par des multinationales du BTP comme NGE et Vinci. Il est aujourd’hui soutenu par l’État, la présidente de région Carole Delga et le département du Tarn. »
Nous sommes arrivéx juste après la manifestation, mais les esprits sont encore tous à marcher sur le tracé destructeur de l’autoroute. Depuis plusieurs années déjà l’association La voie est libre tente de mobiliser et d’informer sur la construction de ce grand projet inutile, une autoroute qui suit le chemin d’une nationale, en détruisant les espaces végétaux et animaux sur son passage, sans apporter d’autre bienfait qu’une accélération de quelques minutes au trajet Castres-Toulouse, qui débouche directement sur les usines d’un grand groupe pharmaceutique et lui apparaît toute dédiée. C’est ainsi que l’histoire a rejoint l’actualité, et que nous sommes alléx à la rencontre des acteur·ices de la manifestation, des personnes qui fondèrent le premier restaurant végétarien d’Albi, des maraîchers et directrices de crèche un peu sorcières qui ont décidé de s’allier pour s’opposer au bitume par les légumes, en gardant notre épopée végétarienne et bucolique comme livre de chevet.
La montagne :
végétarisme des Lumières
Renan Larue, dans l’introduction de son Végétarisme des Lumières, expliquait son désarroi au début de ses recherches à l’École des Hautes Études. On lui reprochait le péché capital de l’historien : l’anachronisme. Il prêtait aux écrits compatissant envers les bêtes d’abattoirs qu’on pouvait lire sous la plume de Voltaire ou Maupertuis un projet politique qui n’avait jamais existé avant une époque récente. Cela ne nous a que davantage donné l’idée de le suivre. Certes, Larue l’admet bien volontiers, les propos végétariens sont plus fréquents que les actes. Les débats qui ont animé les études voltairiennes autour du végétarisme du philosophe ne sont finalement qu’à la mesure de la dimension conflictuelle des questions végétariennes (sans même parler du véganisme) dans notre société.
Voltaire écrit bien dans les questions sur l’encyclopédie :
« Viande vient sans doute de victus, ce qui nourrit, ce qui soutient la vie ; de victus on fit viventia, de viventia viande. Ce mot devrait s’appliquer à tout ce qui se mange ; mais par une bizarrerie de toutes les langues, l’usage a prévalu de refuser cette dénomination au pain, au laitage, au riz, aux légumes, aux fruits, au poisson et de ne le donner qu’aux animaux terrestres. »
Sa fascination pour Pythagore et pour les hindous et leur capacité à étendre le domaine de la compassion n’était pas seulement de la philosophie comparée, car dans un texte obscur, « le dialogue du chapon et de la poularde », il se mettait à la place de ses bêtes de nos fermes castrées pour être engraissées.
« La poularde : Eh bien,
quand nous serons plus gras,
le seront-ils davantage ?
Le chapon : Oui, car ils prétendent nous manger.
La poularde : Nous manger, ah les monstres !
Le chapon : C’est leur coutume. »
Après notre retour d’Albi, nous avons encore essayé d’évoquer le sujet avec le conservateur du château de Voltaire à Ferney, qui a balayé ces arguments d’un revers de main, en assurant que Voltaire n’avait plus de dents et avait mangé de la purée dans ses dernières années, mais que cela ne constituait absolument pas un projet philosophique. Tandis que les Voltairiens actuels se disputent pour savoir si le penseur défendait la compassion pour les bêtes comme pour les humains, ou bien ne se souciait que de sa petite santé, d’autres auteurs de sa lignée philosophique faisaient assurément en sorte de conformer leur mode de vie avec leur empathie. Gleïzès en fait partie. Ses Nuits élyséennes, mi-épopée mi-dialogue philosophique, sont le récit d’une rencontre entre le narrateur et un ermite de la montagne noire, qui lui-même a été converti par un sage ne se nourrissant que de plantes lors de ses voyages.
« J’allai à la recherche de quelques plantes et de quelques fruits sauvages ; je ramassai sous le sable salé des racines plus douces que le miel et pleines de parfum ; je cueillis aussi quelques branches de fenouil marin, et du pourpier de nos bocages ; j’y joignis quelques raisins de mer, dont les grappes rouges brillaient sur le sable à quelques pas de nous. En faisant ce modeste repas le vieillard me parla avec une espèce de vénération des plantes considérées comme nourriture de l’homme : il était enflammé de colère contre ceux qui déchirant de leurs cruelles mains les entrailles des animaux, sans être pressés par la faim, sans être tourmentés par la soif, se nourrissaient de leur chair et s’abreuvaient de leur sang. Il faisait découler de ce funeste repas tous les maux qui affligent la terre ; il soutenait que si l’homme s’était contenté des présents que lui offrait la nature, les sources de sa vie auraient coulé dans ses veines comme le ruisseau sur l’herbe des prairies, et non comme le torrent sur des rochers. Les plantes, disait-il, sont le premier aliment de la vertu. »
Lorsque nous sommes arrivéx à Albi en expliquant que notre enquête portait sur une histoire albigeoise du végétarisme, nous avons entendu plusieurs variantes de
« On ne peut être albigeois sans manger de saucisse ! »
Mais nous connaissions l’histoire plus ancienne de l’abstinence de viande de celles et ceux qu’on appelait les Albigeois, pendant la terrible croisade des années 1209-1229. On dit que certains inquisiteurs piégeaient bons hommes et bonnes femmes en leur demandant de plumer un poulet. En cas de refus, la suspicion de pratique hérétique s’imposait.
Le tournesol : le végétarisme des hippies
Nous nous sommes rendux dans le restaurant végétarien d’Albi (il n’y en a qu’un seul). Les fondateur et fondatrice s’appellent Jacques et Sally Pignet. Sally est londonienne, et Jacques parisien. La première connaissait le mouvement, déjà bien implanté à Londres depuis la fin du XIXe siècle, mais c’est Jacques qui s’est converti en premier.
« Jacques : À Paris en 1968, il y avait une dizaine de restaurants végétariens. Le macrobiotique a eu une influence énorme.
Sally : On s’est installés dans l’Aveyron, comme cela arrive périodiquement, les gens voulaient quitter Paris et s’installer à la campagne. Et tout le monde mangeait du riz complet.
Jacques : En tous cas, ça a été comme un choc. Une vie nouvelle. Il faut se remettre dans le contexte de Mai 68. Pour les gens qui imaginaient un vrai changement, cela a été un échec. Les espoirs étaient tels, qu’on a eu l’impression que sur le moment il ne s’était pas passé grand chose même si les idées ont infusé petit à petit. Donc le végétarisme c’était une ouverture vers quelque chose de différent, sur le plan personnel, médical, éthique, à la fois ordinaire et politique. »
Jacques et Sally nous ont raconté avoir vécu une révolution personnelle dont il et elle ont compris ensuite qu’elle correspondait à un mouvement politique plus large, celui des communautés hippies, spirituelles, végétariennes, néo-rurales, celle de ces gens qui n’allaient pas tous dans le Larzac mais « arrivaient de partout » pour vivre à la campagne, faire 68 dans les champs plutôt que sur les pavés parisiens. Et le restaurant n’est arrivé que plus tard, en 1984, lorsqu’il et elle avaient fait le tour de leurs activités d’alors, la fabrication de jeux en bois. Ce restaurant, on leur a dit qu’il ne marcherait jamais, et pourtant tout de suite, tout le monde y est venu. On y goûtait des pâtisseries anglaises, des produits frais, et on s’y initiait au végétarisme. Surtout, nous disent Sally et Jacques, c’était un restaurant de femmes. Il n’y avait pas que des femmes, mais elles s’y sentaient à l’aise, il apparaissait comme à l’abri du harcèlement et des micro-agresssions. Sally et Jacques ont pris leur retraite, et gardent encore un souvenir ému de la petite communauté qui s’y était créée.
Le potager :
des légumes, pas du bitume
Castres est une ville tranquille et aisée, dont le musée vient d’être rénové pour accueillir les collections consacrées à l’art espagnol, autour d’une série d’estampes de Goya. Aux alentours, des terres agricoles, des maisons, une réserve naturelle et un laboratoire pharmaceutique. Depuis plusieurs années, au fil des dévoilements du tracé de l’autoroute, des habitantes et habitants ont découvert qu’une voie ultra rapide passera près de leur jardin, que des platanes centenaires seront abattus, privant de leur habitat les mésanges, que le terrain de jeu des enfants au sein de la réserve naturelle du Dicosa sera traversé par le chantier. Des collectifs se sont montés et ont mené la résistance. La Voie est libre regroupe les riverains affectés par les travaux. Le Groupe National de la Surveillance des Arbres compte les platanes victimes du chantier. L’Envol vert, association conseillère en agro-foresterie, travaille à diffuser les projets agricoles non destructeurs et a participé à la mobilisation auprès des agriculteurs et agricultrices concernées. Quelques grimpeuses ultra courageuses sont montées sur les abatteuses, énormes machines qui tronçonnent un arbre en quelques dizaines de secondes, tandis qu’un militant vivait accroché en haut d’un autre pour le sauver.
Et le 22 avril 2023, 8500 manifestantx se sont comptéx. Elisabeth nous a raconté une foule passant silencieuse à travers bois, pour ne pas déranger les oiseaux. En arrivant sur un tronçon de bitume, un homme a pris un bâton et fait résonner la glissière métallique en frappant dessus. Il a transformé l’aménagement autoroutier en instrument de musique. Les mains ont battu au rythme de milliers de Siamo tutti antifascisti, tandis qu’un mur de parpaings était monté en quelques instants. Une course de bolides carnavalesques et bricolés s’est élancée pour venir se fracasser contre le mur de parpaings. Le bolide le plus lent fut déclaré vainqueur.
Les manifestantx ont fait la fête et partagé un repas préparé avec les légumes des champs alentours. Et au lendemain de la manifestation, des maraîchers se sont réunis pour planter un potager qui occuperait mieux le tracé de l’autoroute qu’un mur de parpaings. Derrière l’écriteau « plus de légumes, moins de bitume », Lucille, Fanou et les habitantx du quartier se relaient pour arroser les tomates et soigner les betteraves, vérifier que le noisetier se développe et diffuse ses mycorhizes pour la santé du sol. Nous parlons à Lucile des Méditateurs et des Dormeuses, de la dissolution de leur groupe, de la contestation réprimée par le régime, en pensant à l’emprisonnement de Charles Nodier en 1803, poète et membre du groupe, pour sa satire antibonapartiste. Elle nous dit : « J’ai l’impression que ça peut nous arriver ». Non pas qu’elle attende un modèle de ce que nous lui racontons, elle n’a certainement pas besoin de nous pour cela. Mais elle lit ses événements du passé au prisme de ses luttes actuelles. Les soulèvements sont anachroniques parce qu’ils défient l’histoire, la prennent à rebours, s’en écartent et la réactivent.
Jean Antoine Gleïzès, Les nuits élyséennes, Paris, Didot, 1800
Renan Larue, Le végétarisme des Lumières, Paris, Garnier, 2019
Les soulèvements de la terre, appel de la saison 5, lessoulevementsdelaterre.org/blog/appel-saison-5
Voltaire, « Viande », Questions sur l’encyclopédie, 1770-1772
Voltaire, Le dialogue du chapon et de la poularde, Dialogue de cour, 1763
1Nous remercions le Centre d’art Le Lait à Albi pour son accueil chaleureux.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther