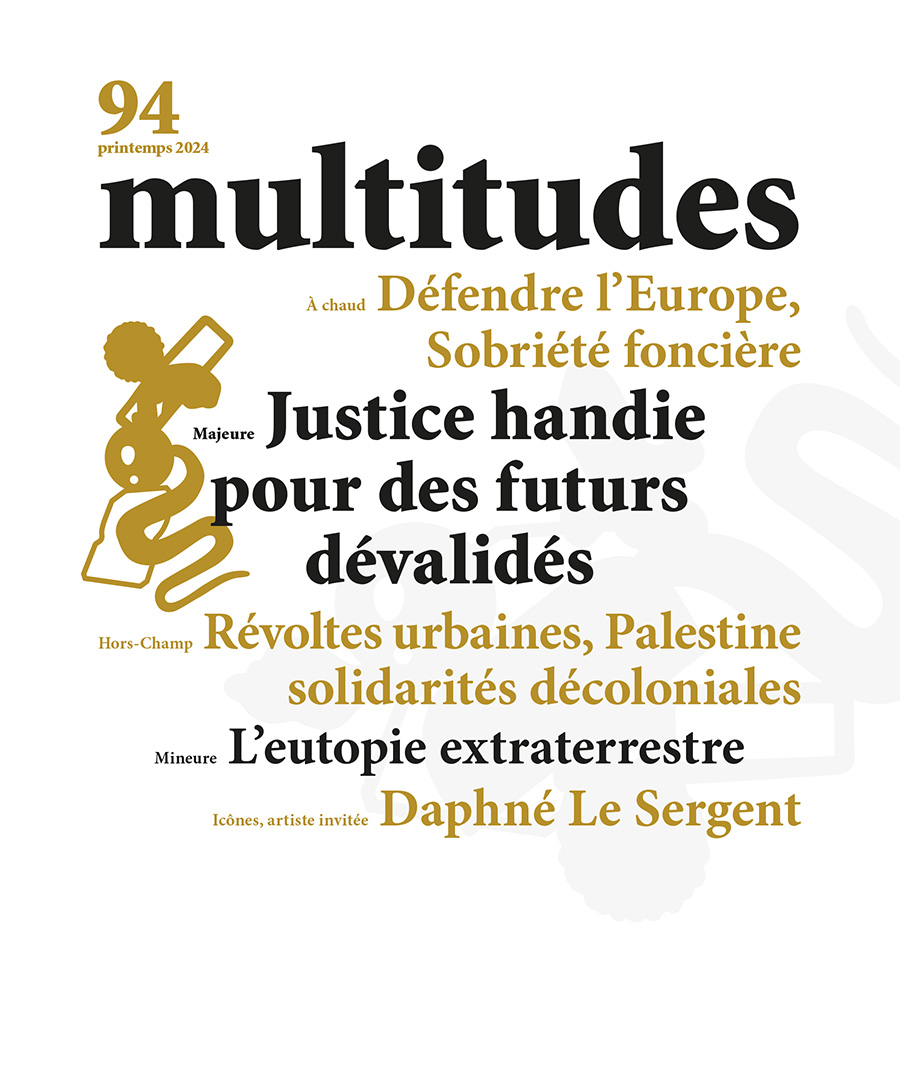Frictions crip, dimension crip
Les thématiques crip liées aux sciences et technologies − telles que les études crip des médias (Mills et Stern 2017), des plateformes (Shew 2023) et des technosciences (Hamraie et Fritsch 2019) − dépassent le seul domaine du handicap. Ces approches résonnent en effet avec un « air du temps », une lente « invalidation » des récits par lesquels le sujet humain occidental organise son corps et ses organes. Comme le rappellent les théoriciennes crip Aimi Hamraie et Kelly Fritsch ces assemblages de récits et de technologies « façonnent l’expression, l’activation ou l’élimination du handicap, de la déficience, de la folie, de la surdité, de la neurodiversité, des conditions chroniques et de la maladie » (Fritsch et Hamaraie 2019, p. 3). La distinction entre handicapé et non-handicapé n’est ainsi ni donnée de fait dans une essence organique (modèle médical du handicap) ni seulement construite socialement par une décision de la société (modèle social du handicap) : elle est construite de manière sociotechnique, par un assemblage de récits et de technologies. Il semble, aujourd’hui, que plus en plus d’humains a priori valides perdent leur statut de validité, ou tout du moins n’aient plus la capacité physique de répondre aux demandes exprimées par cet environnement sociotechnique.
Les luttes crip conçues comme « positions radicales non assimilationnistes invoquant le handicap comme partie entière et désirable du monde » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 2) peuvent ainsi autant renvoyer à l’accueil des individus différents d’un nous (les crip dans leur identité politique et médicosociale) venus d’un ailleurs (espaces protégés, institutions médico-sociales etc) qu’à l’accueil d’une différence qui monte en nous, dans le hic et nunc de ce que Fritsh et Hamraie nomment des « frictions » entre les corps et les dispositifs sociotechniques censés nous encapaciter : « les crip technosciences reconnaissent les contextes non-innocents au sein desquels la connaissance et l’accès émergent […] À la suite de Haraway, nous proposons le projet crip technosciences mettant en tension les impératifs inégalitaires de l’innovation technoscientifique avec les capacités transformatives effectives de ces technologies permettant de façonner la matière et le sens par leur usage. » (p. 22)
Ici loin de nous l’idée de lisser les différences entre personnes handies et non handies et de prononcer l’avènement d’une communauté « universelle ». Les personnes identifiées comme handies sont exposées à des violences et cyberviolences, et des discriminations difficilement comparables (validismes) − violences elle-mêmes amplifiées par de nombreux facteurs intersectionnels. Le handicap aussi n’est pas une simple abstraction qu’un changement de contexte sociotechnique suffirait à dissiper : c’est un vécu corporel et psychique, fruit d’une articulation complexe du biologique et du social, résultat mixte de besoins individuels et de politiques d’accessibilités (Bailey 2019, Puiseux 2022). C’est dans le but de préserver ces spécificités des frictions handies, et notamment celles liées à l’accessibilité, que nous avons privilégié un dialogue entre les luttes crip et la notion de dispositif. De cette manière nous pouvons plus précisément identifier cette dimension crip qui monte même chez les humains dont le corps est, a priori, « disponible », prêt à l’emploi, et pour qui le monde semble être, à première vue, « accessible ».
Frictions crip : corps fonctionnels, corps indisponibles, corps non-conformes
La première friction que nous rencontrons est liée à la multiplication d’expériences d’indisponibilité, alors même que tout autour de nous tend à devenir dispositif (ou à être présenté sous cette facette). Les technologies censées nous encapaciter tendent à devenir indisponibles.
Tout d’abord il semblerait que l’accélération et l’automatisation des échanges dans un système néo-libéral rendent obsolètes le cerveau humain et ses capacités de traitement de l’information (Rosa 2012). Brain-fog, dissociations soudaines, et autres voiles cognitifs peuvent être la conséquence de contagion (Covid long par exemple). Mais la sensation ne pas pouvoir disposer correctement des choses, des autres et de soi-même, de devenir maladroit, oublieux, empoté ou amnésique − mémoire et mouvement inaccessibles − s’accroit à mesure que les assemblages cybernétiques et maintenant algorithmiques construisent l’image d’un sujet-utilisateur idéal, performant, multi-tâche, produisant des effets de surchauffe (Chabot 2013), d’épuisement (Salomon 2012). Le sujet fonctionnel (qui peut fonctionner et faire fonctionner) est un bien de plus en plus inatteignable, ce qui produit en retour une extension des écarts à la norme neurocognitive (Chapman 2022).
Mais cette indisponibilité n’est pas qu’un effet de loupe. Nous avons de plus en plus besoin d’assemblages sociotechniques pour assurer nos fonctions biologiques (dormir, communiquer, se déplacer) et pour le développement de nos capabilités (Nussbaum 2010). De plus en plus de ces capabilités sont déterminées par les normes industrielles de développement de ces technologies : celles-ci construisent des normes de validité en lien avec l’image de l’utilisateur idéal (Mills et Stern 2017). Certes les réveils, trottinettes, billets dématérialisés, applications immobilières, sites de rencontre, réseaux sociaux sont exposés aux ratés et ratages, lags, bugs et ralentissements, controverses, piratages etc. Mais ils sont surtout destinés à un corps prototypique valide, à un corps théorique mesurable et chiffrable : cet écart entre le modèle utilisateur des industries des médias et des technologies et les réalités sociales et organiques des utilisateurs engendre des effets de dis-médiation (Mills et Stern 2017). La standardisation des équipements technologiques engendre moins une multiplication des ratages qu’elle ne révèle la nature profonde du couplage corps-environnement technique : un couplage de travers (dys-) provoquant bugs, lags, abandons, et autres troubles non-conformes.
Pour les luttes crip, cet « usager non-conforme », dont le corps témoigne de troubles et utilise les technologies de façon trouble, est une figure centrale de la lutte contre le néo-libéralisme : « Il ne s’agit pas d’une tentative d’intégration (comme dans l’approche libérale des droits des personnes handicapées), mais plutôt de l’utilisation de la technologie comme moyen de friction contre un environnement inaccessible » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 11). Corps inaccessible et usager non-conforme sont ainsi les deux pôles d’une reconfiguration des dynamiques de pouvoir dans un contexte d’accélération des échanges : celle-ci modifie nos capabilités et déplace la ligne entre le valide et l’invalide.
Frictions crip : mondes performants,
mondes jetables (disposable), mondes défaits
Consécutivement, nous avons la sensation, peut-être extrême mais de plus en plus fréquente, d’être disposable (au sens anglais de « jetable ») : d’être un objet dont on peut se débarrasser au moindre dysfonctionnement. Cette sensation n’est pas la conséquence d’échecs localisés et individualisés, mais bien d’un faire-monde, d’un système de sens et d’habitus faisant que « les technologies, les architectures et les infrastructures sont souvent conçues et mises en œuvre sans que le handicap soit considéré comme une différence qui compte (en tant qu’elle se matérialise « that matters ») » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 2). En effet, la miniaturisation des dispositifs et leur implémentation dans les rituels de la vie ordinaire intègrent les logiques de calcul et de performance à tous les aspects de la vie neurocognitive de cette différence qui compte / se matérialise : les termes de capitalisme de plateforme (Srnicek 2011), capitalisme émotionnel (Illouz 2018), capitalisme cognitif (Berardi 2014), capitalisme attentionnel (Citton 2014) ou encore capitalisme de surveillance (Zuboff 2019) traduisent différents aspects de ce capitalisme neurocognitif, de cette exploitation des capacités de mémorisation, d’imagination, d’anticipation, de création du corps et leur marchandisation. Dans ce contexte, de nombreux dispositifs disciplinaires, industries de la performance et de l’augmentation, visent à appuyer à nouveau la ligne entre valide et invalide, à réinstaller une frontière entre ces deux mondes (McRuer 2018).
Dans ce contexte, les sensations de bêtise, d’amnésie, de dyscommunications et de troubles, consécutive à l’évaluation des capacités linguistiques et cognitives de chacun dans et par des technologies liées au langage (réseaux sociaux numériques notamment), peuvent être perçues non comme des ratés du corps, mais comme des actes de résistance à ce faire-monde capitaliste, comme une manière de tenir en échec l’industrie de l’augmentation. Ce sont des « pratiques qui poussent les technosciences au-delà de l’approche militaro-industrielle et les font basculer dans le règne de la résistance et du refaire-monde.» (Hamraie et Fritsch 2019, p. 5). Ces ratés sont une brèche par laquelle un monde se démantèle (world-dismantling) et par laquelle un autre monde se reconstitue à la force du corps, des bras, du cerveau : réinventer des manières d’aller dans la rue, de prendre les transports, de parler, de regarder l’autre, de le toucher.
Mais il ne s’agit pas seulement d’un changement de « représentations » : il s’agit bien là d’une activité manuelle visant, littéralement, à faire et défaire le monde. Nous pensons aux gestes du stimming des militants de la neurodiversité : ces gestes de la main visant à réguler des sensorialités atypiques, ressentis hyper- ou hypo-sensoriels. Ces mouvements sont certes des critiques des normes gestuelles dans l’espace public mais ce sont aussi des grammaires gestuelles, des manières de refaire-mouvement et de refaire-monde (Bascom 2011, Yergeau 2021) : des manières de faire-lien et d’incarner un corps dont les mouvements échappent à la catégorisation binaire entre sain et pathologique, non-handicapé et handicapé. Par cette manifestation, le corps est rappelé à sa dimension de régulation sensorielle : une dimension occultée par la recherche de performance de ce capitalisme neurocognitif.
Frictions crip : liens accessibles, liens indisposés, liens solidaires
Or malgré le fait que nous soyons de plus en plus indisponibles, il semblerait que nous soyons de plus en plus seul·e·s dans nos indisponibilités. L’indisponibilité des corps engendrerait des troubles de la communication qui engendreraient de fait des troubles de l’interaction sociale, et réciproquement.
Nous avons de plus en plus la sensation d’être in-disposé·e : sensation d’égarement et de solitude, d’être posé·e nulle part, loin de tous et de toutes, d’être seul·e confronté·e à une condamnation que notre propre corps s’inflige à lui-même. Le doomscroll des réseaux sociaux qui nous tire sur un fil d’actualité infinie, la dissociation interfacée et le Zoom fatigue lié à l’usage intensif du distanciel, ou encore la sensation de désespoir et d’impuissance face aux crises sanitaires et écologiques, ne sont pas uniquement difficiles pour nous, ils nous indisposent vis-à-vis des autres : elles font des autres corps, de leur récit (réseaux sociaux), de leur visage (Zoom), de leur corps (Covid), la source de notre fatigue cognitive et sensorielle.
Cette illusion de solitude face à l’indisponibilité de son propre corps est en grande partie renforcée par la réponse en termes d’accessibilité. L’approche universelle de l’accessibilité via le design d’accessibilité, comme l’approche individuelle via les aménagements sur mesure, visent à intégrer le handicap au « faire-monde » néolibéral et en partie validiste (Mills et Stern 2017). Mais la culture de l’accessibilité n’a pas seulement un effet indirect sur la structure globale des systèmes de pouvoir, elle a aussi un effet direct sur la culture handie elle-même : « En soutenant les futurs accessibles, nous refusons de traiter l’accès comme une question de conformité technique ou de réhabilitation, comme une simple solution technologique ou une liste de contrôle. Au contraire, nous définissons l’accès comme étant collectif, désordonné, expérimental, frictionnel et génératif. Les futurs accessibles exigent notre interdépendance » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 21).
Cette citation ne veut pas dire bien sûr qu’il ne faut pas développer des technologies accessibles et qu’il faudrait poétiser l’exclusion sociale des personnes handies. Il s’agit de voir que l’accessibilité, telle qu’elle est conçue aujourd’hui, ne permet pas à la plupart des personnes handies de participer à la socialisation et qu’elle contribue en partie à l’appauvrissement des savoir-faire de l’accès « collectif et désordonné ».
Le collectif auquel Fritsch et Hamraie font référence est bien plus qu’une communauté d’intérêts ou de cœur. C’est une façon spécifique de faire-lien, d’être en compagnonnage (Haraway 2019). On pourrait soutenir en appui à l’approche de Timothy Morton que les crip développent une forme de solidarité (2019) : une manière de vivre avec des liens qui n’apportent pas de bénéfice direct dans le référentiel validiste, qui ne vise pas à augmenter notre puissance d’agir ou de communiquer, mais qui développe une grammaire propre. L’interdépendance crip n’est ainsi pas à attendre comme un appui mutuel pour permettre à chacun de devenir des citoyens performants d’une société capitaliste, mais comme une façon de « vivre avec le trouble », d’accepter les liens multispécifiques et imprévisibles que les corps nouent avec les autres corps, humains et non-humains.
En suivant Rémi Yergeau, nous pouvons dire que notre indisposition, à l’instar d’un toc ou d’un fractal, « s’amplifie et se recroqueville à la fois, elle navigue de façon récursive à travers le corps, se liant et se connectant à d’autres tocs, formant des réseaux, des groupes, des coalitions “d’énoncés sensoriels” complexes » (Yergeau et al. 2021). Nous ne sommes donc pas seul·e·s, nous sommes d’ores et déjà connectés dans cet inconfort et dans cet égarement avec celles et ceux qui ont rencontré cet égarement bien avant nous, qui l’ont vécu, théorisé et incorporé, et nous tissons avec elles et eux bien plus qu’un simple réseau social ou qu’un graphe relationnel fermé et délimité : nous tissons des fractales, en écho.
Glisser dans la f(r)iction
Le néolibéralisme et le capitalisme neurocognitif troublent et redéfinissent le partage entre valides et invalides : la multiplication des expériences d’indisponibilité du corps ouvre à de nombreuses possibilités de liaisons politiques entre groupes sociaux, comme à l’émergence (et la politisation ?) de nouvelles formes d’invalidités. Néanmoins, celles-ci sont contrecarrées de façon ambigüe par l’industrie de la performance et par celle de l’accessibilité, qui contribuent à restaurer la disponibilité, et à limiter les expériences d’indisposition et de disposabilités, pourtant créatives.
Il s’agit alors moins de trouver une nouvelle façon de parler des handicaps que de remarquer que ces indisponibilités − ces fatigues, ces absences, ces extinctions − racontent d’ores et déjà leurs propres histoires, débutent un semblant de gestes : une histoire du rapport entre les corps et leur environnement technique, une histoire d’accessibilités manquées, de f(r)ictions d’accès. Ces f(r)ictions d’accès viennent troubler la fiction centrale du capitalisme neurocognitif : la fiction de l’individu à jamais valide et disponible, cognitivement efficace et autonome. Mais comme le dit de façon malicieuse la poétesse crip Liv Mamonne dans ses « Recommandations au poète valide assistant à un workshop sur la poétique du handicap » (2022) : « tu n’es qu’à un glissement dans la douche, qu’une visite chez le médecin, qu’un virage raté d’être moi. ». Aussi de plus en plus d’individus ne sont plus qu’à une innovation technologique, qu’à un degré Celsius de la température des océans, qu’à une petite mesure politique, de tomber dans cette f(r)iction d’accès, et d’accompagner le récit crip de leur corps et de leurs histoires, de faire chuter, main dans la main, les faux-semblants du validisme.
Bibliographie
Bascom, J. (2011) Loud hands: autistic people, speaking. The Autistic Press.
Bailey, C. (2019) On the impossible: Disability Studies, Queer Theory, and the Surviving Crip. Disability Studies Quaterly, vol. 39, no 4.
Berardi, F. (2014) Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the pathologies of post‑alpha generation. Minor Compositions.
Bonnet, E. et Monin, A. et Landivar, D. (2021) Héritage et fermeture : une écologie du démantèlement. Divergences.
Hamraie, A., & Fritsch, K. (2019). Crip Technoscience Manifesto. Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.28968/cftt.v5i1.29607
Haraway, D. J. (2020). Vivre avec le trouble (V. García, Trad.; Vol. 11). Les Éditions des Mondes à faire.
Illouz, E. (2019) Les marchandises émotionnelles : l’authenticité au temps du capitalisme. Premier parallèle.
McRuer, Robert. (2018) Crip Times : Disability, Globalization and Resistance. NYU Press.
Mammone, L. (2022) Recommandations au poète valide assistant à un workshop sur la poétique du handicap, Trad. Novi Jacquet, https://crashroom.ooo/2021/02/22/recommandations-au-poete-valide-assistant-a-un-workshop-sur-la-poetique-du-handicap
Mills, M. et Stern, J. (2017) Afterwork II : Dismediation − three proposals, six tactics. In dir Ellcessor, Elizabeth, and Bill Kirkpatrick, eds. Disability media studies. NYU Press, 2017, p. 365‑379.
Srnicek, N. (2018) Le capitalisme de plate-formes. Lux éditeur.
Puiseux, C. (2022). De chair et de fer : Vivre et lutter dans une société validiste (Vol. 11). La Découverte.
Rosa, H. (2012) Aliénation et accélération : vers une théorie critique de la modernité tardive. La Découverte.
Salomon, A. (2001) The Noonday Demon: An atlas of depression. Simon & Schuster.
Shew, A. (2023) Against Techno-Ableism. WWNorton.
Yergeau, et al. (2020). GET THE FRAC IN! Or, The Fractal Many-festo : A (Trans)(Crip)t1, Peitho, 22(4).
https://cfshrc.org/article/get-the-frac-in-or-the-fractal-many-festo-a-transcript
Walker, N. (2021) Neuroqueer Heresies: Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment, and Postnormal Possibilities. Autonomous Press.
Zuboff, S. (2019). L’âge du capitalisme de surveillance : Le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir (B. Formentelli & A.‑S. Homassel, Trad.; vol. 11). Éditions Zulma.
Sur le même sujet
- Subbotniki / Rumeurs d une ville sur sol instable
- Peut-on décolonialiser le rêve de la valeur, rêve du Blanc en Afrodystopie ?
- La multitude contemporaine
- Présentation Bioéconomie, biopolitique et biorevenu Questions ouvertes sur le revenu garanti
- Ada Colau & Manuela Carmena : l’indignation au pouvoir
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther