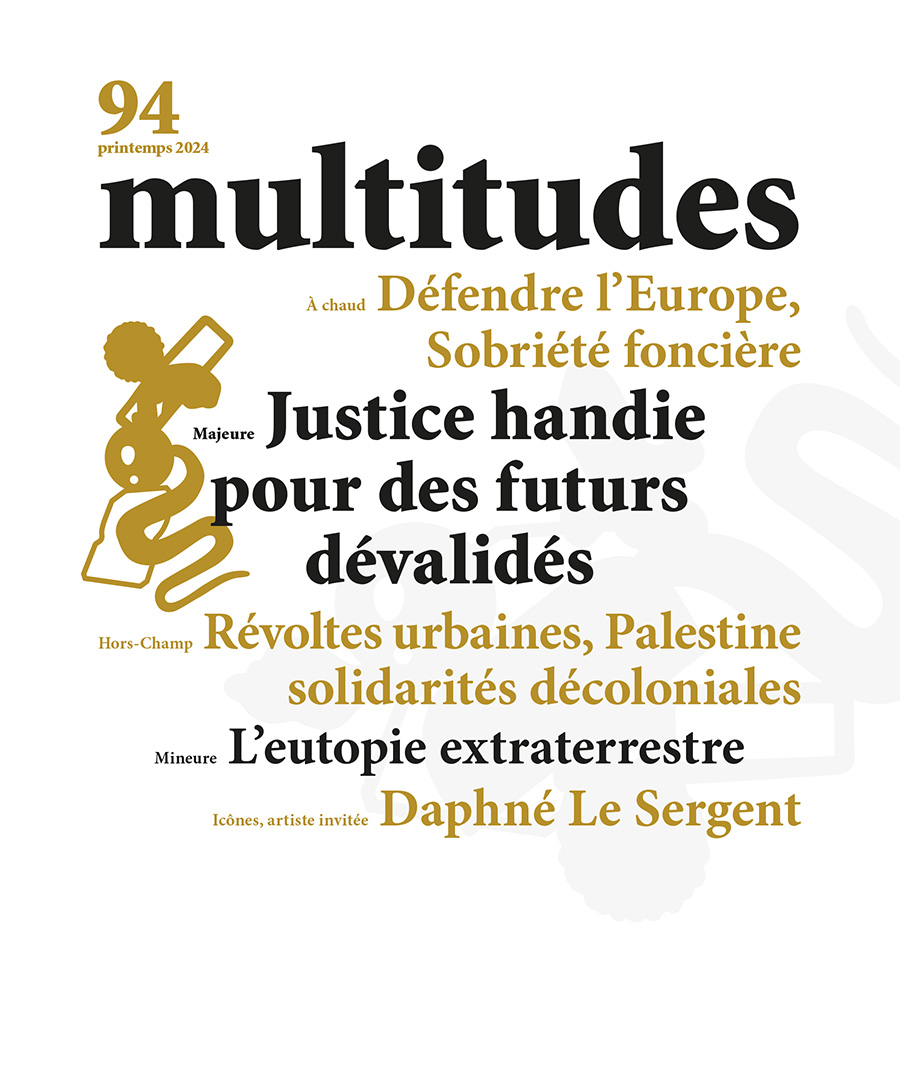Conversation entre Ariel Kyrou & Sandra Laugier
Ariel Kyrou : La série For all Mankind est une uchronie, c’est-à-dire une réinvention de l’histoire à partir d’un événement majeur qui se serait déroulé différemment. En l’occurrence : qu’aurait-il pu se passer si les Russes avaient posé les pieds sur la Lune avant les Américains en juin 1969, si la course à l’espace entre grandes puissances n’avait jamais ralenti et s’était projetée vers Mars dès les années 1990 ? La série, dont la quatrième saison s’est terminée en janvier 2024, interroge de façon étonnante la façon dont l’exploration ou même l’exploitation de l’espace auraient pu, et donc peut-être pourraient encore demain changer le monde. Comment expliquer qu’un tel pari soit tenu ?
Sandra Laugier : Cela tient d’abord à un dispositif : la série passe d’une décennie à la suivante à chaque saison, tout en maintenant la continuité des personnages… et des acteurs que le scénario fait vieillir au lieu de les remplacer comme dans une série très différente et à la temporalité comparable, The Crown, qui effectue aussi des sauts dans l’histoire mais colle plus ou moins à la réalité. Depuis la saison 1 qui démarre en 1969, les premiers personnages ont pris plus de trente ans : la deuxième saison commence en 1983, la troisième dans les années 1990, et dans la quatrième on arrive au XXIe siècle. For All Mankind est ancrée dans un groupe d’individus mêlant au départ figures empruntées à l’histoire (Wernher von Braun, Deke Slayton) et personnages de fiction qui donnent vie à cette histoire alternative et en incarnent les forces morales et politiques…
A. K. : C’est ce temps long de l’intrigue et des acteurs qui permet au spectateur de mesurer l’effet de décisions historiques divergentes par rapport à la nôtre, tout comme il permet à la course vers l’espace, pour le coup ininterrompue, de faire varier notre Histoire avec un grand H dans un sens plus émancipateur, voire utopique…
S. L. : Il y a une autre clé scénaristique majeure : la série décrit le passage constant des astronautes de la vie spatiale à la vie ordinaire. Cette capacité est étendue à toutes et tous, dans un processus de démocratisation de l’espace qui ouvre sur de nouvelles modalités de vie, pouvant être lues comme plus avancées que les nôtres. La force du propos tient au balancement entre l’Humanité qui fait des pas de géant dans le système solaire et le détail quotidien et intime de l’intériorité de ses personnages et de leurs vies.
A. K. : L’utopie de la conquête spatiale, qui selon moi ressemble beaucoup à une dystopie, plus précisément à une contre-utopie de compétition nationaliste et hyper capitaliste, ne devient-elle pas dès lors, grâce à ces ingénieux procédés, une « eutopie », c’est-à-dire une utopie située, un territoire d’action au cœur de nos sociétés telles qu’elles auraient pu être, non pas vers le pire, mais d’une certaine façon pour le meilleur ?
S. L. : L’uchronie de For All Mankind montre l’Amérique, et l’Humanité, prenant un chemin différent, transformées par la poursuite de la conquête spatiale et une rivalité Est-Ouest qui s’accompagnent de toutes sortes d’autres changements petits et grands : Edward Kennedy échappe à Chappaquiddick et devient président en 1973, John Lennon survit à son agresseur et devient mentor des opposants à la NASA, Margaret Thatcher est assassinée par l’IRA, et en ouverture de la quatrième saison, Al Gore est président. Toutes ces divergences, pouvant être interprétées en effet comme positives, sont rendues crédibles par un petit résumé historique qui ouvre chaque saison avec une série de titres de presse ou de médias et nous décrit tous ces événements, mais aussi grâce à des scènes assez sidérantes. Ainsi, dès le premier épisode : 1969, le monde entier, personnages de la série compris, attend le premier pas de l’homme sur la Lune. Le cosmonaute sort du module, descend l’échelle et plante dans la poussière lunaire le drapeau de… l’URSS. On voit là le pouvoir extraordinaire et performatif d’une image ou d’une scène, qui suffit à créer cette réalité alternative dans laquelle nous vivons quelque semaines par an, et ce avec d’autant plus d’efficacité que For All Mankind est diffusée à l’ancienne, un épisode par semaine, nous faisant ainsi sentir le passage du temps.
A. K. : Sauf que la série nous plonge d’abord dans un univers d’hommes, celui de la NASA de la fin des années 1960, patriarcal et très militarisé… Or les Soviétiques décident d’envoyer une femme dans les premières missions sur la Lune. Dès lors, la compétition se joue aussi, de façon paradoxale, sur le registre inattendu de l’émancipation des femmes voire des minorités, jusque-là totalement exclues d’un monde masculin plein de non-dits, blanc et inégalitaire au possible.
S. L. : For All Mankind n’est en effet ni une dystopie comme The Handmaid’s Tale, Westworld ou même House of Cards, ni une véritable utopie car elle n’évite aucune des difficultés de ces bifurcations et en devient plus réaliste. Sa force tient aussi à son féminisme et plus exactement à sa réflexivité féministe. Dans cette réalité alternative, l’URSS envoie une femme sur la Lune dès le second épisode, incitant la NASA à introduire des femmes dans les fusées dès les débuts de la conquête de l’espace : astronautes, ingénieures, cheffes de la Nasa. Cela conduit les spectateurices à se demander pourquoi elles n’y étaient pas dans leur réalité. Le premier casting viril de For All Mankind est ainsi élargi : qui a envie aujourd’hui de voir une série ou il n’y a que des histoires d’hommes ? Sont ainsi interrogés le concept d’Humanité, qui donne son titre à la série (Mankind), mais également les limites du féminisme. La série, très diverse dans son casting, devient un outil de visibilisation progressive des minorités, des femmes aux Noirs, aux Hispaniques, aux Asiatiques, ainsi que le lieu d’interrogations complexes sur les inégalités dans l’émancipation. Dans cette uchronie, les femmes sont partout, au pouvoir, et à égalité avec les hommes dans les vaisseaux spatiaux, mais les astronautes noirs sont une poignée et les homosexuels restent au placard… Jusqu’au moment où Ellen Wilson, astronaute devenue présidente des États-Unis, fait son coming out.
A. K. : Certes, la conquête spatiale provoque paradoxalement dans la série une évolution positive de la société, et plus précisément une meilleure considération des femmes comme des minorités de genre ou d’origine ethnique, mais elle ne remet jamais en cause la logique capitaliste d’exploitation des ressources humaines et non-humaines. Par ailleurs, l’écologie est curieusement absente de For All Mankind. Au point de se demander : un progrès dans les mœurs a-t-il du sens s’il continue à s’inscrire dans un capitalisme prédateur et extractiviste ? La série, en ne mettant en scène que ce progrès-là, ne propose-t-elle pas in fine qu’une modernisation de cette propagande que Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin, dans leur récent livre Une histoire de la conquête spatiale (La Fabrique, 2024), appellent « L’évidence spatiale », c’est-à-dire le rêve à l’ancienne d’envoyer des humains dans l’espace qu’elles qu’en soient le coût et les bonnes ou mauvaises raisons ?
S. L. : C’est vrai que dans la série, de façon très discrète, sous-jacente, les enjeux d’énergie et même de climat semblent se résoudre par la magie de la conquête spatiale, grâce à la fusion nucléaire et à l’helium-3 extrait sur la Lune. Mais, contrairement à toi, j’ai le sentiment qu’en dehors du monde des astronautes, la société de ce monde parallèle que décrit la série n’a guère des mœurs moins ringardes que les nôtres. Poussiéreux et datés, les décors et costumes de la série trahissent le manque d’imagination esthétique et sociale qui accompagne ses progrès scientifiques extrêmes ainsi que le maintien du patriarcat hors de la NASA. À l’exception de l’épisode de la présidence d’Ellen, les hommes blancs continuent d’être très majoritairement aux manettes et les femmes en cuisine, préoccupées par leurs enfants d’abord, y compris la nouvelle génération incarnée par Kelly, jeune chercheuse d’origine vietnamienne qui a été adoptée par l’astronaute Ed Baldwin et son épouse. Dans la quatrième saison, d’ailleurs, les rapports se tendent entre Ed Baldwin et Danielle Poole, les astronautes de la première génération, et c’est clairement une situation intersectionnelle où l’homme blanc favorisé ne peut se laisser commander par une femme noire d’origine plus modeste, même une héroïne qui lui a sauvé la vie. Bref, la série montre aussi tout ce qui dans une société résiste au changement, même (ou surtout ?) dans une situation de progrès fulgurants. Si l’on étudie de près la société de For All Mankind, elle est un peu en retard sur notre monde réel alors que la science y est très en avance et que les aspirations des personnages voudraient la suivre au plan de leurs existences ordinaires.
A. K. : C’est en effet un beau décalage, que je n’avais perçu ainsi. Sur un autre registre, lié lui aussi aux enjeux d’émancipation, je voudrais aborder un dernier point : pour moi, contrairement à une certaine vulgate, la conquête spatiale ne peut aucune façon être vue comme une utopie dès lors qu’elle maintient les dynamiques d’exploitation, de propriété et de compétition de notre société. L’eutopie extraterrestre, comme je l’appelle, reliant l’aspiration vers les étoiles à la dimension écologique, c’est-à-dire terrestre, est d’abord une quête de la vie telle qu’elle pourrait être dans l’univers. Or cette quête-là apparaît enfin dans le sixième épisode de la troisième saison, lorsque Kelly, dont tu as parlé, s’oppose à son père adoptif Ed Baldwin sur le sens de notre rapport à l’espace : pour elle, la recherche de la vie − et en l’occurrence de traces de la vie ou de certains de ses composants dans l’eau découverte dans le sous-sol de Mars − est première par rapport à l’exploitation des ressources du système solaire et plus largement à la colonisation spatiale. La scénarisation sur le temps long et successif des décennies, jusqu’à celles à venir dans les prochaines saisons selon les perspectives affichées par la production, permet d’interroger les vecteurs de toute véritable transformation de société. Or le personnage de Kelly, de façon certes trop timide dans la quatrième saison, incarne un changement de paradigme vers une eutopie extraterrestre en lieu et place de la dystopie compétitive de la conquête spatiale.
S. L. : Oui, c’est une série où l’exploration extraterrestre, qui est souvent traitée dans une esthétique abstraite et froide, dévitalisée, exploite au contraire tous les sens de la forme de vie, du biologique au social, de la recherche des origines et traces de la vie au détail des trajectoires des humains ordinaires.
A. K. : Le jeu que tu décris, entre ces deux polarités de l’espace intime et de l’espace lointain, des contingences du présent ici et maintenant et des perspectives du futur demain là-bas, questionne la faculté de l’humanité à se transformer sur le temps long. Elle donne à For All Mankind une dimension philosophique. Son vecteur est le rêve de l’exploration extraterrestre lorsque des êtres humains tentent de le concrétiser, acceptant de faire face à l’inconnu le plus radical. Ce rêve-là a du mal à décoller de la réalité diurne, capitaliste, extractiviste, y compris dans la quatrième saison où les énergies des protagonistes se focalisent sur les ressources inconcevables d’un astéroïde à exploiter. Confrontée au réel le plus trivial de ses personnages, la dystopie spatiale s’éclaire certes de quelques lumières utopiques, elle laisse entrevoir des changements de vision du monde, donc la potentialité de bifurcations de société − comme celle qui est à la source de la série Star Trek pour laquelle a bossé le créateur de For All Mankind, Ronald D. Moore. Ces bribes de rêve d’une autre société ne sont encore, du moins dans le début du XXIe siècle de la quatrième saison de cette uchronie, que de trop pâles lueurs. Mais elles pourraient bien devenir de plus en plus cruciales au fur et à mesure que la série se rapprochera puis dépassera demain la borne de notre présent.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)