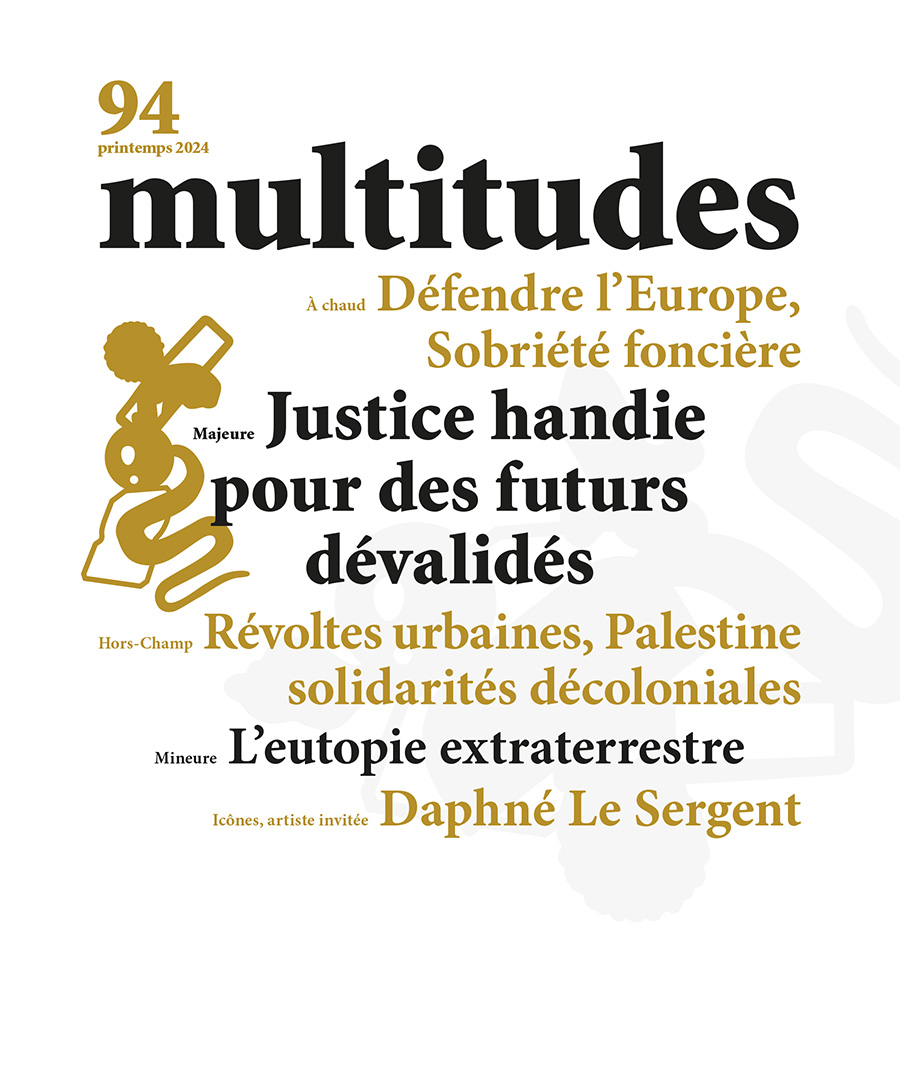Re-, pré-, dé-, im-, multi-, inter-, trans-, hyper- : voilà quelques-uns des préfixes qui ont, à tour de rôle, infléchi et modulé l’étude des médiations dans les champs disciplinaires les plus variés, en générant un cluster de variations terminologiques qui ne peut que confirmer la suspicion que le terme de média lui-même n’a rien d’immédiat. Au contraire, média semble toujours appeler une torsion, un décalage disciplinaire, une (dés)ambiguïsation productive. Le dis- de dismédiation s’ajoute à cette arborescence en opérant une contraction significative du champ des Disability Media Studies (Elcessor & Kirkpatrick, 2017) situé au croisement des études sur le handicap et des théories des médias. La dismédiation radicalise cette perspective et raccourcit les écarts par ce postulat d’ouverture : « La disabilité et les média sont co-constitués » (Mills & Sterne, 2017)1.
En revenant sur le terme et sur les choix qui ont motivé sa conception, Mara Mills définit la dismédiation comme une « théorie bifurquée ». En faisant se rencontrer dis- (pour différent, varié, proliférant) et médiation (pour médias, mais aussi pour moyen, message, milieux), la dismédiation tente d’allier la rigueur descriptive à un positionnement utopiste et militant. Cela implique tout d’abord de dépasser les approches limitées de la représentation des handicaps au sein des médias. Les désabilités (les capacités, les incapacités, les capacités différentes) ne sont pas seulement des thèmes ou des contenus des théories des média et des technologies. Elles en sont des éléments constitutifs.
Il s’agit bien là d’une refonte méthodologique qui demande un constant ajustement des phénoménologies, des modes d’enquête, des rhétoriques d’exemplification. La dismédiation s’insère dans une plus vaste prolifération des pensées de la disabilité comme méthode, à savoir, des textes théoriques en forme de guides d’utilisation (Sterne, 2021), de boîte à outils conceptuelle (Elcessor, 2016), de stratégies de recherche-création (Dokumaci, 2023), d’épistémologies crip (Johnson & McRuer, 2014), qui invitent à concevoir « les situations d’oppression sociale comme productrices d’identités et de perspectives, d’incarnations et de sensations, d’histoires et d’expériences extérieures qui offrent des modes de connaissance valables au sujet des idéologies dominantes qui semblent nous englober » (Siebers, 2008: 8).
La dismédiation réinvente les approches par lesquelles nous pensons les média et la communication, en opérant un ajustement ciblé des outillages conceptuels qui ont servi jusqu’ici pour rendre compte du rapport de l’humain (normé) à la technique (universelle). L’approche dismédiatique manifeste avant tout un rejet des théories universalistes des média, souvent ancrées dans une vision prolongationniste et réparatrice qui voit dans la technique un moyen d’atteindre ou de retrouver un corps précédemment (ou idéalement) intact. Face à ces narrations généralisantes et stigmatisantes qui se servent de la disabilité comme métaphore d’incomplétude dans une quête du corps parfait et de la communication ininterrompue, la dismédiation œuvre à la constitution de celles qu’on pourrait définir de contre-enquêtes impaires : des percées interdisciplinaires fondées sur l’impairment (Bouk & Mills, 2023), sur l’excédent à la norme qui sous-tend nos sociétés validistes, capables de nous montrer, par exemple, l’importance du sous-titrage pour sourds dans l’histoire de la télévision et de la sténographie (Downey, 2008), ou la convergence entre le traitement de l’acouphène et la recherche commerciale et militaire sur le masquage sonore (Hagood, 2018), ou encore de faire émerger ce que l’audiodescription pour aveugles peut apporter aux arts visuels et aux institutions muséales (Kleege, 2018).
Ainsi, par l’étude croisée des techniques, des normes légales et médicales, des instruments scientifiques et des représentations, les enquêtes dismédiatiques constituent un pouvoir de réfutation. Elles pratiquent une rigoureuse et nécessaire déclassification, au double sens de démonter les méthodes de classification normées qui rendent l’Histoire une et pareille à elle-même, et de faire émerger ce qui est classifié (classified au sens légal): cet excédent impair, occulté, écarté, divers puisque pas pareil, qui dévalide systématiquement, désempare, dépareille la pensée.
Références
Bouk, Dan, et Mills, Mara. The History of Impairment. Osiris no 39, à paraître, 2024. Et L’histoire de l’impairment, in Disglossaire, 2023. URL : https://dismediation.eur-artec.com/#I_Impairment pour la traduction française.
Dokumaci, Arseli. Activist affordances: how disabled people improvise more habitable worlds. Durham, Duke University Press, 2023.
Downey, Gregory John. Closed captioning: subtitling, stenography, and the digital convergence of text with television. Johns Hopkins studies in the history of technology. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008.
Ellcessor, Elizabeth. Restricted access: media, disability, and the politics of participation. Postmillennial pop. New York, New York University Press, 2016.
Ellcessor, Elizabeth, et Bill Kirkpatrick, éd. Disability media studies. New York, New York University Press, 2017.
Hagood, Mack. Hush: media and sonic self-control. Sign, storage, transmission. Durham, Duke University Press, 2019.
Johnson, Merri, et Robert McRuer. « Cripistemologies: Introduction ». Journal of Literary & Cultural Disability Studies 8, no 2 (janvier 2014), 12748. https://doi.org/10.3828/jlcds.2014.12.
Kleege, Georgina. More than meets the eye: what blindness brings to art. New York, Oxford University Press, 2018.
Mills, Mara, et Rebecca Sanchez, éd. Crip Authorship: Disability as Method. New York, New York, New York University Press, 2023.
Mills, Mara, et Jonathan Sterne. « Dismédiation − Keynote de la Journée d’études “Dismédiation : disglossaire des usages et des usures” ». La Générale Nord-Est, Paris, 20 octobre 2023. https://dismediation.eur-artec.com
Siebers, Tobin. « Disability and the Theory of Complex Embodiment − For Identity Politics in a New Register ». In The Disability Studies Reader, édité par J. Davis Lennard, 5e éd. Routledge, 2016.
https://api.semanticscholar.org/CorpusID:52257086
Sterne, Jonathan. Diminished faculties: a political phenomenology of impairment. Durham, Duke University Press, 2021.
1Le terme dismédiation est issu de la postface que Mara Mills et Jonathan Sterne ont écrit pour l’anthologie Disability Media Studies (Elcessor & Kirkpatrick, 2017). Une traduction française de cet article est disponible sur le disglossaire du colloque Dismédiations (https://dismediation.eur-artec.com), co-organisé en octobre 2023 avec Lucas Aloyse Fritz et Judith Deschamps. Je choisis d’utiliser le calque disabilité (s. f.) pour « disability » et l’emprunt « impairment » (s. m.), au lieu de « handicap » et« déficience », car cet article se fonde sur des analyses terminologiques et historiques anglophones qui établissent une distinction nette entre « disability », « handicap » et « impairment ».
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther