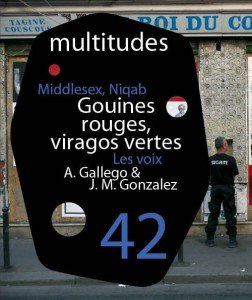À propos de MundoBraz : o devir-mundo do Brasil e o devir-Brasil do mundo,
Giuseppe Cocco, Editora Record
Une nouvelle relation entre le Brésil et le monde. C’est le Brésil qui devient monde et le monde qui devient Brésil, alors que tout devient Amazonie. Comment penser les changements contemporains dans ce cadre de l’immanence terrestre ?
Cet essai de Giuseppe Cocco – mixte de débats théoriques et d’intervention politique – prolonge les réflexions développées par l’auteur avec Toni Negri dans GlobAL Luttes et biopouvoir à l’heure de la mondialisation : le cas exemplaire de l’Amérique latine. Et procède par le biais d’une lecture de l’anthropologie d’Eduardo Viveiros de Castro, de son « perspectivisme amazonien » et de sa tentative d’élaborer une définition amérindienne du concept.
Si l’idée de communisme regagne force dans certains débats philosophiques et politiques, cet essai y contribue en essayant de travailler à partir de pratiques singulières, comme ici l’anthropophagie.
Par-delà du pays du futur
Le Brésil est une énigme pour ses interprètes. Pays neuf, il est traversé par un sens, une dynamique, une orientation vers, une rencontre avec le futur. L’hymne national même parle d’un géant couché dans un berceau splendide, désignant l’image d’un énorme potentiel pas encore concrétisé. C’est au Brésil que Thomas More situe son utopie et Stefan Zweig, dans les dures années 1940, travaille cette idée en écrivant Brésil, terre d’avenir.
Cet optimisme d’un futur doré s’est toujours conjugué avec le contraste de l’âpreté présente (et passée). Le génocide amérindien puis l’esclavage et ses criantes inégalités forment un continuum. Multiples temps présents, pays où « archaïsme », « modernité » et « postmodernité » se côtoient. Ce croisement d’espace-temps est constitutif du Brésil. Celui-ci est né moderne, issu de la conquête de l’Amérique et d’un système colonial et global.
De nombreux brassages marquent son histoire. Les premières rencontres viennent du face-à-face entre les multiplicités amérindiennes et les portugais, eux-mêmes déjà métissés, quelque peu africains[1]. Puis, d’autres rencontres et violences se sont produites avec la venue de millions d’africains et, ensuite, avec l’immigration massive, lors des XIXe et XXe siècles, principalement de travailleurs fuyant la misère, pauvreté et guerres (japonais, polonais, italiens, juifs, syriens, libanais entre autres).
Ceci a donné des métissages caractéristiques et une richesse de couleurs. Et, également, un certain consensus conservateur d’une supposée démocratie raciale, malgré un type de colonialisme interne où les minoritaires indiens (deux-cents langues ont survécu) et noirs (pays à plus grande population noire après le Nigeria) ont été toujours dépréciés même si faisant partie du « folklore national ».
Dans ce contexte, le Brésil a été tenté par deux démarches opposées dans ses relations avec le monde : nier le monde ou s’y soumettre. L’anthropophagie subvertit cette dichotomie. Il ne s’agit plus de choisir entre le Brésil et le monde, mais de penser cette relation en d’autres rapports, en termes de déglutition. Oswald de Andrade développe cette idée dans son Manifeste anthropophagique[2] de 1928 – document clef du modernisme brésilien – en se basant sur le rituel des indiens Tupi de la côte. Lors de cette cérémonie cannibale, tous (sauf le tueur) devaient manger de leur ennemi, de leur contraire. La vie est perçue comme dévoration et il s’agit d’extraire des autres leurs forces et qualités. L’anthropophagie y est analysée comme une weltanschauung, un mode de penser et de se situer dans le monde. Une absorption-transformation c’est-à-dire une opération ayant pour fin de prendre ce qui intéresse chez autrui et de le travailler de manières singulières, notamment les idées (et le marxisme pour Oswald). L’échange – et non l’identité – est la valeur affirmée.
De plus, « le Manifeste anthropophagique s’inscrit comme une anticipation politique et une intuition théorique de ce que l’anthropologie contemporaine développera plus tard » (Cocco, p. 234). Il y aurait même chez les Amérindiens une épistémologie cannibale, une philosophie de la prédation alimentaire, avec ses trois postures possibles : manger comme l’autre, manger avec l’autre, manger l’autre[3]. L’anthropophagie est ainsi un acte d’humanisation ; est assimilé un sujet chargé d’humanité et du pouvoir d’agencer et non pas un autre inerte et naturalisé. Il s’agit d’une relation sociale.
Par conséquent, déglutir l’autre, c’est se transformer, devenir. Un anticolonialisme sans nationalisme. Face à ces dilemmes brésiliens, Cocco propose de penser non plus en termes de futur, mais de devenir. Devenir comme un « entre », comme production de multiplicités, car ces pratiques amazoniennes se lient, chez l’auteur, à une perspective de la primauté des résistances.
Ce livre se situe dans la sorte de révolution copernicienne au sein du marxisme effectuée par un travail collectif de fait de plusieurs auteurs : des études d’E. H. Thompson et de l’operaismo italien de Tronti et Negri aux lectures de Marx via Foucault et Deleuze-Guattari. Il s’agit de penser la primauté constitutive des luttes, vu que « le pouvoir peut contrôler, moduler, mais pas générer » (Cocco, p. 132). Celui-ci « vit seulement d’obéissance, ceci signifie qu’il y a un moment d’autonomie qui le précède : la résistance est première » (Cocco, p. 156).
Cocco travaille, ainsi, avec Foucault, le biopouvoir comme un assaut du pouvoir contre la puissance de la vie, contre la biopolitique, essentielle au pouvoir qui ne peut vivre sans elle. Cette immanence des luttes aide à sortir de plusieurs débats binaires et peu productifs. Cocco pense à partir de là les changements contemporains du travail, de l’emploi et de la production, de la dichotomie nature/culture et sur la « brésilianisation » du monde.
Travail et immanence terrestre
Aujourd’hui produire les conseils et organiser la production constituent le même mouvement – la même production de formes de vie. Face à ces changements, « l’accumulation perd progressivement sa légitimation instrumentale (d’être la condition de production) et s’affirme comme une pure relation de pouvoir, accumulation politique qui vise – par la violence, la guerre, l’État d’exception – à transformer systématiquement les singularités en fragments individualistes qui compètent entre eux (marché) et, ainsi, transformer les relations de coopération en relations de risque qu’il est nécessaire de “sécuriser” (de là le rôle très matériel et réel du capital financier) » (Cocco, p. 133-34).
Cocco critique la nostalgie chez certains intellectuels critiques brésiliens – notamment Paulo Arantes et Chico de Oliveira – d’un capitalisme version néolibérale qui aurait cessé d’être « incluant ». Ces discours tomberaient dans un double paradoxe : l’existence d’un capitalisme « d’avant » qui ne le serait pas et une absence d’appréhension des dynamiques du capitalisme contemporain, dont quelques unes vont dans le sens d’une « construction d’un commun qui permette aux singularités d’être mobiles et flexibles de manière libre et productive » (Cocco, 163-64).
Ce changement de paradigmes au niveau de la production s’articule avec les débats anthropologiques qui interrogent la scission moderne entre nature et culture, qui introduisent au devenir-Amazonie du Brésil et du monde. La discontinuité entre nature et culture s’associe à d’autres oppositions comme celles entre mythe et philosophie, magie et science, primitifs et civilisés[4]. Les occidentaux sont les seuls à mobiliser la nature telle qu’elle est matériellement[5], et à y opposer leur culture. L’anthropologie occidentale est asymétrique.
Giorgio Agamben tente bien de construire une échappatoire à la dichotomie entre humanité et animalité. Néanmoins, son ontologie négative ne cherche pas d’autres horizons alternatifs et sa critique de ce clivage constitutif des machines anthropologiques occidentales n’arrive pas à sortir de cette prison. Sa vie en suspension et nue semble rester captive de cette vision, pensant une espèce de nature naturelle. Il transformerait, selon Cocco, la biopolitique en thanatopolitique.
Si l’on pense à une économie de l’altérité où sont produits soi-même et les autres et où les corps constituent cette empreinte, ainsi, contrairement à la perspective d’Agamben malgré lui prisonnier du naturalisme moderne, « la vie est toujours vêtue, même quand elle apparait dénudée aux conquistadores qui n’arrivaient pas à voir les “vêtements” car ils étaient préoccupés uniquement de savoir si les “indiens” avaient ou non une âme. En recourant à Viveiros de Castro, Cocco affirme que la vie est le corps “fait”, littéralement fabriqué des amérindiens » (p. 186).
Selon les cosmologies amérindiennes, les relations avec la nature sont des relations sociales. La forme de l’autre n’est pas une chose (comme pour l’épistémologie objectiviste) mais la personne ; connaître veut dire personnifier, prendre le point de vue de ce qui est appréhendé[6]. Ceci nous amène au-delà de la division sujet-objet et ouvre de puissantes possibilités alternatives, de nouveaux horizons. Pas de forêt vierge ni de nature passive, société et environnement évoluant ensemble. Une intégration donc entre environnement et organisation sociale, toute réflexion sur la nature se rattachant à un arbitraire culturel.
Conjuguant Marx des manuscrits de 1844, Deleuze-Guattari et Viveiros de Castro, Cocco comprend la production comme création de sens, de monde. Pour appréhender les changements au niveau de la production par-delà des scissions entre nature et culture et entre sujet et objet – et ses notions de manque et nécessité – une théorie de la multiplicité se fait nécessaire. Opèrent des métissages et hybrides universels entre sujets humains et objets auquel les modernes et leurs dichotomies sont restés étrangers. Nous arrivons donc à une ontologie relationniste : « non plus l’être, mais – comme dirait Viveiros de Castro – l’“entre”! » (Cocco, p. 189).
Le commun, de ce fait, est faire, expansion, excès, devenir, échanges d’échanges, monstres. Une différence vitale face au naturalisme occidental qui non seulement nie la dimension constitutive de la relation mais la transforme en subordination dans la machine de colonisation.
Le perspectivisme amérindien est une théorie pratique de la multiplicité. Pas seulement une alternative radicale au dualisme homme/nature, mais un relationnisme puissant : non plus le débat multiculturalisme contre universalisme naturel, mais un universalisme culturel face au multinaturalisme : « hybridisation systématique entre cultures et entre culture et nature : une nouvelle anthropophagie politique » (Cocco, p. 217).
La « brésilianisation » et le devenir-Brésil du monde
Nous arrivons, enfin, au devenir-Brésil du monde. Un monde qui ressemble de plus en plus au Brésil. Qu’est ce que cela signifie ? Le réel prend le contrepied de ce qu’attendait le Brésil. Au lieu de son rendez-vous promis avec le futur, c’est le futur (de tous, du monde) qui est devenu Brésil. Cette « brésilianisation » du monde est, habituellement, appréhendée en termes négatifs. Le monde serait en train d’incorporer des caractéristiques typiques du Brésil, telles que les inacceptables inégalités et ségrégations spatiales. La modernité brésilienne se convertit dans la postmodernité de tous. Le film Brazil de Terry Gilliam, par exemple, illustre cette image, en renforçant l’aspect autoritaire.
Cocco, dans le sillage de ses travaux sur la ville développés avec Michèle Collin et Thierry Baudouin[7], soutient que le livre de Mike Davis Planet of slums (traduit au Brésil comme planète favela) emprunte également ce chemin. S’il ne cite pas la « brésilianisation », il travaille l’idée de « favelisation ». Il analyse, de cette façon, la favela comme un mal et accuse les gouvernements du Sud d’avoir abdiqué de la lutte contre celles-ci. Cette position ainsi que son opposition à toute politique d’urbanisation et de régularisation foncière – vues comme néolibérales – le fait tenir une espèce d’« apologie reverse du pouvoir du capital » (Cocco, p. 42). Au contraire, Cocco présente la fin de l’expulsion systématique des habitants des favelas comme une victoire contre ce qui était auparavant la seule politique étatique et une indication de la force des mouvements des favelados.
Davis ne voit pas dans les favelas l’existence de dynamiques ayant des potentialités de libération, vu qu’il ne travaille pas dans le contexte des pratiques concrètes de résistances et production des sujets. Il semble chercher une solution complète et toute prête ce qui le mène à une certaine impuissance par le fait d’ignorer les constructions démocratiques de la part des migrants qui composent les favelas. Si celles-ci sont symboles des inégalités, elles constituent, également, des territoires de créativités et de mobilisations productives, avec des architectes sans diplôme[8] ou des musiques qui gagnent le Brésil (et parfois le monde).
Viveiros de Castro affirme que pour le bien et pour le mal, maintenant tout est Brésil[9]. Cocco se demande alors s’il y a une brèche pour concevoir une « brésilianisation » du monde comme production du monde et du commun. Nous aurions deux manières de penser :
Un plan vertical, de temps linéaire, où le futur serait bouché : domination de l’informalité, manque de protection sociale, racisme, inégalités, violences. En somme, un État d’exception, c’est-à-dire Agamben lu par certains penseurs brésiliens comme Oliveira et Arantes.
Un plan horizontal, de « brésilianisation » dans lequel de nouvelles pratiques culture-nature développent des résistances ontologiques, des nomadismes, des devenirs. Un devenir-Brésil du monde comme une ouverture des possibles, présent dans différentes luttes – fuites rurales, constructions urbaines, mobilisations noires, cosmologies amérindiennes. Le Brésil comme presque une avant-garde des transformations démocratiques face à des défis maintenant mondiaux. Dans ce sens, pour l’auteur, « le devenir-Brésil du monde et de le devenir-monde du Brésil se dédoublent dans l’horizon du devenir-Sud du monde et du devenir-monde du Sud. Le devenir-Sud est la négation active et constituante du clivage nord-sud et en même temps l’affirmation d’un horizon non eurocentrique et, donc, non anthropocentrique » (p. 275).
Cocco insiste cependant sur une nécessaire déconstruction de l’identité brésilienne comme un pas décisif, encore une fois en dialoguant avec Viveiros de Castro, pour « démonter la machine du colonialisme interne qui traite les peuples indigènes comme obstacle du vieux et du “néo” national-développementisme » (p. 79).
Le titre même de l’ouvrage (MundoBraz) pose ce débat. Celui-ci va contre la négation du Brésil, mais s’oppose aussi au nationalisme, dont quelques uns des symboles sont les grandes entreprises créées par l’État et qui possèdent le suffixe Bras, comme Petrobras, Eletrobras. Le Braz, avec « z » apparaît ainsi comme une provocation dans le sens d’un MondeBrésil, un essai de conduire le débat en fuyant les alternatives infernales marché/État ou individualisme/collectivisme. Il s’agit de créer un élan pour remplacer le temps linéaire par un autre, rhizomatique et évènementiel, ouvrant des possibles grâce à une déconstruction de l’« État » et du « national ».
Une série de débats – la démarcation de la Réserve indigène de Raposa da Serra do Sol et l’hydroélectrique de Belo Monte – indiquent la relation clé entre démocratie et développement. Le devenir-Amazonie du Brésil et le devenir-Brésil du monde permettent de ne plus distinguer protection de la nature et droits indigènes, production-lutte et démocratie.
Les politiques d’actions affirmatives visent à lutter contre les discriminations héritées de l’esclavage, notamment en permettant l’accès des noirs aux universités publiques, face à une nette corrélation entre couleur de peau et exclusion de celles-ci, et au parallélisme entre lignes chromatiques et lignes de revenus.
Cocco rappelle à nouveau Oswald de Andrade. Celui-ci propose un métissage de combat et non de conciliation, face à l’apologie de Freyre et à sa conception biologique de race qui voulait réduire la multiplicité à l’un. Andrade (et des mouvements contemporains) proposent une multiplication des couleurs face au gris métis. Arc-en-ciel pour un nouvel horizon constituant qui nous remet à l’actualité anthropophagique.
Si le monde devient Brésil, les affrontements qui traversent les deux, même si en des degrés bien différents, sont les mêmes ; articuler les mondes, les différences. Comme l’a développé Claude Lévi-Strauss[10], le monde devient un mais ceci ne veut pas dire qu’il s’agit d’une uniformisation pure et simple ; les différences cessent d’être externes et deviennent internes.
Tentant de fuir un relativisme générique, Cocco souligne que l’hybridisation n’est pas en soi même un processus de libération, mais plutôt le terrain de la lutte, contrairement à la vision pacifiée de Bruno Latour. Ces idées fuient les débats pour ou contre le multiculturalisme. Il s’agit d’hybrides, d’échanges de points de vue, un exemple fort en étant la manière dont l’avocate indienne wapichana Joênia de Carvalho défend la démarcation du territoire indigène Raposa da Serra do Sol devant la haute cour fédérale de justice.
Les mobilisations boliviennes illustrent également ce point. Le devenir-aymara de la Bolivie, loin de vouloir dire que tous les boliviens sont en train de devenir aymara indique que ses forces constituantes travaillent les dynamiques des différences indigènes. La nouvelle constitution encourage, aide à produire un agencement aymara-gaz national-assemblée nationale. Si « aujourd’hui tout le monde découvre qu’il est nécessaire d’hybridiser et de métisser » (Viveiros de Castro), tous doivent travailler leurs différences. Même en Europe où le B-side[11] – juifs, tsiganes, musulmans… ont éprouvé fortement le refus de l’altérité, maintenant tout est ensemble (banlieues) et l’anthropophagie peut-être une « sortie », étant donné que « son imagination s’alimente d’Autrui. Réside là son potentiel décolonisateur, subversif »[12].
Selon Viveiros de Castro, l’anthropophagie est la seule contribution réellement anticoloniale créée au Brésil et sa création culturelle la plus originale, « elle jetait les indiens au futur et à l’œcoumène; ce n’était pas une théorie du nationalisme, du retour aux racines, de l’indianisme. C’était une théorie réellement révolutionnaire »[13]. Il oppose, de cette façon, deux projets « nationaux » : celui de l’identité nationale et celui d’une « des-invention » du Brésil. Le premier de création d’un empire comme les autres, un nouvel Etats-Unis. Le deuxième comme radicalité anthropophagique, sans colonialismes ni interne ni externe ; pas un Brésil, mais beaucoup de Brésils et des brésils partout. C’est peut-être pour cela qu’un vétéran du mouvement Tropicália, le metteur en scène et comédien Zé Celso Martinez affirme que Lula est le premier président anthropophage du Brésil[14].
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)