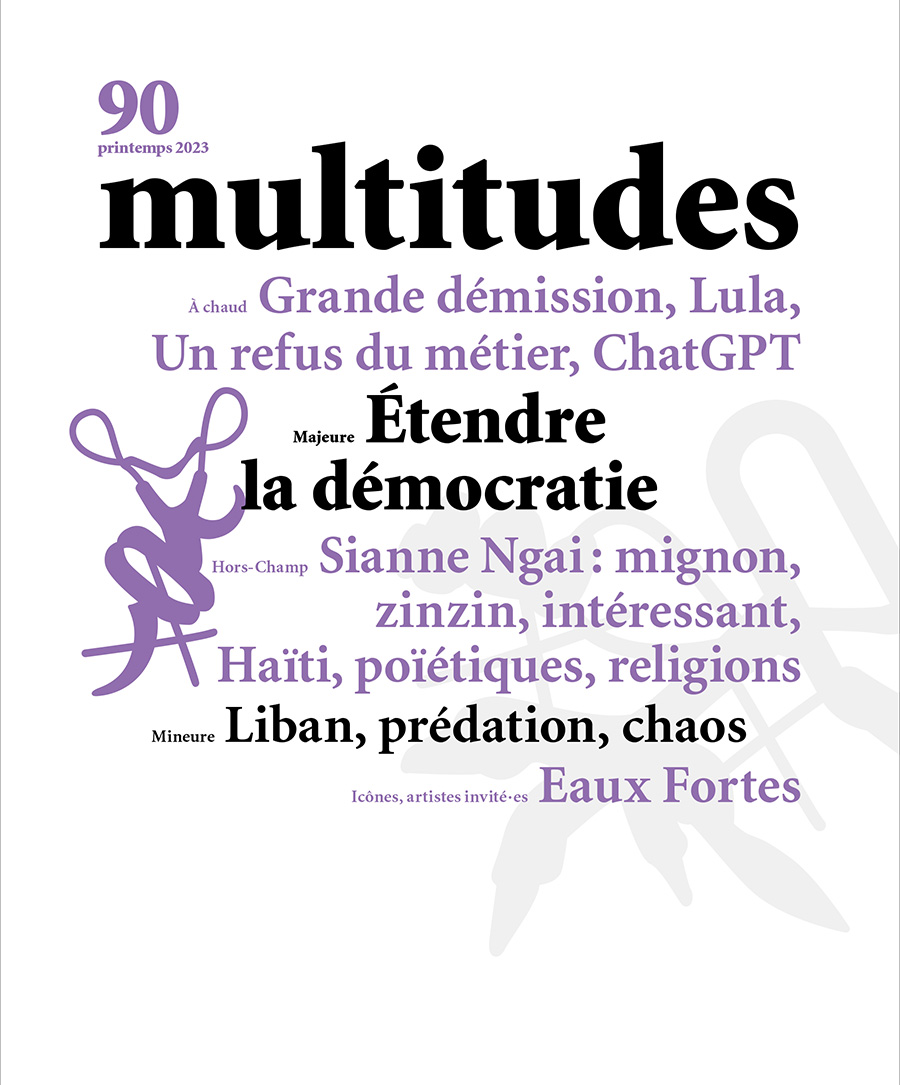À ses débuts, la guerre civile libanaise (1975-1990) pouvait se prêter à une lecture faisant appel à des catégories non-confessionnelles. C’est ainsi qu’on a pu parler d’une confrontation entre un bloc à tendance pro-arabe se réclamant de la gauche et un bloc souverainiste, tourné vers l’Occident et qualifié de droitier. Que le premier regroupât en majorité mais non pas exclusivement des musulmans, et le deuxième, des chrétiens, était un détail qui n’était pas indispensable à la compréhension du conflit. Mais cette guerre qui pouvait encore passer pour un conflit de valeurs et de visions politiques s’est rapidement transformée en une guerre de massacres interconfessionnels et intra-confessionnels. Cette « confessionnalisation du conflit libanais 1 » s’est ainsi accompagnée d’un phénomène de « conversions » politiques, qui ont consisté le plus souvent en un passage d’un engagement laïc à un engagement confessionnel.
Une conversion politique se distingue d’un retrait de l’engagement ou encore de la participation à un schisme à l’intérieur d’un même mouvement. Elle désigne le franchissement d’une frontière idéologique structurante et le passage au « camp ennemi ». C’est sur ce dernier type de trajectoire qu’a porté notre étude dont nous présentons un extrait. Il est issu d’un travail de recherche soutenu et financé par le Centre d’études pour le monde arabe moderne (CEMAM) de l’université Saint-Joseph de Beyrouth.
Nous avons voulu échapper à l’hégémonie du prisme confessionnel pour mettre l’accent sur la subjectivité personnelle et les trajectoires individuelles, à l’encontre des discours sur le Liban qui accordent aux logiques communautaires une place centrale. Les militants politiques ont des comportements variables à travers le temps. Ils ne suivent pas une trajectoire prédéfinie mais peuvent changer d’avis, voire changer de camp, quand ils ne se replient pas sur leur vie privée. Nous avons choisi d’employer la technique de l’histoire orale, une approche non-critique qui convient particulièrement au Liban contemporain très divisé, en l’absence d’un récit historique consensuel sur les cinquante dernières années. L’histoire orale permet de recueillir le « discours interne » du sujet interviewé et le sens qu’il donne à son propre parcours, même si ce discours fait l’objet d’un montage et d’une analyse dont nous portons l’entière responsabilité.
B. est un intellectuel né à Beyrouth en 1952 d’un père européen naturalisé libanais et d’une mère libanaise. Il a grandi dans le quartier de Ras el Nabeh. En raison d’un comportement turbulent, il est expulsé de plusieurs établissements scolaires. Comme l’écrit Agnès Favier, ce nomadisme scolaire constitue « le cas le plus fréquent parmi les élèves qui deviennent des activistes politiques2 ».
Son premier engagement politique commence après la défaite arabe de 1967 (« j’ai pleuré d’humiliation »), alors qu’il est encore en classe de 3e, et s’étend jusqu’en 1970, année de l’obtention de son baccalauréat et de son départ pour l’Europe. B. décrit ce premier engagement sur un mode qui se veut distancié de la politique partisane : « J’ai collaboré avec Liban socialiste3, puis avec l’OACL après la fusion. J’ai certes participé occasionnellement à des réunions de cellule, mais je n’ai jamais été embrigadé dans aucun parti. Je posais sur les organisations politiques le même regard que j’avais sur les institutions dominantes comme la famille, la bourgeoisie libanaise francophone ou le collège Notre Dame de Jamhour4. Comme toujours dans mes engagements, j’étais à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Nous organisions des réunions pour informer les ouvriers de leurs nouveaux droits sociaux. C’était aussi le moment où la gauche libanaise tissait des liens avec les organisations palestiniennes. J’avais surtout des liens avec le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP) de Nayef Hawatmeh5. J’avais un laissez-passer palestinien avec un nom d’emprunt. Je me rendais dans les camps de réfugiés palestiniens, suivais des entraînements militaires et me portais volontaire pour les tours de garde. Je faisais des collectes d’argent et de nourriture à Beyrouth et dans la Bekaa. Il y avait un côté romantique qui me plaisait. On a les guerres de Troie qu’on peut. C’était un mode de vie, ce n’était pas théorisé… Il s’agissait d’être du côté des opprimés, d’être révolutionnaire plutôt que de faire partie des dominants ».
L’aventure du soutien aux opprimés
B. se présente comme un rebelle à la recherche d’une cause et insiste sur la primauté de la rupture sociale sur le mobile de l’engagement : « Ce n’est pas le symbole qui radicalise, c’est la radicalité qui se cherche un symbole à investir et auquel s’accrocher. Ma famille était de droite. J’étais déjà en rupture par rapport à mon milieu. Adolescent, j’étais non-conformiste. Je circulais à moto alors que j’appartenais à un milieu où ce moyen était réservé aux voyous et aux livreurs ». Sa participation à la vie militante lui permet de découvrir les réalités de la société libanaise et de son atavisme, les agents de l’État tenant compte des logiques communautaristes pré-étatiques dans l’exercice de leurs fonctions :« En 1968 ou 1969, je participe à une manifestation interdite devant le Parlement. La brigade 16, une espèce de police paramilitaire dont beaucoup de membres appartenaient à la communauté druze, attaque les manifestants à coups de crosse. Je me trouvais par hasard derrière Walid Joumblatt6. Un brigadier arrive pour le frapper, le reconnaît, s’arrête net, lui présente ses excuses (« pardonnez-moi Walid bek » – Monsieur Walid) et frappe son voisin. Cela m’a marqué ».
B. découvre aussi les stratégies patronales face aux mouvements ouvriers : « Nous avions organisé une réunion avec les ouvriers de la biscuiterie Ghandour pour les informer de leurs nouveaux droits sociaux en matière d’assurance-maladie. Quand nous les avions conviés à une réunion, ils semblaient très intéressés. Mais, le jour venu, aucun ouvrier ne s’est présenté. Plus tard, nous avons appris que la direction de l’usine leur avait dit que nous étions des Témoins de Jéhovah7. C’était ma première leçon de désinformation ! ».
Au fil de ces entretiens accordés près d’un demi-siècle après les faits, B. insiste sur sa marginalité et sur sa distance par rapport aux idéaux et aux formations politiques, ce qui est démenti par certaines réactions émotionnelles comme le fait, mentionné plus haut, d’avoir pleuré d’humiliation lors de la défaite de 1967. Il minimise l’aspect partisan de son engagement au profit de deux types de mobiles, créant une tension que l’on retrouvera au fil de son discours : un mobile de type moral, comme le « soutien aux opprimés » ; et un mobile qu’on pourrait qualifier d’existentiel, visant le plaisir de l’aventure et de la découverte, ce qui, suivant Bourdieu et Passeron, indique une origine sociale élevée, même si B. se présente comme étant issu des classes moyennes8. « En septembre 1970, quand le roi de Jordanie décide d’attaquer l’OLP, je prends mes cliques et mes claques et me précipite pour combattre en Jordanie. J’ai été refoulé par les autorités syriennes à la frontière syro-jordanienne, à Deraa. » Peu après, il quitte le Liban pour poursuivre ses études en Europe durant une dizaine d’années pendant lesquelles il ne travaille pas, mais vit grâce à une bourse et à l’aide familiale.
Le discours de B. est dépourvu de références marxistes et son parcours intellectuel tel qu’il nous l’a décrit ne comporte pas de période d’éducation – ou d’endoctrinement – politique telle que d’autres militants libanais ont pu connaître pendant leurs études à Paris, avec une formation importante sur le marxisme-léninisme, le maoïsme, etc. Sa première conversion politique naît en Europe, en 1976, dans un contexte d’« enfermement scolastique », le statut d’étudiant facilitant « une distance intellectualo-centrique à l’égard du monde9 » : « C’est à l’université que ma vision romantique de la révolution palestinienne s’est transposée aux Forces libanaises. Ma vision a basculé juste avant l’entrée des forces syriennes en juin 1976, alors que les Chrétiens se trouvaient dans une très mauvaise passe. Les Syriens sont venus sauver la mise aux phalangistes. Il n’y a pas eu un moment unique de déclic, c’était une accumulation de choses ».
Confessionnalisation
Si la guerre s’est confessionnalisée, B. considère que, dans un premier temps, il n’a pas été motivé par la solidarité confessionnelle mais par la solidarité avec les plus faibles, invoquant encore une fois le mobile moral : « En 1975-1976, les Palestiniens sont passés du statut d’underdog à celui d’overdog. Les Forces libanaises étaient en position de faiblesse ce qui les rendaient “casher” ». La question confessionnelle l’a cependant rattrapé : « Au début, il s’agissait de défendre les plus faibles. Ensuite, c’est devenu une question d’appartenance. Suis-je un Libanais chrétien ou un Chrétien libanais ? Il y a eu là un basculement par rapport à l’identité ». B. n’a pas subi d’assignation identitaire et ne s’est pas heurté à la confessionnalisation des esprits pendant son premier engagement militant, peut-être parce que celui-ci s’est déroulé à une période (1967-1970) où les tensions confessionnelles étaient moindres : « Pendant ma première période militante, mon pseudonyme était Tarek. Mais mes camarades de lutte connaissaient probablement mon vrai nom, savaient que j’étais chrétien et probablement aussi que mon père était un étranger, un Européen. Mais la question confessionnelle ne s’est jamais posée. Elle s’est posée plus tard quand, des deux côtés, on a commencé à assassiner les civils en fonction de leur religion. Elle se pose dès lors que quelqu’un est arrêté, maltraité ou tué, non pour ce qu’il fait mais pour ce qu’il est, ou ce qu’on lui dit qu’il est ».
L’identité libanaise chrétienne prend alors un nouveau sens : « Mon identité chrétienne était pour moi quelque chose de nouveau. Car jusqu’alors, j’assimilais la chrétienté libanaise à la bourgeoisie compradore, la bourgeoisie intermédiaire francophone, la francophonie, etc. Avec la guerre, les choses ont changé. J’ai commencé à m’intéresser aux Mardaïtes10. La guerre a ouvert la possibilité de passer outre la structure libanaise multiconfessionnelle pour constituer un foyer chrétien. Le projet m’a plu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour des raisons objectives et subjectives. Raison objective : l’islamisation rampante des musulmans libanais et la faillite du nationalisme arabe. Raison subjective : parce que le discours dominant à l’université où j’étais, en Europe, était très pro palestinien, anti-chrétien et anti-phalangiste. « Phalangiste » était déjà une injure. Le mot est synonyme de fasciste, alors qu’il est une mauvaise traduction du mot arabe « kataëbi » qui signifie à la rigueur « bataillonniste » mais pas « phalangiste » ». Avec quelques camarades, il essaye d’équilibrer l’ambiance pro palestinienne de son université, par des articles, des tables rondes et des séminaires.
Nous l’interrogeons : ses positions politiques ne seraient-elles pas réactives ? Ne serait-il pas la variable d’ajustement qui cherche toujours à compenser le déséquilibre entre les forces en lutte ? « Oui, c’est vrai, je me suis d’abord révolté contre la bourgeoisie libanaise, puis contre les bourgeois bien-pensants de l’Occident… le vrai changement a été ma désidéologisation au début des années 1980 ».
Entre 1978 et 1980, B. soutient deux thèses de doctorat, l’une en orientalisme, l’autre en islamologie, dans deux universités européennes différentes. Ces travaux de recherche approfondie contrastent de façon étonnante avec l’accent mis sur l’aspect aventurier de son engagement. En 1980, il rentre au Liban pour militer en faveur du projet de foyer chrétien au sein des FL, renonçant à des perspectives d’intégration professionnelles en France : « Je ne me voyais aucunement en professeur d’université, je n’avais aucun respect pour cette caste et pour ses mesquineries sous couvert de science et d’art ».
Ce nouvel engagement comporte aussi une dimension d’aventure et de virilité, ce qui, par l’indifférence affichée envers le coût humain du conflit, entre en tension avec le mobile moral du soutien aux opprimés : « J’avais envie de sentir l’odeur de la poudre et du sang, de vivre intensément, et j’avais le goût des causes perdues, car avec les causes perdues l’objectif, irréalisable, ne vient pas grever l’aventure et piper les dés ». Ce désintérêt pour la viabilité de son projet politique serait une manière de maintenir une certaine distance par rapport au monde social non-estudiantin en général, et à la société libanaise en particulier. Comme le remarque Bourdieu, « la coupure sociale et mentale [de l’enfermement scolastique] ne se voit jamais aussi bien, paradoxalement, que dans les tentatives, souvent pathétiques et éphémères, pour rejoindre le monde réel, notamment à travers des engagements politiques (stalinisme, maoïsme, etc.) dont l’utopisme irresponsable et la radicalité irréaliste attestent qu’ils sont encore une manière de dénier les réalités du monde social11 ».
En 1980, le camp chrétien s’était déjà considérablement renforcé par rapport à 1975-1976, ce qui fragilise davantage le mobile moral de la défense des plus faibles. Mais, d’après B., il est difficile de retirer son soutien à ceux qui n’en ont plus besoin : « Quand une partie opprimée reçoit beaucoup de soutien, elle peut cesser d’être opprimée et devenir oppressante. Il faut savoir quand cesser d’apporter son soutien, le moment où celui-ci devient injuste et injustifié. S’il faut cesser de soutenir les opprimés dès qu’ils ne le sont plus, je n’aurais pas dû soutenir les Forces libanaises en 1980. Pourtant, c’est à ce moment-là que je me suis engagé complètement à leurs côtés, alors qu’éthiquement et moralement j’avais tort. C’est une espèce d’inertie, et, d’un autre côté, quand on est intéressé par une action politique, on est pris par le sens de l’aventure, etc. Ça devient un jeu. Ça a toujours été un jeu ».
De retour au Liban, B. rencontre Bachir Gemayel par le biais d’un ami de la famille mais ne met pas en valeur son passé « gauchiste » : « Mon passé n’a jamais été un atout pour moi aux FL. Certains étaient même convaincus que j’étais une taupe ». Il est recruté dans le renseignement « extérieur » (c’est-à-dire chargé de la partie du Liban qui n’est pas sous contrôle des Forces libanaises). Pourquoi avoir choisi le renseignement ? « C’était cela qui m’intéressait à cette époque. Je n’avais plus dix-sept, mais vingt-sept. Le combat à l’arme blanche n’existant pratiquement plus, le renseignement de source humaine me semblait être le dernier domaine guerrier où l’on pouvait se mesurer à l’ennemi d’homme à homme et, se faisant, le respecter pour gagner le respect de soi ».
Désidéologisation
Son travail consiste à recruter des sources d’information et à analyser les renseignements fournis. Il déchante vite. D’une part, le projet de foyer pan-chrétien est rapidement mis de côté par Bachir Gemayel puis, après l’assassinat de celui-ci, par son frère, Amine Gemayel : « Cette seconde expérience m’a ôté mes illusions, mes croyances et mon enthousiasme ». De plus, « le travail du renseignement éloigne des convictions et des préjugés. Il oblige à l’humilité et à la distance par rapport aux personnes censées représenter ses convictions et principes. Dans le renseignement, il n’y a que des nuances de gris, ce qui peut parfois mener au cynisme. On apprend que tout se vaut et que les gens qui se trouvent dans un camp ne sont pas pires ni meilleurs que ceux du camp d’en face. Cela m’a appris à respecter l’ennemi. Il est difficile de continuer de croire à la politique quand on est dans le renseignement. Les ficelles politiques sont trop grosses, on n’accroche plus au film ».
L’expérience du renseignement constitue une sortie de « l’enfermement scolastique » et une réintégration au monde social qui le mènent à ce qu’il appelle une « désidéologisation » survenue en 1982-1983 et qui, pour lui, est la véritable « conversion ». Il considère rétrospectivement que ses engagements aux deux extrêmes de la palette politique sont similaires, en ce qu’ils « font appel au refus de l’ordre établi, au sens de l’aventure, au goût pour la radicalité, la nouveauté, la découverte et le dépaysement ».
Un autre facteur de la désidéologisation de B. a été sa rencontre de la peur de son ennemi : « Un jour, peut-être en 1984, je me trouvais à Jbeil12 avec des miliciens des FL. Notre voiture en emboutit une autre. Mon chauffeur descend, il veut montrer qu’il est le plus fort, il est sur son terrain, il est milicien, il ne s’excuse pas mais prend à partie l’autre conducteur et lui demande ses papiers. Le conducteur était un musulman de Tripoli, et nous étions à un moment très tendu. Nous fouillons sa voiture et ne trouvons rien. Il prétend être boulanger. Je remarque que le coffre de sa voiture est tapissé de pages du Nida’, le quotidien du parti communiste libanais, que mon chauffeur ne connaissait pas. En principe, nous aurions dû immédiatement l’arrêter et l’emmener avec nous pour l’interroger, mais je l’ai laissé partir. Je me suis souvent demandé pourquoi. Peut-être parce que j’avais moi-même été gauchiste par le passé, peut-être aussi parce qu’il sortait de la ville plutôt que d’y entrer. J’avais aussi l’intuition qu’il ne représentait pas un danger. J’ai vu l’homme et sa peur ».
La prise de distance est aussi facilitée par le fait que B. doit interroger des détenus arrêtées de manière qu’il estime injuste et inutile. « Une autre fois, on m’a demandé d’interroger un jeune homme d’affaires libanais proche de Yasser Arafat et qui venait souvent à Beyrouth-Est. J’ai passé de longues séances d’interrogatoire avec lui. Là aussi, j’ai vu l’homme et sa peur, et j’ai compris qu’il ne représentait aucun danger pour nous. Ça m’a aussi aidé à me désidéologiser, d’autant plus que je sentais que l’arrestation n’était fondée que sur une espèce de règlement de comptes avec Arafat ». Parti à la rencontre de l’ennemi en rentrant au Liban, et cherchant, selon son propos cité plus haut, à se mesurer d’homme à homme à son ennemi afin de se faire respecter par lui et, ce faisant, gagner le respect de soi, c’est finalement la peur que B. rencontre, celle de l’ennemi comme la sienne.
Nous ne connaissons pas le degré d’implication de B. dans des actes de violence ou de torture. Mais sa désidéologisation semble correspondre à une restauration de la capacité d’empathie telle que celle-ci figure par exemple au programme de traitement des auteurs de violence, où l’individu est ramené à un fonctionnement projectif lui permettant de s’identifier à son prochain13, mais aussi d’accéder à ses propres émotions, comme si le rapport à soi passait par le rapport à autrui.
Intersubjectivité
En janvier 1986, une partie des FL menée par Samir Geagea attaque Elie Hobeika et les partisans de l’accord tripartite. Partisan de Hobeika, B. fuit vers l’Europe où il abandonne tout militantisme et fonde une agence de renseignement économique, mobilisant son expérience politique au profit d’un projet professionnel dans le domaine du conseil aux entreprises. Quelques années plus tard, cette expérience est aussi réinvestie dans l’écriture de romans d’espionnage mettant l’accent sur l’aspect interpersonnel du renseignement « à l’ancienne », celui où l’on faisait un effort pour gagner son adversaire à sa cause : « Dans l’histoire du renseignement, beaucoup d’agents ont été séduits par leur source et dès lors qu’il y a séduction, de part comme d’autre, tout devient possible. Ce qui est beau dans le renseignement humain, c’est que parfois, le moyen devient une fin. Cela ne peut pas exister dans le renseignement technologique qui est surtout intéressé par la neutralisation, l’éradication de la menace. Or moi, ce qui m’intéresse, c’est l’opération de séduction, la confrontation et l’échange des points de vue qui font que deux êtres finissent par créer une troisième personne commune aux deux ».
Ainsi, la désidéologisation de B. correspond à une conversion à l’altérité et au fonctionnement projectif, poursuivie notamment par l’écriture romanesque, avec l’accent mis sur l’intersubjectivité. Il n’y voit aucune dépolitisation mais une « autre manière de faire de la politique en commençant par soi, en essayant de garder toutes les options ouvertes et en essayant d’avoir sur les choses un regard frais, non-préprogrammé. Je ne dis pas que c’est facile. »
1Picaudou Nadine, La déchirure libanaise, Éditions Complexe, Paris, 1990.
2Favier Agnès, Logiques de l’engagement et modes de contestation au Liban. Genèse et Éclatement d’une génération de militants intellectuels, thèse sous la direction d’Yves Schmeil, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille, 2004.
3Groupuscule fondé par Waddah Charara et Fawaz Traboulsi autour du projet d’arabisation d’un marxisme proche des textes fondateurs, et faisant l’économie des gloses soviétiques. Il fusionnera en 1970 avec l’Organisation des socialistes libanais (OSL) pour créer l’Organisation de l’action communiste au Liban (OACL).
4Établissement scolaire jésuite.
5Le FDLP est un groupe militaire maoïste palestinien qui s’est formé en 1969 suite à une scission du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).
6Fils de Kamal Joumblatt qui, à l’époque, était le chef politique de la communauté druze.
7La communauté des Témoins de Jéhovah n’est pas reconnue par l’État libanais. Ses membres ne jouissent pas de la liberté du culte et sont la cible de rumeurs hostiles.
8Bourdieu Pierre & Passeron Jean-Claude, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Les éditions de minuit, Paris, coll. Le sens commun, 1964.
9Bourdieu Pierre, Méditations pascaliennes, Seuil, Paris, coll. Libé, 1997.
10Chrétiens du nord de la Syrie actuelle recrutés par les empereurs byzantins pour combattre les armées musulmanes. Les Mardaïtes se sont installées au Liban actuel en 660-680 et leur présence au Mont Liban est attestée jusqu’au début du Xe siècle. Pendant la guerre civile, la thèse, historiquement démentie, d’une origine mardaïte des maronites a servi à légitimer le projet d’un Liban pan-chrétien.
11Bourdieu Pierre, 1997, op. cit.
12Ville à majorité chrétienne située à 40 km au nord de Beyrouth.
13Sironi Françoise, Psychopathologie des violences collectives : essai de psychologie géopolitique clinique, Odile Jacob, Paris, 2007.
Sur le même sujet
- Race, classe, genre et sexualité : entre puissance d’agir et ambivalence coloniale
- Un momento contenporáneo:pensar los encuentros artísticos
- Questions d’Empire
- Intermède : extrait d’un roman
L’IA Eddie du vaisseau du Guide du voyageur galactique de Douglas Adams n’est pas tout à fait Hal 9000 de Kubrick - Le Blues, cette chanson si bruyante
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- Lire et télécharger les articles les plus récents sur CAIRN
- Faire l’Europe Fédérale, avec l’Ukraine (contre le DOGE d’hier et d’aujourd’hui)
- Super-héros Noirs, masques Blancs : Le mirage du film Black Panther