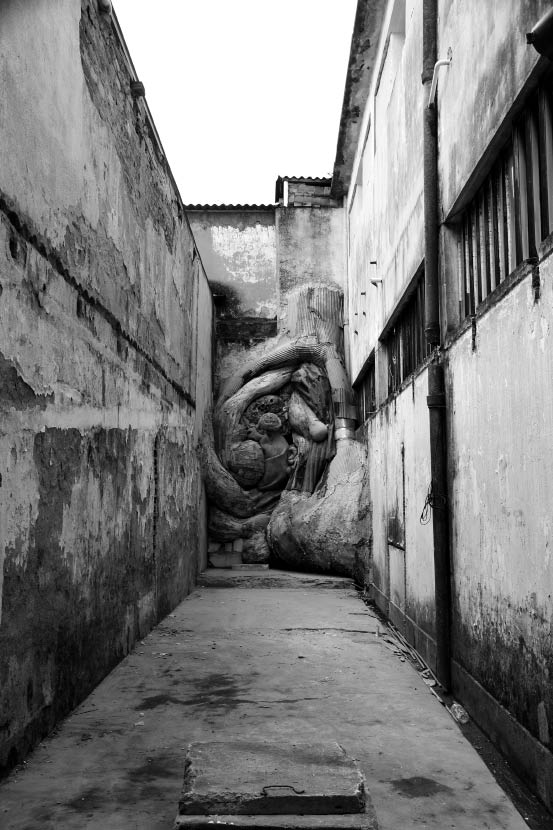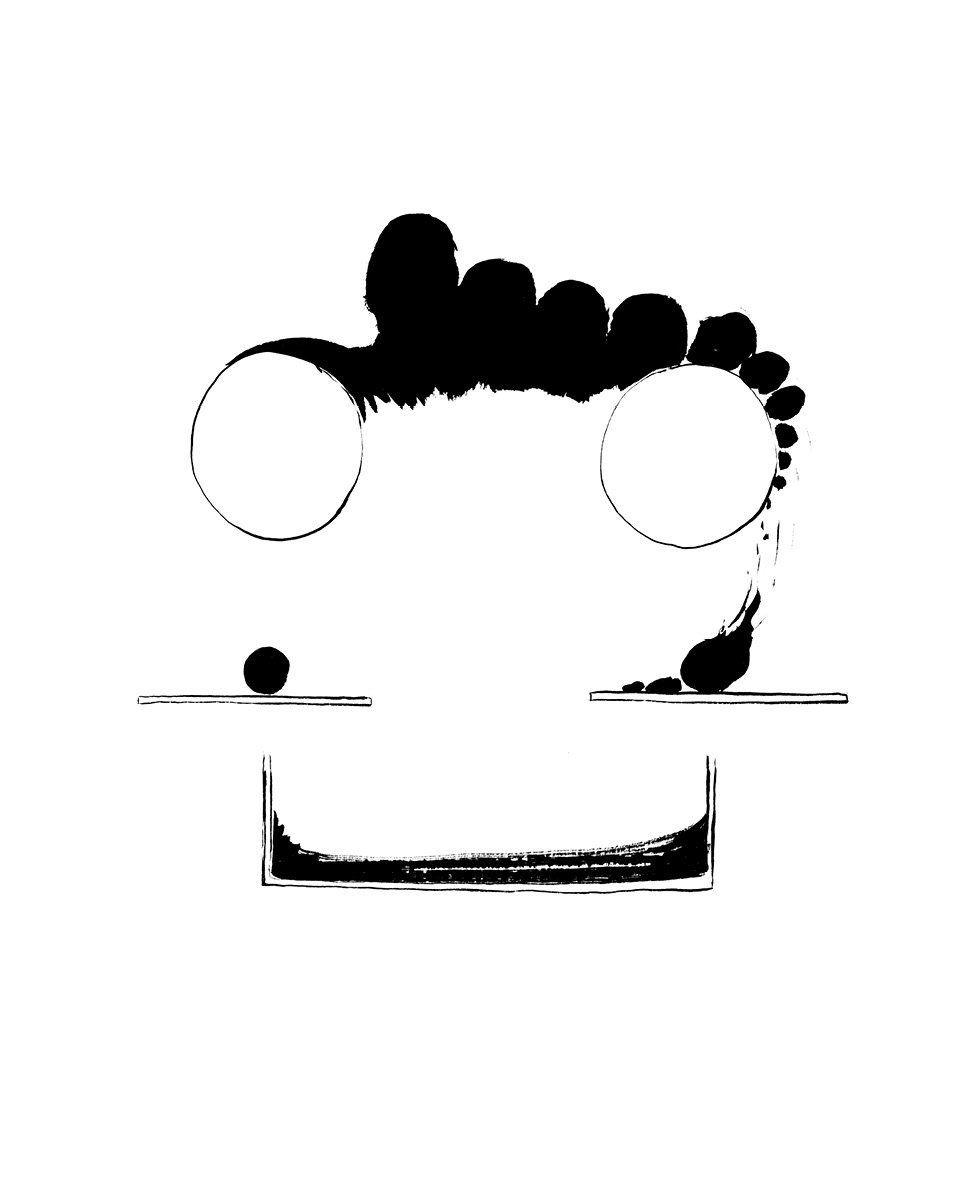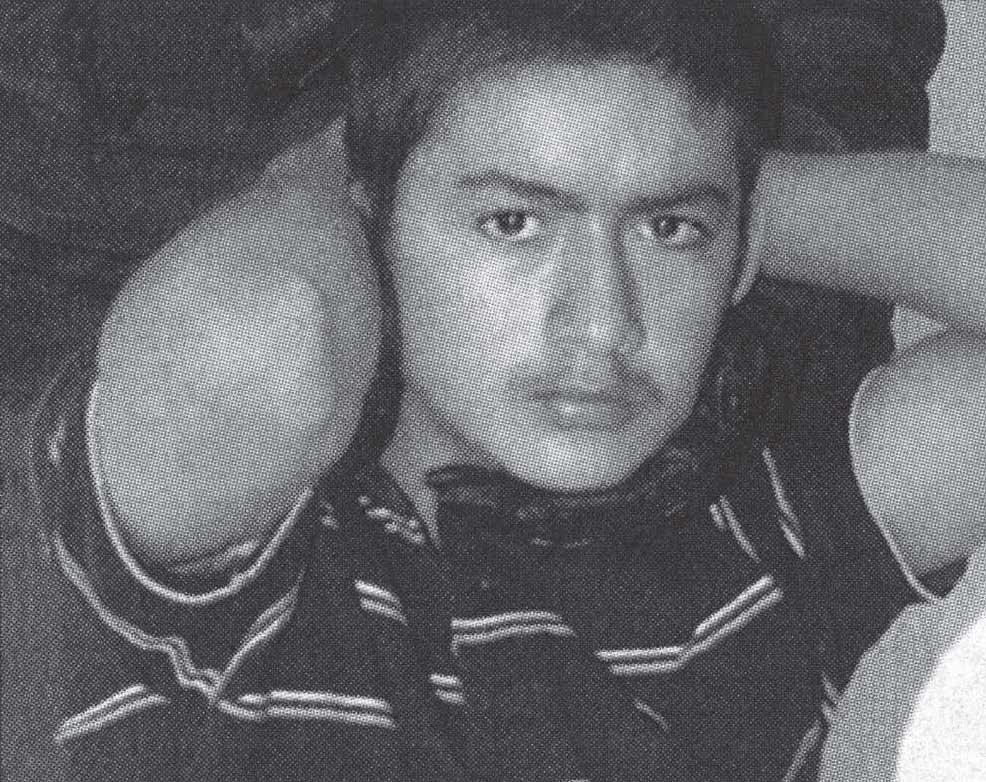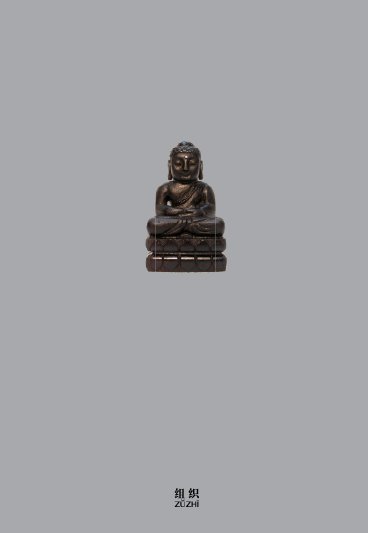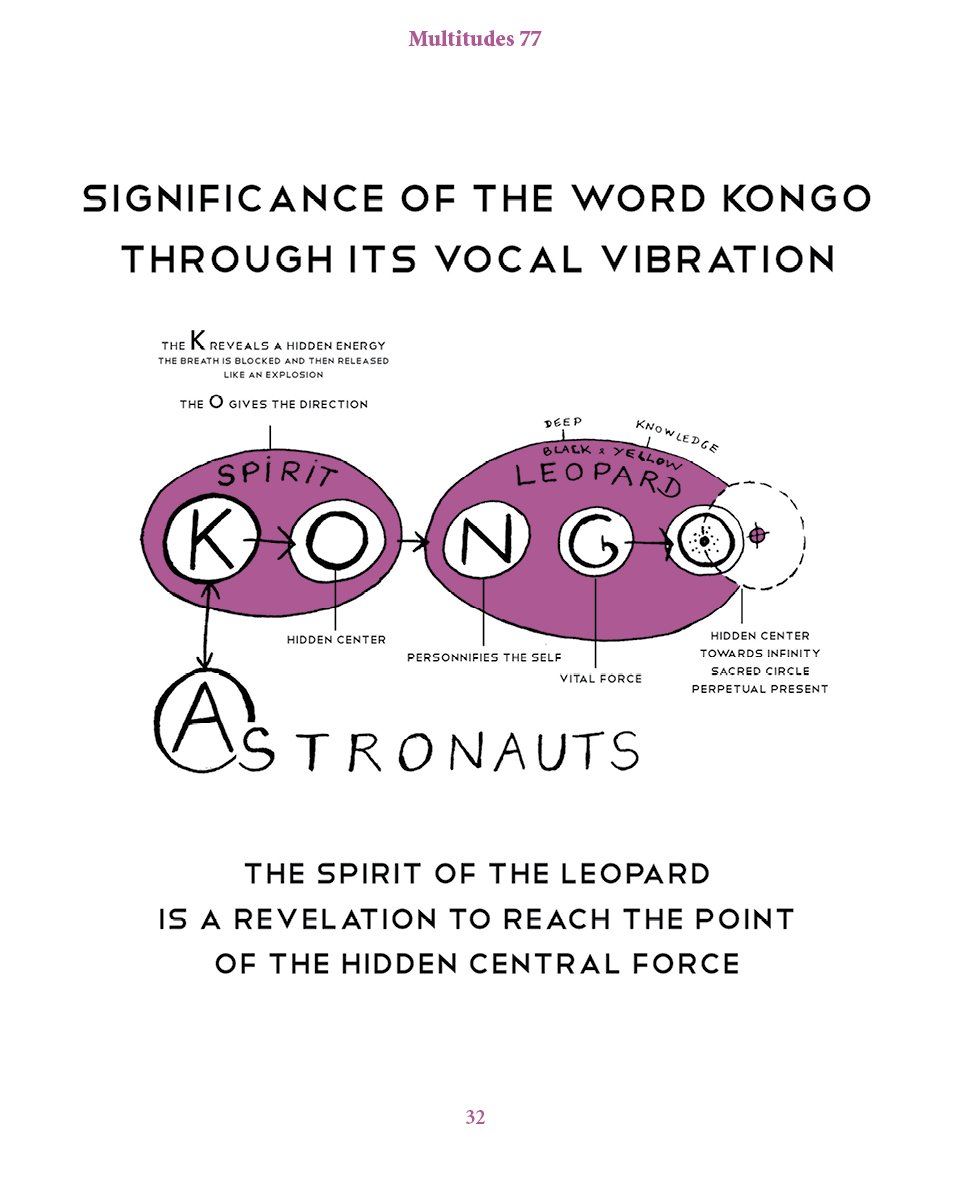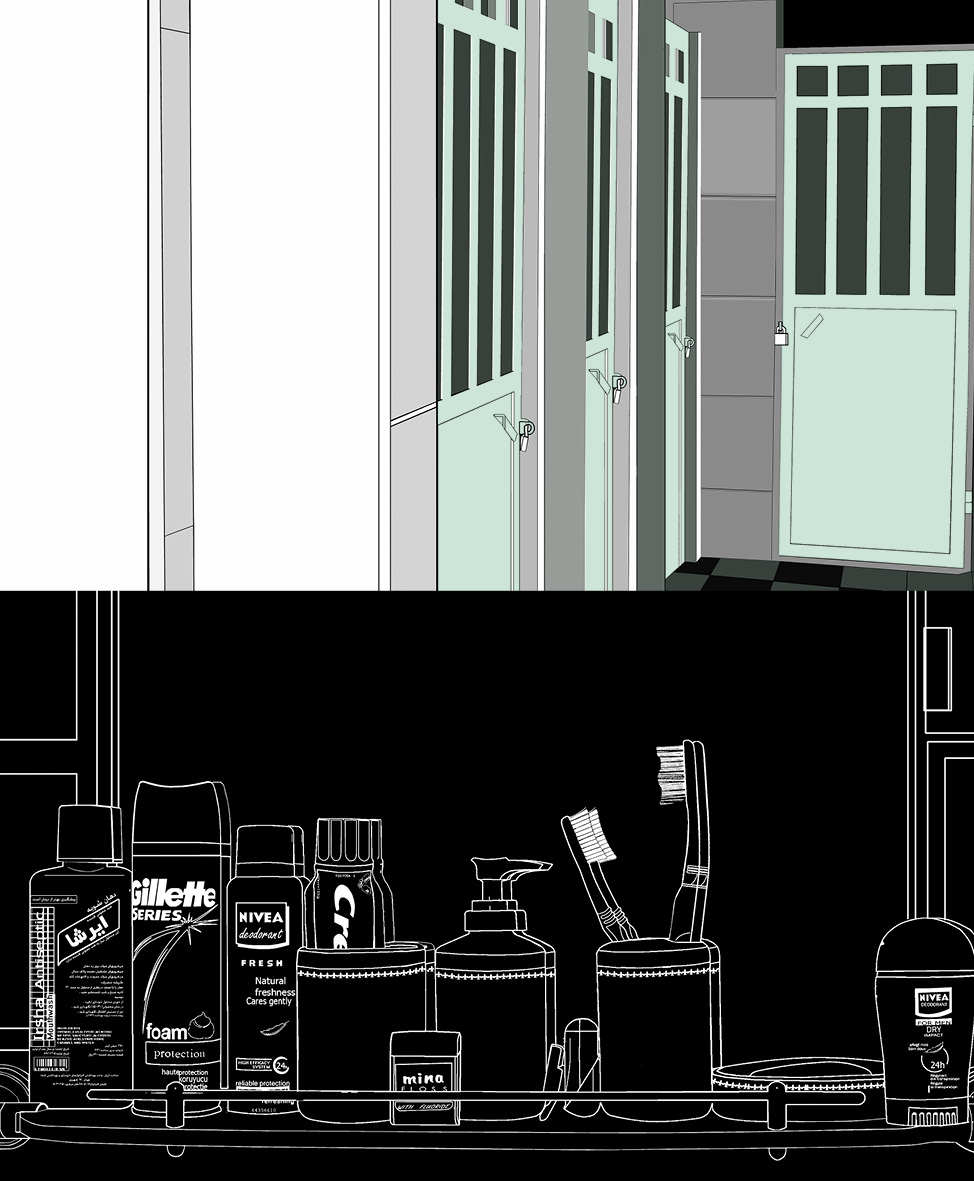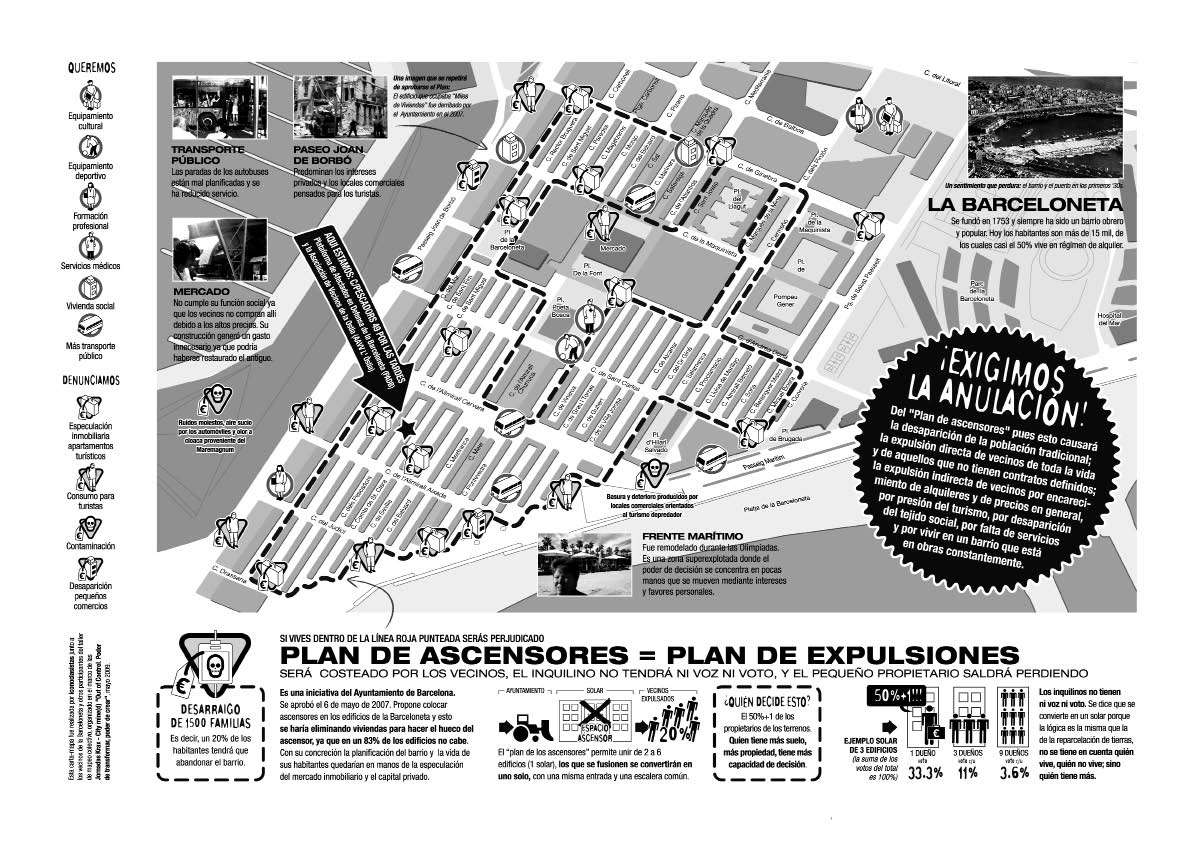Aout 1991: Le gai renoncement
L'affaiblissement de la pensée dans les années 80.
Réflexions d’un dinosaure sur l’anti-humanisme, par Macherey Pierre
Le livre que L. Ferry et A. Renaut ont consacré à ce qu’ils appellent “la pensée 68″[[La pensée 68 (Essai sur l’anti humanisme contemporain), Paris, Gallimard, 1985, cité ici d’après la rééd. Folio Essais, n’ 101, 1988, (P 68). constitue un indispensable instrument de travail pour quiconque veut réfléchir sur l’histoire de la philosophie en … Continuer la lecture de Réflexions d’un dinosaure sur l’anti-humanisme →
Francois Furet : l’histoire comme idéologie, par Riot-Sarcey Michèle
Qui dit que la France se transforme, qu’elle renonce à ses traditions les mieux enracinées ? François Furet nous démontre le contraire: grâce à la Révolution, il se taille un empire. Il n’est pas de dictionnaire qu’il ne rédige, d’étude sur la période qu’il ne préface, d’émission de télévision où il ne vienne apporter le … Continuer la lecture de Francois Furet : l’histoire comme idéologie →
Rawls : un formalisme fort dans la “pensée molle”, par Negri Toni
La nostalgie ontologique d’un formalisme fort Je ne pense pas qu’on puisse résister facilement à la fascination qu’exerce la “Théorie de la justice” de John Rawls. L’auteur, en effet, a l’audace de nous faire pénétrer dans le domaine de la théorie juridique pure et maintient le pari tout au long des cinq cents pages de … Continuer la lecture de Rawls : un formalisme fort dans la “pensée molle” →
La conversion rortyenne, par Hardt Michael
Dans l’oeuvre de Richard Rorty, la fameuse “conversation” qu’il exalte comme forme (nouvelle ?) de la philosophie, ou bien de la culture post philosophique, reste obscure et ambiguë. Avec qui converse t il ? Peut on localiser ses interlocuteurs dans des personnages spécifiques, actuels ou historiques ? Est ce que sa conversation est plutôt une … Continuer la lecture de La conversion rortyenne →
La pensée “faible” entre être et différence Esquisse critique d’une théorie molle, par Zanini Adelino
Condition et idéologie La manifestation d’une pensée “minimaliste” ne peut être imputée à une volonté, c’est le fruit d’une condition. C’est pour cela qu’il est difficile d’en parler : ce que l’on y choisit souvent ne lui appartient pas ce qui lui appartient n’est que l’aspect caricatural, un cadre enlaidi par une pseudo représentation tragique. … Continuer la lecture de La pensée “faible” entre être et différence Esquisse critique d’une théorie molle →
Un pas en avant, deux pas en arriére: la démocratie libérale et la philosophie selon Richard Rorty, par Bernstein Richard
Pendant les dernières décennies du XIXème siècle, John Dewey, fortement influencé dans sa jeunesse par les milieux Congrégationnalistes du Vermont, était en voie de “radicalisation”. C’était une période de grande fermentation aux États-Unis, à cause, entre autres, des effets de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides, des transformations démographiques provoquées par l’immigration, et de l’avènement d’une … Continuer la lecture de Un pas en avant, deux pas en arriére: la démocratie libérale et la philosophie selon Richard Rorty →
La fête de l’âne Quelques conséquences politiques de la pensée faible italienne, par Illuminati Augusto
Pour déchiffrer la nébuleuse de la “pensée faible” italienne, s allons partir essentiellement des écrits de Vattimo, parce ce philosophe a eu le double mérite de fabriquer les instruments théoriques d’une telle idéologie en réinterprétant et en acclimatant en Italie la pensée de Nietzsche et de Heidegger et de gérer allégrement (et “énergiquement”) le succès … Continuer la lecture de La fête de l’âne Quelques conséquences politiques de la pensée faible italienne →
Malaise dans la culture et démocratie : Sur quelques textes d’une pensée assimilée, par Amey Claude
À la suite de la pensée courte et réactionnelle des “nouveaux philosophes”, la décennie 80 a vu, au rythme d’une expansion culturelle tous azimuts et médiatique, l’essor d’une pensée plus élaborée, mais tout aussi réconciliatrice. Elle n’est plus exactement cette “vulgate [qui nous installait… dans une pensée molle, obsessionnellement modeste et faible, qui, portant haut … Continuer la lecture de Malaise dans la culture et démocratie : Sur quelques textes d’une pensée assimilée →
Qu’est-ce que juger? Hannah Arendt lectrice de Kant, par Revault d'Allones Myriam
“Sans cesse, on s’irrite de l’arbitraire de mes interprétations. Ce reproche trouvera dans cet écrit une excellent aliment. Ceux qui s’efforcent d’ouvrir un dialogue de pensées entre des penseurs sont justement exposés aux critiques des historiens de la philosophie. Un tel dialogue est pourtant soumis à d’autres lois que les méthodes de la philologie historique, … Continuer la lecture de Qu’est-ce que juger? Hannah Arendt lectrice de Kant →
Le Sujet et l’individu, par Vincent Jean-Marie
Le livre d’Alain Renaut “L’ère de l’individu, contribution à une histoire de la subjectivité”[[ Paris 1989. est un ouvrage qui ne laisse pas le lecteur indifférent. Les thèses qu’avance l’auteur sont en effet formulées clairement et vigoureusement; elles sont le plus souvent étayées par des arguments sérieux et par une érudition indéniable et maîtrisée. On … Continuer la lecture de Le Sujet et l’individu →
La pensée affaiblie, par Vincent Jean-Marie
Depuis le milieu des années soixante dix, la pensée critique est soumise à rude épreuve dans le monde occidental. La tradition marxiste, incapable de se renouveler et de faire ses comptes avec le “socialisme réel”, est entrée dans une crise dont elle ne s’est pas remise. Le discrédit qui l’a atteinte a rejailli très souvent … Continuer la lecture de La pensée affaiblie →
Avril 1997: Lire Althusser aujourd'hui
Machiavel selon Althusser, par Negri Toni
l. La recherche de l’unité de la connaissance et de l’action, c’est-à-dire l’appréhension du politique en tant que praxis intellectuelle transformatrice, constitue le fil rouge du matérialisme moderne et contemporain. Cela signifie que pour le matérialiste, et plus encore pour le marxiste, la pratique politique doit se faire rationnelle en « arrachant » le sens … Continuer la lecture de Machiavel selon Althusser →
Althusser lecteur d’Althusser, par Albiac Gabriel
I 1. Au début de L’avenir dure longtemps, nous trouvons cette surprenante déclaration d’intention : « Hélas, je ne suis pas Rousseau. Mais formant ce projet d’écrire sur moi et le drame que j’ai vécu et vis encore, j’ai souvent pensé à son audace inouïe. Non que je prétende jamais dire avec lui, comme au … Continuer la lecture de Althusser lecteur d’Althusser →
La récurrence du vide chez Louis Althusser, par Matheron François
« S’il est clair que nous sommes constamment devant une pensée théorique d’une grande rigueur, le point central où théoriquement tout se noue échappe interminablement à la recherche »[[Écrits philosophiques et politiques, T. II, Paris, Stock/Imec, 1995, p. 56. : telle est pour Althusser la substance même de la pensée de Machiavel, ce qui nous … Continuer la lecture de La récurrence du vide chez Louis Althusser →
Temps et concept chez Louis Althusser, par Ichida Yoshihiko
I Si l’on cesse de privilégier telle époque ou tel problème exprimé par Althusser, pour avoir avant tout une perspective, on s’aperçoit de l’existence des deux mouvements opposés. D’un côté, Althusser essaie sans cesse d’aller de l’avant, d’accélérer la vitesse de sa pensée. « Il faut aller plus loin, tirer plus de conséquences », dit-il … Continuer la lecture de Temps et concept chez Louis Althusser →
L’interdit biographique et l’autorisation de l’oeuvre, par Moulier Boutang Yann
L’interdit biographique d’un individu sans œuvre Althusser a fait l’objet d’une publication posthume. Celle-ci a révélé une oeuvre qui à son tour, entraîne une réévaluation de ses oeuvres anthumes. Ce paradoxe est redoublé si l’on ajoute l’interdit biographique qu’il a longtemps entretenu lui-même. La question classique de la légitimité d’une démarche biographique à l’égard d’un … Continuer la lecture de L’interdit biographique et l’autorisation de l’oeuvre →
Le théâtre n’est-il pour Althusser qu’un « risque fictif »?, par Howlett Marc-Vincent
N’ayant plus d’urgence, aux yeux de certains, à penser dans les termes du marxisme, il peut apparaître vain de réintroduire aujourd’hui une lecture d’Althusser. Pourtant on ne peut se déprendre d’un saisissemment, lorsque, à telle ou telle occasion, on relit ce qu’on a lu avec passion, et, malheureusement parfois, oublié avec une égale passion. Car … Continuer la lecture de Le théâtre n’est-il pour Althusser qu’un « risque fictif »? →
Avril 93: Féminismes au présent
Ce numéro sous la responsabilité de Michèle Riot- Sarcey a été conçu et préparé par Christine Planté et Eleni Varikas.
Sur” family Fortunes:Men and women of the english middle class, -“, par Gollis John R.
Les titres de la plupart des ouvrages sont trop prometteurs. Family Fortunes pèche dans la direction inverse. C’est un titre trop modeste pour un livre qui éclaire un sujet aussi important que l’émergence de la bourgeoisie anglaise moderne. Depuis 1963, quand E.P. Thompson a publié La formation de la classe ouvrière anglaise, la nécessité pour … Continuer la lecture de Sur” family Fortunes:Men and women of the english middle class, -“ →
Sur” L’anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe” de Nicole- Claude Mathieu, par Berger Denis
A la lecture de ce livre, on éprouve de la gêne. Ce sentiment ne naît pas du contenu de l’ouvrage. Bien au contraire, c’est le silence observé à propos d’un travail d’une telle qualité qui suscite le malaise. Inspirée par une critique féministe radicale – elle-même fortifiée par le combat des mouvements de femmes – … Continuer la lecture de Sur” L’anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe” de Nicole- Claude Mathieu →
Le féminisme en France, en Inde, et en Russie, par Haase-Dubosc Danièle
Maison des Sciences de l’homme, Indian Council of Social Research, Académie des sciences de Russie[[Avec le soutien de l’Unesco, du Secrétariat d’État aux Droits des femmes, du ministère de la Recherche et de l’Espace, de l’Association France-Union indienne et du C.E.D.R.E.F. (Université de Paris VII).. Compte rendu du colloque par Danièle Haase-Dubosc. Les rencontres étaient … Continuer la lecture de Le féminisme en France, en Inde, et en Russie →
Sexe, race, et pratique du pouvoir, l’idée de nature, par Lhomond Brigitte;
A l’heure où le féminisme est souvent considéré comme un archaïsme, à l’heure où ce que l’on nomme de manière un peu rapide « les idéologies » sont données pour mortes ou moribondes, à l’heure où les rapports entre les sexes sont pensés par certain(e)s comme un simple système symbolique, basé sur des rôles et … Continuer la lecture de Sexe, race, et pratique du pouvoir, l’idée de nature →
” Aux marges de la domination masculine: le féminisme”, par Fougeyrollas-Schwebel Dominique
La revue Actes de la recherche en sciences sociales a consacré deux numéros au thème « masculin-féminin » (juin et septembre 1990). Nous nous attarderons ici au traitement du féminisme et des féministes dans la contribution de Pierre Bourdieu, « La domination masculine » (n° 84, septembre 1990), qui prend le risque, en référence à … Continuer la lecture de ” Aux marges de la domination masculine: le féminisme” →
Sur ” Sexe et genre , de la hiérarchie entre les sexes”, par Echard Nicole
Ce volume réunit une vingtaine de contributions présentées lors du colloque « Sexe et genre » organisé, en 1989 à Paris, pour valoriser les résultats de l’un des thèmes du programme incitatif du C.N.R.S. « Recherches sur les femmes et recherches féministes ». Mis en place en 1983 sur l’initiative de l’anthropologue Maurice Godelier, ce … Continuer la lecture de Sur ” Sexe et genre , de la hiérarchie entre les sexes” →
Sur ” La fabrique du sexe Essai sur le corps et le genre en occident” de Thomas Larqueur, par Peyre Évelyne
Thomas Laqueur, dans son « Essai sur le corps et le genre en Occident », propose une lecture historique des notions de sexe biologique et de sexe social qu’il désigne respectivement par « sexe » et « genre ». Son matériau est principalement constitué d’écrits produits par les médecins et philosophes de l’Antiquité au début … Continuer la lecture de Sur ” La fabrique du sexe Essai sur le corps et le genre en occident” de Thomas Larqueur →
Sur ” L’exercice du savoir et la différence des sexes”, par Duroux Francoise
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » (Descartes, Discours de la méthode). « Qu’il y ait une théorie délirante de la division sexuelle est l’idéologie la mieux partagée » (S. Cottet, Freud et le désir de l’analyste). Comment ces deux propositions coexistent-elles ? Telle est la gageure que tentent … Continuer la lecture de Sur ” L’exercice du savoir et la différence des sexes” →
Sur ” Backlash, the undeclared war against women” de Susan Faludi, par LesselierClaudie
On assiste aux U.S.A., analyse une jeune journaliste, Susan Faludi, dans ce livre, qui a obtenu un grand succès, à un ensemble de contre-attaques remettant en cause les acquis obtenus par les femmes depuis le début de la « seconde vague » du féminisme. Sur ce phénomène, que l’on pourrait remarquer aussi dans d’autres pays, … Continuer la lecture de Sur ” Backlash, the undeclared war against women” de Susan Faludi →
Sur ” L’histoire des femmes en occident” de Michèle Perrot et Georges Duby, par Edelman Nicole
Le XXè siècle d’Histoire des femmes en Occident a pour ambition de proposer une approche sexuée du siècle et d’introduire une nouvelle lecture de l’histoire de notre temps. Dernier volume après ceux consacrés respectivement à l’Antiquité, au Moyen Age, aux XVIè-XVIIIè siècles et au XIXè siècle, ce tome s’inscrit à son tour dans une problématique … Continuer la lecture de Sur ” L’histoire des femmes en occident” de Michèle Perrot et Georges Duby →
Différenciation et indifférenciation Pour une relecture de Mélanie Klein, par Marini Marcelle.
Un travail important s’est fait ces vingt dernières années pour essayer de « reconnaître la différence sans figer les différends », comme le souligne Françoise Collin qui nous donne, dans Histoire des femmes[[Françoise Collin, «Différence et différend. La question des femmes en philosophie», in Georges Duby et Michèle Perrot Histoire des femmes, tome V, Laterza/ … Continuer la lecture de Différenciation et indifférenciation Pour une relecture de Mélanie Klein →
Le chromosome du crime, à propos de XY, par Le Doeuff Michèle.
Un compte rendu du dernier livre d’E. Badinter, XY, s’impose-t-il ? La meilleure conduite à tenir serait de l’ignorer, comme tant d’autres livraisons « si célèbres l’année dernière », et de développer une résistance vis-à-vis de ce que certains éditeurs parisiens appellent eux-mêmes « notre littérature kleenex ». Le genre se définit par le fait … Continuer la lecture de Le chromosome du crime, à propos de XY →
De l’obstacle à l’émancipation (critique d’une certaine idée de la communauté), par Thévenin Nicole-Edith
La pensée de gauche postmoderne de l’identité et de la société tente de fonder sa projection du futur à partir des éléments produits par le capital. Elle construit une théorie du sujet et de la subjectivité redéfinie dans la conception d’une communauté et d’une singularité conçues sans contradiction, reprenant au concept de multitude son extension … Continuer la lecture de De l’obstacle à l’émancipation (critique d’une certaine idée de la communauté) →
Le philosophe travesti ou le féminin sans les femmes, par Collin Francoise
Ce texte est celui, légèrement remanié, d’une communication présentée dans le cadre du Colloque: Les formes de l’anti féminisme contemporain, qui s’est tenu au Centre Georges-Pompidou à Paris en décembre 1991. Le titre, circonstanciel, a été maintenu.J’analyserai « les formes de l’antiféminisme contemporain », telles qu’elles se manifestent non dans la pratique sociale mais dans … Continuer la lecture de Le philosophe travesti ou le féminin sans les femmes →
Entretien avec Michèle Perrot, par Frédéric Brun
Christine Planté – La première question s’impose: elle concerne le succès de L’histoire des femmes, qui est très grand – et peut-être un peu inattendu. On peut s’interroger en termes sociologiques: pourquoi les gens achètent-ils ? – car, si les livres sont beaux, la lecture n’en est pas toujours évidente. On peut aussi se demander … Continuer la lecture de Entretien avec Michèle Perrot →
Questions de différence, par Planté Christine
Pour décrire les positions en présence dans les différents travaux concernant la place des femmes et les rapports sociaux entre les sexes, on a l’habitude de recourir aux termes, supposés antinomiques, d’égalité et de différence, ou encore on parle d’un féminisme égalitaire et d’un féminisme identitaire[[Cet usage est si général qu’il est difficile d’en fournir … Continuer la lecture de Questions de différence →
Nécessité de la psychanalyse, par Dhavernas Marie-Josèphe
La référence à la psychanalyse a un statut assez curieux dans le féminisme français ; à vrai dire, cette bizarrerie est à l’image de l’anomalie qui frappe la psychanalyse en tant que discipline, pas simplement dans les milieux féministes. En effet, tout se passe comme si elle n’était pas une discipline comme les autres. On … Continuer la lecture de Nécessité de la psychanalyse →
Freud encore, par Valantin Simone
L’idée vient parfois que l’on pourrait réécrire le réel contemporain de la féminité et élaborer des concepts complémentaires à la théorie freudienne. Les batailles féministes, depuis longtemps tenues à l’écart de la psychanalyse méfiante à l’égard de toute idéologie – hormis la sienne – font entendre des nouveautés du côté des représentations de la sexuation. … Continuer la lecture de Freud encore →
Féminisme, modernité, postmodernisme:pour un dialogue des deux cotés de l’océan, par Varikas Eleni
Si, dans ses versions dominantes, la réflexion féministe a historiquement montré un attachement pathétique au projet de la modernité, cette passion – malheureuse car trop souvent à sens unique – est en train de s’affaiblir quand elle ne se tourne pas purement et simplement en son contraire. Pour ne pas avoir rempli ses promesses émancipatrices, … Continuer la lecture de Féminisme, modernité, postmodernisme:pour un dialogue des deux cotés de l’océan →
Cet essentialisme qui n’ (en) est pas un, par Shor Naomi
Naomi Schor occupe la Chaire William Wannamaker de « Romance Studies » à Duke University, North Carolina. Elle a publié, entre autres ouvrages, Reading in Détail: Aesihetics and thé Féminine, New York, Methuen, 1987. Son prochain livre, est Idealism in the Novel: Recanonizing George Sand, à paraître aux Columbia University Press. Comme Jacques Derrida l’a … Continuer la lecture de Cet essentialisme qui n’ (en) est pas un →
Sur une dialectique féminine de la raison, par Weigel Sigrid
Penser et dire la position des femmes dans le processus de la civilisation Il[[Extrait du livre de Sigrid Weigel, Topographien der Geschlechter,. Reinbek bei Hamburg, ROwohlt Taschenbuch Verlag, 1990, pp. 18-39. n’existe que fort peu d’exemples d’une présentation de la dialectique de la Raison dans une perspective féminine qui soit aussi juste que dans le … Continuer la lecture de Sur une dialectique féminine de la raison →
Introduction, par Riot-Sarcey Michèle
En ces temps de crise des idéologies, le féminisme peut-il renouveler son potentiel critique ? Où plutôt, la réflexion théorique de type féministe peut-elle aider à dépasser les apories idéologiques par l’introduction d’idées façonnées dans la longue histoire des individus assujettis ? Depuis quelques années déjà, les approches se sont diversifiées, la différence des sexes … Continuer la lecture de Introduction →
De l’histoire politique et des pouvoirs, par Riot-Sarcey Michèle
S’il nous fallait rendre compte des discours d’exclusion des femmes de la cité, cet article n’y suffirait pas ; bien d’autres avant moi ont analysé ces discours, sans cependant infléchir l’écriture de l’histoire politique vers la critique des relations de pouvoir où s’inscrit le devenir historique des femmes. Du point de vue du mode de … Continuer la lecture de De l’histoire politique et des pouvoirs →
Articles
Différenciation et indifférenciation Pour une relecture de Mélanie Klein, par Marini Marcelle.
Un travail important s’est fait ces vingt dernières années pour essayer de « reconnaître la différence sans figer les différends », comme le souligne Françoise Collin qui nous donne, dans Histoire des femmes[[Françoise Collin, «Différence et différend. La question des femmes en philosophie», in Georges Duby et Michèle Perrot Histoire des femmes, tome V, Laterza/ … Continuer la lecture de Différenciation et indifférenciation Pour une relecture de Mélanie Klein →
Le chromosome du crime, à propos de XY, par Le Doeuff Michèle.
Un compte rendu du dernier livre d’E. Badinter, XY, s’impose-t-il ? La meilleure conduite à tenir serait de l’ignorer, comme tant d’autres livraisons « si célèbres l’année dernière », et de développer une résistance vis-à-vis de ce que certains éditeurs parisiens appellent eux-mêmes « notre littérature kleenex ». Le genre se définit par le fait … Continuer la lecture de Le chromosome du crime, à propos de XY →
De l’obstacle à l’émancipation (critique d’une certaine idée de la communauté), par Thévenin Nicole-Edith
La pensée de gauche postmoderne de l’identité et de la société tente de fonder sa projection du futur à partir des éléments produits par le capital. Elle construit une théorie du sujet et de la subjectivité redéfinie dans la conception d’une communauté et d’une singularité conçues sans contradiction, reprenant au concept de multitude son extension … Continuer la lecture de De l’obstacle à l’émancipation (critique d’une certaine idée de la communauté) →
Le philosophe travesti ou le féminin sans les femmes, par Collin Francoise
Ce texte est celui, légèrement remanié, d’une communication présentée dans le cadre du Colloque: Les formes de l’anti féminisme contemporain, qui s’est tenu au Centre Georges-Pompidou à Paris en décembre 1991. Le titre, circonstanciel, a été maintenu.J’analyserai « les formes de l’antiféminisme contemporain », telles qu’elles se manifestent non dans la pratique sociale mais dans … Continuer la lecture de Le philosophe travesti ou le féminin sans les femmes →
Entretien avec Michèle Perrot, par Frédéric Brun
Christine Planté – La première question s’impose: elle concerne le succès de L’histoire des femmes, qui est très grand – et peut-être un peu inattendu. On peut s’interroger en termes sociologiques: pourquoi les gens achètent-ils ? – car, si les livres sont beaux, la lecture n’en est pas toujours évidente. On peut aussi se demander … Continuer la lecture de Entretien avec Michèle Perrot →
Questions de différence, par Planté Christine
Pour décrire les positions en présence dans les différents travaux concernant la place des femmes et les rapports sociaux entre les sexes, on a l’habitude de recourir aux termes, supposés antinomiques, d’égalité et de différence, ou encore on parle d’un féminisme égalitaire et d’un féminisme identitaire[[Cet usage est si général qu’il est difficile d’en fournir … Continuer la lecture de Questions de différence →
Nécessité de la psychanalyse, par Dhavernas Marie-Josèphe
La référence à la psychanalyse a un statut assez curieux dans le féminisme français ; à vrai dire, cette bizarrerie est à l’image de l’anomalie qui frappe la psychanalyse en tant que discipline, pas simplement dans les milieux féministes. En effet, tout se passe comme si elle n’était pas une discipline comme les autres. On … Continuer la lecture de Nécessité de la psychanalyse →
Freud encore, par Valantin Simone
L’idée vient parfois que l’on pourrait réécrire le réel contemporain de la féminité et élaborer des concepts complémentaires à la théorie freudienne. Les batailles féministes, depuis longtemps tenues à l’écart de la psychanalyse méfiante à l’égard de toute idéologie – hormis la sienne – font entendre des nouveautés du côté des représentations de la sexuation. … Continuer la lecture de Freud encore →
Féminisme, modernité, postmodernisme:pour un dialogue des deux cotés de l’océan, par Varikas Eleni
Si, dans ses versions dominantes, la réflexion féministe a historiquement montré un attachement pathétique au projet de la modernité, cette passion – malheureuse car trop souvent à sens unique – est en train de s’affaiblir quand elle ne se tourne pas purement et simplement en son contraire. Pour ne pas avoir rempli ses promesses émancipatrices, … Continuer la lecture de Féminisme, modernité, postmodernisme:pour un dialogue des deux cotés de l’océan →
Cet essentialisme qui n’ (en) est pas un, par Shor Naomi
Naomi Schor occupe la Chaire William Wannamaker de « Romance Studies » à Duke University, North Carolina. Elle a publié, entre autres ouvrages, Reading in Détail: Aesihetics and thé Féminine, New York, Methuen, 1987. Son prochain livre, est Idealism in the Novel: Recanonizing George Sand, à paraître aux Columbia University Press. Comme Jacques Derrida l’a … Continuer la lecture de Cet essentialisme qui n’ (en) est pas un →
Sur une dialectique féminine de la raison, par Weigel Sigrid
Penser et dire la position des femmes dans le processus de la civilisation Il[[Extrait du livre de Sigrid Weigel, Topographien der Geschlechter,. Reinbek bei Hamburg, ROwohlt Taschenbuch Verlag, 1990, pp. 18-39. n’existe que fort peu d’exemples d’une présentation de la dialectique de la Raison dans une perspective féminine qui soit aussi juste que dans le … Continuer la lecture de Sur une dialectique féminine de la raison →
Introduction, par Riot-Sarcey Michèle
En ces temps de crise des idéologies, le féminisme peut-il renouveler son potentiel critique ? Où plutôt, la réflexion théorique de type féministe peut-elle aider à dépasser les apories idéologiques par l’introduction d’idées façonnées dans la longue histoire des individus assujettis ? Depuis quelques années déjà, les approches se sont diversifiées, la différence des sexes … Continuer la lecture de Introduction →
De l’histoire politique et des pouvoirs, par Riot-Sarcey Michèle
S’il nous fallait rendre compte des discours d’exclusion des femmes de la cité, cet article n’y suffirait pas ; bien d’autres avant moi ont analysé ces discours, sans cependant infléchir l’écriture de l’histoire politique vers la critique des relations de pouvoir où s’inscrit le devenir historique des femmes. Du point de vue du mode de … Continuer la lecture de De l’histoire politique et des pouvoirs →
Lectures, comptes rendus.
Sur ” L’exercice du savoir et la différence des sexes”, par Duroux Francoise
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » (Descartes, Discours de la méthode). « Qu’il y ait une théorie délirante de la division sexuelle est l’idéologie la mieux partagée » (S. Cottet, Freud et le désir de l’analyste). Comment ces deux propositions coexistent-elles ? Telle est la gageure que tentent … Continuer la lecture de Sur ” L’exercice du savoir et la différence des sexes” →
Sur ” Backlash, the undeclared war against women” de Susan Faludi, par LesselierClaudie
On assiste aux U.S.A., analyse une jeune journaliste, Susan Faludi, dans ce livre, qui a obtenu un grand succès, à un ensemble de contre-attaques remettant en cause les acquis obtenus par les femmes depuis le début de la « seconde vague » du féminisme. Sur ce phénomène, que l’on pourrait remarquer aussi dans d’autres pays, … Continuer la lecture de Sur ” Backlash, the undeclared war against women” de Susan Faludi →
Sur ” L’histoire des femmes en occident” de Michèle Perrot et Georges Duby, par Edelman Nicole
Le XXè siècle d’Histoire des femmes en Occident a pour ambition de proposer une approche sexuée du siècle et d’introduire une nouvelle lecture de l’histoire de notre temps. Dernier volume après ceux consacrés respectivement à l’Antiquité, au Moyen Age, aux XVIè-XVIIIè siècles et au XIXè siècle, ce tome s’inscrit à son tour dans une problématique … Continuer la lecture de Sur ” L’histoire des femmes en occident” de Michèle Perrot et Georges Duby →
Sur” family Fortunes:Men and women of the english middle class, -“, par Gollis John R.
Les titres de la plupart des ouvrages sont trop prometteurs. Family Fortunes pèche dans la direction inverse. C’est un titre trop modeste pour un livre qui éclaire un sujet aussi important que l’émergence de la bourgeoisie anglaise moderne. Depuis 1963, quand E.P. Thompson a publié La formation de la classe ouvrière anglaise, la nécessité pour … Continuer la lecture de Sur” family Fortunes:Men and women of the english middle class, -“ →
Sur” L’anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe” de Nicole- Claude Mathieu, par Berger Denis
A la lecture de ce livre, on éprouve de la gêne. Ce sentiment ne naît pas du contenu de l’ouvrage. Bien au contraire, c’est le silence observé à propos d’un travail d’une telle qualité qui suscite le malaise. Inspirée par une critique féministe radicale – elle-même fortifiée par le combat des mouvements de femmes – … Continuer la lecture de Sur” L’anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe” de Nicole- Claude Mathieu →
Le féminisme en France, en Inde, et en Russie, par Haase-Dubosc Danièle
Maison des Sciences de l’homme, Indian Council of Social Research, Académie des sciences de Russie[[Avec le soutien de l’Unesco, du Secrétariat d’État aux Droits des femmes, du ministère de la Recherche et de l’Espace, de l’Association France-Union indienne et du C.E.D.R.E.F. (Université de Paris VII).. Compte rendu du colloque par Danièle Haase-Dubosc. Les rencontres étaient … Continuer la lecture de Le féminisme en France, en Inde, et en Russie →
Sexe, race, et pratique du pouvoir, l’idée de nature, par Lhomond Brigitte;
A l’heure où le féminisme est souvent considéré comme un archaïsme, à l’heure où ce que l’on nomme de manière un peu rapide « les idéologies » sont données pour mortes ou moribondes, à l’heure où les rapports entre les sexes sont pensés par certain(e)s comme un simple système symbolique, basé sur des rôles et … Continuer la lecture de Sexe, race, et pratique du pouvoir, l’idée de nature →
” Aux marges de la domination masculine: le féminisme”, par Fougeyrollas-Schwebel Dominique
La revue Actes de la recherche en sciences sociales a consacré deux numéros au thème « masculin-féminin » (juin et septembre 1990). Nous nous attarderons ici au traitement du féminisme et des féministes dans la contribution de Pierre Bourdieu, « La domination masculine » (n° 84, septembre 1990), qui prend le risque, en référence à … Continuer la lecture de ” Aux marges de la domination masculine: le féminisme” →
Sur ” Sexe et genre , de la hiérarchie entre les sexes”, par Echard Nicole
Ce volume réunit une vingtaine de contributions présentées lors du colloque « Sexe et genre » organisé, en 1989 à Paris, pour valoriser les résultats de l’un des thèmes du programme incitatif du C.N.R.S. « Recherches sur les femmes et recherches féministes ». Mis en place en 1983 sur l’initiative de l’anthropologue Maurice Godelier, ce … Continuer la lecture de Sur ” Sexe et genre , de la hiérarchie entre les sexes” →
Sur ” La fabrique du sexe Essai sur le corps et le genre en occident” de Thomas Larqueur, par Peyre Évelyne
Thomas Laqueur, dans son « Essai sur le corps et le genre en Occident », propose une lecture historique des notions de sexe biologique et de sexe social qu’il désigne respectivement par « sexe » et « genre ». Son matériau est principalement constitué d’écrits produits par les médecins et philosophes de l’Antiquité au début … Continuer la lecture de Sur ” La fabrique du sexe Essai sur le corps et le genre en occident” de Thomas Larqueur →
Décembre 1993 : Sur Althusser, passages
Note complémentaire à «la lecture symptomale chez Louis Althusser», par Vincent Jean-Marie
La méfiance d’Althusser à l’égard des sciences humaines et sociales est restée très grande dans tous ses écrits des années soixante-dix. Dans Positions il parle même à leur propos d’imposture, mais, et c’est cela qui est frappant, il ne se donne guère la peine de justifier ce rejet global. Dans ce domaine le philosophe n’a, … Continuer la lecture de Note complémentaire à «la lecture symptomale chez Louis Althusser» →
«On naît toujours quelque part», par Thévenin Nicole-Edith
Penser n’est pas exprimer mais, comme dirait Hegel, repenser. C’est un penser « sur » qui est un penser « avec ». Cela ne relève pas de l’application ou de l’extraction (d’une théorie), mais de la production c’est-à-dire de la transformation qui fait qu’un concept travaille dans et avec la matière. Penser est un acte … Continuer la lecture de «On naît toujours quelque part» →
A propos de Politique et philosophie dans l’oeuvre de Louis Althusser, par Karsenti Bruno
Avec la publication du recueil Politique et philosophie dans l’ceuvre de Louis Althusser[[PUF, collection « Pratiques théoriques », 1993, Ouvrage sous la direction de Sylvain Lazarus, avec les textes de S. Lazarus, A. Badiou, J. Rancière, J.M. Vincent, E. Balibar, F. Demichel, C. Preve, E. Terray, F. Regnault. L’intervention de J.-M. Vincent, « La lecture … Continuer la lecture de A propos de Politique et philosophie dans l’oeuvre de Louis Althusser →
Lettre à Merab, par Althusser Louis
La lettre ci-dessous est extraite de la correspondance échangée par Louis Althusser avec son ami le philosophe géorgien Merab Mamardachvili, évoqué dans l’Avenir dure longtemps (p. 182), avec qui il entretenait une importante relation épistolaire depuis 1968. Décédé en 1990, Merab Mamardachvili, spécialiste de la philosophie occidentale, a enseigné à Moscou, puis à Tbilissi à … Continuer la lecture de Lettre à Merab →
Sur la pensée marxiste, par Althusser Louis
Rédigé et dactylographié en juillet 1982, ce texte comportait à l’origine deux indications manuscrites de Louis Althusser : son titre « Sur la pensée marxiste » et la mention « Définitif ». Entreprenant à l’automne 1982 la rédaction d’un livre de « bilan théorique », Louis Althusser décide alors d’en faire le chapitre XI, rayant … Continuer la lecture de Sur la pensée marxiste →
La folie, la théorie, la politique, par Berger Denis
Enfin, le silence ! Les autobiographies de Louis Althusser ont cessé d’être la pâture des médias[[Louis Althusser, L’Avenir dure longtemps, suivie de Les Faits. Autobiographies (Paris, Stock-Imcc, 1992, IX-356 p.). Etablie par Olivier Corpet et Yann Moulier Boutang, l’édition comporte deux textes d’inégale longueur. Le plus important, qui donne son titre à l’ouvrage, date de … Continuer la lecture de La folie, la théorie, la politique →
Pour Althusser : notes sur l’évolution de la pensée du dernier Althusser, par Negri Toni
« Quelque chose s’est brisé » Quand Althusser, intervenant au colloque du Manifesto, à Venise en 1977, part pour ouvrir son discours[[L. Althusser, Intervention au Colloque de Venise sur la crise du marxisme, novembre 1977 (feuillets manuscrits, Archives IMEC). Voir aussi L. Althusser, Enfin la crise du marxisme, in : Il Manifesto, Pouvoir et opposition … Continuer la lecture de Pour Althusser : notes sur l’évolution de la pensée du dernier Althusser →
La lecture symptomale chez Althusser, par Vincent Jean-Marie
[[Communication au colloque sur Althusser de l’Université de Paris (janvier 1991) déjà parue l’ouvrage Politique et philosophie dans l’Œuvre Althusser, sous la direction de Sylvain Lazarus, PUF, 1993.On a souvent accusé Louis Althusser de scientisme et de dogmatisme dans les milieux les plus divers. Pourtant un certain nombre de ses textes ont une portée tout … Continuer la lecture de La lecture symptomale chez Althusser →
Juin 1992: Le texte et son dehors.
Autour de la littérature et de son esthétique
Connaître la littérature, connaître avec la littérature, par Macherey Pierre
Claude Amey. – Dans votre dernier livre A quoi pense la littérature ?, vous posez la question de l’approche des textes littéraires en terme de philosophie. Alors d’emblée, pour aborder le thème central de ce supplément de Futur antérieur, est-ce qu’il s’agit de réactiver la démarche philosophique en la matière, comme une voie d’accès aux … Continuer la lecture de Connaître la littérature, connaître avec la littérature →
L’esthétique de la déconstruction, du romantisme à Nietzsche et Derrida, par Zima Pierre V.
Refoulée par la sémiotique, la psychanalyse et d’autres sciences sociales, l’esthétique est devenue en France un phénomène marginal souvent relégué aux échelons de la spéculation métaphysique. Bien qu’elle soit à certains égards un produit de la philosophie idéaliste allemande des siècles passés (le mot aesthetica/Ästhetik a été introduit par A. G. Baumgarten – 1714-1762 – … Continuer la lecture de L’esthétique de la déconstruction, du romantisme à Nietzsche et Derrida →
La querelle des modernes et des post-modernes, par Leenhardt Jacques
Le trois centième anniversaire de la Querelle des Anciens et des Modernes n’est pas encore célébré qu’on a déjà enterré la modernité. Et cela n’est même plus une nouveauté puisqu’on peut dire qu’il y a déjà bien un siècle que son cadavre se décompose, même si on peut encore se faire un petit nom en … Continuer la lecture de La querelle des modernes et des post-modernes →
Les symboliques et l’ouverture du texte, par Viala Alain
L’esthétique a des objets très concrets. Aussi, plutôt que d’exposer ici quelque élément de réflexion lancés d’abord dans des modèles abstraits il est je crois, plus pertinent de cheminer à partir de questions nées de la pratique. La mienne est essentiellement critique (en cela elle se distingue des logiques de la création ou du « … Continuer la lecture de Les symboliques et l’ouverture du texte →
Kant sans Kant, ou le plaisir du sens littéraire, par Amey Claude
Peut-être pour la première fois dans l’histoire occidentale pouvons-nous envisager l’art en tant qu’expérience que l’homme en fait, dans le cadre de l’expérience qu’il fait du monde, certes, mais délestée des dogmes, des tutelles prescriptives sinon des illusions et alibis normatifs. L’objectivité du beau, le caractère « affirmatif » de la culture, le bon office … Continuer la lecture de Kant sans Kant, ou le plaisir du sens littéraire →
Vittorini fait un clin d’oeil à Glenn Gould (Esquisse pratique pour une conversation fabulée), par Passerone Giorgio
A la fin de Conversation en Sicile, la simple présence d’une voix-off souhaite au roman d’être retrouvé dans une bouteille à la mer et indique à la manière d’Adorno, le modèle de la seule « communication » utile pour nous aujourd’hui : à contretemps des idéaux intersubjectifs et de leurs pratiques qui constituent le consensus … Continuer la lecture de Vittorini fait un clin d’oeil à Glenn Gould (Esquisse pratique pour une conversation fabulée) →
Prophéthie et narration ( réflexion à partir de Max Weber), par Despoix Philippe
Max Weber a laissé, même si c’est sous forme fragmentaire, une « sociologie de l’art » qui reste méconnue. Les formes d’art y sont traitées sous deux angles distincts : celui des transformations des matériaux et des techniques, et celui des processus de valorisation esthétique proprement dits. Les premières sont l’objet d’une histoire de l’art … Continuer la lecture de Prophéthie et narration ( réflexion à partir de Max Weber) →
Autour d’un malentendu : sur l’enjeu de la littérature nationale chez Herder, par Modigliani Denise
Il y a une historicité de la lecture de Herder. Par exemple en France. Où Herder, méconnu bien que souvent cité, devient à présent un enjeu. Pour divers débats européens, suscités par les bouleversements géopolitiques récents, et se rattachant pour la plupart aux questions posées par les nationalités. Débats dont le point de vue, par … Continuer la lecture de Autour d’un malentendu : sur l’enjeu de la littérature nationale chez Herder →
Chant du cygne/ chant des pistes, par Arcuri Carlo
Ces notes sont consacrées à la voix et à la fragilité de son statut. Si éloignés que nous soyons des époques « à forte teneur orale », des pratiques et de la « théâtralité » littéraires de l’Antiquité et du Moyen-age, l’articulation de la voix nous convoque cependant à sa rencontre. Sous quelle forme et … Continuer la lecture de Chant du cygne/ chant des pistes →
Présentation, par Arcuri Carlo
Notre condition présente est marquée par le délestage. L’idéologie du capital-parlementarisme ne parle plus de ses dossiers tant ses tiroirs sont vides, sauf à compter les prestations philosophiques qui prétendent redorer ses valeurs en dépit du flagrant démenti que l’état du monde leur inflige ; et la barque des idéaux du communisme s’est échouée sur … Continuer la lecture de Présentation →
Esthésis – anesthésie, par Faye Jean-Pierre
Nous nous éloignons lentement – des moments dérisoires. Il fut un moment où le monde était livré aux textuaires. Ceux-là prônaient un univers caché dans un cahier. L’instant intéressant est, à l’inverse, celui où le souffle ouvre les pages, et fait voler leurs lettres dans l’univers. Ce vol des lettres est notre énigme. Je m’attarderai … Continuer la lecture de Esthésis – anesthésie →
L’oubli, la trace et la fiction : sur la généalogie du roman entre l’épigraphe funéraire et la parodie de Plutarque, par Angenot Marc
Mikhail Bakhtine allait répétant vers 1930 une petite phrase qui devait contribuer à lui créer des problèmes avec les autorités bolcheviques : « Les Soviets ne s’occupent pas assez des morts ! » Trait de mysticisme peut-être, mais de quel mysticisme exactement ; quel pouvait être le devoir des Soviets vis-à-vis des morts ? C’est … Continuer la lecture de L’oubli, la trace et la fiction : sur la généalogie du roman entre l’épigraphe funéraire et la parodie de Plutarque →
Pour une esthétique du témoignage, par Clancy Geneviève
« Le murmure angoissé des luttes souterraines pour ceux qui ont appris à lire dans les ténèbres[[Kateb Yacine : L’oeuvre en fragments, Ed. Sinbad.. » Comment lire entre les brisures des faits ? Comment pénétrer entre les récifs de durées, de ruines et d’amour ? Comment dire l’histoire des exigences, des urgences, des gestes éclairs, … Continuer la lecture de Pour une esthétique du témoignage →
Juin 1994: Amérique latine démocratie et exclusion
Au delà des transitions à la démocratie en Amérique latine, par Cavarozzi Marcelo
Au-delà des transitions à la démocratie en Amérique latine Les transitions à la démocratie : convergences et voies divergentes En 1982, le ministre mexicain des finances, Jesús Silva Herzog, est arrivé aux États-Unis pour annoncer que son pays Wavait plus continuer à rembourser sa dette extérieure. La déclaration de Silva Herzog fut rapidement suivie de … Continuer la lecture de Au delà des transitions à la démocratie en Amérique latine →
Le Mexique néo-libéral : globalisation autoritaire avec transition à la démocratie?, par Zermeno Sergio
Nous tenterons ici de répondre à ce qui apparaît comme le paradoxe le plus frappant de la société mexicaine, et d’une certaine manière de toute l’Amérique latine en cette fin de millénaire : a) d’une part la tendance vers un renforcement de certains traits propres aux régimes démocratiques : la renaissance du jeu des partis, … Continuer la lecture de Le Mexique néo-libéral : globalisation autoritaire avec transition à la démocratie? →
Colonialité du pouvoir et démocratie en Amérique latine, par Quijano Anibal
Tutti i cittadini erano eguali di fronte a la legge, ma non tutti erano cittadini nella Cacania di Robert Musil. Ana Maria Merlo: ” Allez enfants, paria di Francia”. Il Manifesto, Rome, 14 mai 1993. La citoyenneté en question Dans les sociétés appelées modernes, la citoyenneté est une institution de la sphère politique du pouvoir. … Continuer la lecture de Colonialité du pouvoir et démocratie en Amérique latine →
Démocratie et citoyenneté en Amérique latine, par Cammack Paul
Démocratie latino-américaine et théorie empirique Il est à la fois curieux et éclairant de constater que l’épanouissement de la démocratie en Amérique latine et ailleurs dans les années 80 a coïncidé avec l’échec patent des efforts béhavioristes pour forger les bases d’une compréhension scientifique de la politique en général et de la démocratie en particulier. … Continuer la lecture de Démocratie et citoyenneté en Amérique latine →
Démocratie , libéralisme et socialisme “rénové” au Chili, par Cohen James
En octobre 1988 les électeurs chiliens ont voté « non » à 54 % au référendum organisé par le général. Pinochet. Le dictateur leur demandait de se prononcer sur sa proposition de rester en place pendant huit années supplémentaires. Cette victoire inattendue de l’opposition a créé une dynamique entraînant Pinochet à négocier, bien malgré lui, … Continuer la lecture de Démocratie , libéralisme et socialisme “rénové” au Chili →
La pauvreté en Amérique latine : y-a-t-il une issue équitable ?, par Salama Pierre
L’objet de cet article est d’étudier l’évolution du profil de la distribution des revenus lorsque des politiques économiques libérales sont mises en place pour sortir de la crise, rétablir l’équilibre du budget, réduire l’inflation, renouer avec la croissance, fût-elle faible, quitte à ce que le désiquilibre des échanges extérieurs se creuse profondément. Ces sorties de … Continuer la lecture de La pauvreté en Amérique latine : y-a-t-il une issue équitable ? →
Restructuration productives et changements dans la division sexuelle du travail et de l’emploi Argentine, Brésil, Mexique, par Rodlan Martha
Introduction L’évolution récente de l’économie des pays semiindustrialisés d’Amérique latine conduit souvent à des diagnostics hâtifs. La reprise de la croissance du PIB (après une décennie perdue) est souvent présentée comme la preuve que les politiques néo-libérales ont réussi à faire émerger un nouveau régime d’accumulation stable. Les restructurations productives permettraient ainsi aux grands pays … Continuer la lecture de Restructuration productives et changements dans la division sexuelle du travail et de l’emploi Argentine, Brésil, Mexique →
L’impact de l’ALENA sur les travailleurs : quelques théses, par Alvarez Béjar Alejandro
L’arrière-fond macro-économique 1. Depuis une décennie[[Ces thèses ont été présentées par l’auteur dans une table ronde sur l’ALENA et le travail à Sacramento (Californie) en septembre 1993., le gouvernement mexicain poursuit une politique économique impopulaire, sous le signe de la « stabilisation » et de la « modernisation », en prétendant que des mesures d’austérité … Continuer la lecture de L’impact de l’ALENA sur les travailleurs : quelques théses →
Mouvements sociaux et pouvoir politique : développements en Amérique latine, par Fals Borda Orlando
Plus de vingt ans[[Orlando Fals Borda est un éminent sociologue latino-américain, professeur émérite de l’université nationale de Colombie et ancien ministre de l’agriculture. L’article qui suit, écrit en 1990, est devenu un texte de référence parmi ceux qui réfléchissent sur l’évolution des mouvements sociaux en Amérique latine. Si certains détails factuels dans ce texte paraissent … Continuer la lecture de Mouvements sociaux et pouvoir politique : développements en Amérique latine →
Théses sur la vidéo-politique, par Landi Oscar
Lorsqu’enfin nous l’éteignons, après avoir pris cette décision plusieurs fois sans trouver la volonté de la concrétiser, le téléviseur entre de façon désenchantée dans le monde des objets et nous pouvons le percevoir comme un appareil de plus. Il suffit d’appuyer sur le bouton de télécommande pour que, de nouveau, il se transforme et nous … Continuer la lecture de Théses sur la vidéo-politique →
Les mouvements des femmes en Amérique latine : un questionnement exogène, par Le Doaré Hélène
Aprendi a ser mulher, sai do corredor e da sala, ganhei mundo Juntei meus pedaços e me fiz inteira Aprendi a ser plural : mulheres em movimento continuo Nosotras las mujeres siempre nos juntamos por algo, para recibir, para aprender; no hay tiempo que perder, pués ——– Les nouvelles formes d’insertion internationale, dans un double … Continuer la lecture de Les mouvements des femmes en Amérique latine : un questionnement exogène →
L’Amérique latine sous le signe de l’exclusion, par Cohen James
Les transformations profondes dont l’Amérique latine est à l’heure actuelle le laboratoire sont aux antipodes de celles imaginées par la gauche il y a 20 ans. La tendance dominante est celle du néo-libéralisme, avec sa logique sociale perverse : d’une part, l’intégration des classes dominantes dans l’élite du système mondial et d’autre part l’exclusion sociale … Continuer la lecture de L’Amérique latine sous le signe de l’exclusion →
Politique culturelle , culture politique ( une expérience de gouvernement dans la ville de Sao-Paulo, par Chaui Marilena
Le défi Entre 1989 et 1992, dans la ville de São Paulo, le Parti des Travailleurs a été à la tête du gouvernement municipal qui a vu, pour la première fois dans les cinq siècles d’existence du Brésil, un parti de gauche avec de solides origines populaires au pouvoir. Le défi imposé par les conditions … Continuer la lecture de Politique culturelle , culture politique ( une expérience de gouvernement dans la ville de Sao-Paulo →
Une révolution démocratique au Brésil, par Lula (Luis Ignacio da Silva)
Pendant le régime militaire, le général Médici, un des dictateurs de service, a eu un accès de sincérité en déclarant : “l’économie va bien mais le peuple va mal”. Il parcourait alors le Nord-Est brésilien où se concentrent des signes impressionnants de misère et avait été surpris par le spectacle de pauvreté qu’il avait devant … Continuer la lecture de Une révolution démocratique au Brésil →
La science politique face aux transitions démocratiques en Amérique latine, par Cohen James
Depuis une dizaine d’années on assiste au développement d’une véritable industrie internationale d’études politiques sur les transitions démocratiques en Europe de l’Est, dans le Tiers-Monde et tout particulièrement en Amérique latine. Ces études ont parfois atteint une grande rigueur, mais à l’intérieur d’un champ défini en termes strictement politologiques. Nous examinerons ici de plus près … Continuer la lecture de La science politique face aux transitions démocratiques en Amérique latine →
Ou va le Mexique?, par Cardenas Cuauhtemoc
Le cri de révolte du Chiapas[[Cauhtemoc Cárdenas est le porte-parole de l’Alliance démocratique nationale, qui regroupe l’essentiel des forces de gauche et d’extrême gauche ainsi que de nombreux syndicats et associations de quartiers. C’est à ce titre qu’il est candidat aux élections présidentielles qui se dérouleront en août 1994. – Cet article a été publié … Continuer la lecture de Ou va le Mexique? →
Quel avenir pour la gauche latino-américaine?, par Cohen James
Le cycle révolutionnaire des années 60 en Amérique latine est arrivé à son terme, on le sait depuis quelques années déjà. Mais à l’heure de la globalisation économique et des plans d’ajustement structurel, sous quel signe et au nom de quels idéaux la gauche latino-américaine peut-elle bien renouveler sa lutte ? Dans un livre qui … Continuer la lecture de Quel avenir pour la gauche latino-américaine? →
Le Mexique , entre Zapata et la tentation autoritaire, par Gomez Luis E.
Deux événements ont profondément marqué la vie politique mexicaine de ces derniers mois : le soulèvement néo-zapatiste dans l’État de Chiapas et l’assassinat inattendu de Luis-Donaldo Colosio, dauphin du président sortant Carlos Salinas et candidat officiel à la succession. Que signifient ces événements et quelles issues politiques permettront d’éviter que les contradictions de la société … Continuer la lecture de Le Mexique , entre Zapata et la tentation autoritaire →
Le forum de Sao-Paulo, par Löwy Michael
En 1924, José Carlos Mariátegui, le plus grand penseur marxiste latino-américain – dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance – écrivait ceci, dans un article intitulé ” Le Premier Mai et le Front Unique ” : ” Former un front uni c’est avoir une action solidaire face à un problême concret, face … Continuer la lecture de Le forum de Sao-Paulo →
Globalisation et transformations socio-économiques
La pauvreté en Amérique latine : y-a-t-il une issue équitable ?, par Salama Pierre
L’objet de cet article est d’étudier l’évolution du profil de la distribution des revenus lorsque des politiques économiques libérales sont mises en place pour sortir de la crise, rétablir l’équilibre du budget, réduire l’inflation, renouer avec la croissance, fût-elle faible, quitte à ce que le désiquilibre des échanges extérieurs se creuse profondément. Ces sorties de … Continuer la lecture de La pauvreté en Amérique latine : y-a-t-il une issue équitable ? →
Restructuration productives et changements dans la division sexuelle du travail et de l’emploi Argentine, Brésil, Mexique, par Rodlan Martha
Introduction L’évolution récente de l’économie des pays semiindustrialisés d’Amérique latine conduit souvent à des diagnostics hâtifs. La reprise de la croissance du PIB (après une décennie perdue) est souvent présentée comme la preuve que les politiques néo-libérales ont réussi à faire émerger un nouveau régime d’accumulation stable. Les restructurations productives permettraient ainsi aux grands pays … Continuer la lecture de Restructuration productives et changements dans la division sexuelle du travail et de l’emploi Argentine, Brésil, Mexique →
L’impact de l’ALENA sur les travailleurs : quelques théses, par Alvarez Béjar Alejandro
L’arrière-fond macro-économique 1. Depuis une décennie[[Ces thèses ont été présentées par l’auteur dans une table ronde sur l’ALENA et le travail à Sacramento (Californie) en septembre 1993., le gouvernement mexicain poursuit une politique économique impopulaire, sous le signe de la « stabilisation » et de la « modernisation », en prétendant que des mesures d’austérité … Continuer la lecture de L’impact de l’ALENA sur les travailleurs : quelques théses →
L'actualité politique .
Une révolution démocratique au Brésil, par Lula (Luis Ignacio da Silva)
Pendant le régime militaire, le général Médici, un des dictateurs de service, a eu un accès de sincérité en déclarant : “l’économie va bien mais le peuple va mal”. Il parcourait alors le Nord-Est brésilien où se concentrent des signes impressionnants de misère et avait été surpris par le spectacle de pauvreté qu’il avait devant … Continuer la lecture de Une révolution démocratique au Brésil →
Ou va le Mexique?, par Cardenas Cuauhtemoc
Le cri de révolte du Chiapas[[Cauhtemoc Cárdenas est le porte-parole de l’Alliance démocratique nationale, qui regroupe l’essentiel des forces de gauche et d’extrême gauche ainsi que de nombreux syndicats et associations de quartiers. C’est à ce titre qu’il est candidat aux élections présidentielles qui se dérouleront en août 1994. – Cet article a été publié … Continuer la lecture de Ou va le Mexique? →
Le Mexique , entre Zapata et la tentation autoritaire, par Gomez Luis E.
Deux événements ont profondément marqué la vie politique mexicaine de ces derniers mois : le soulèvement néo-zapatiste dans l’État de Chiapas et l’assassinat inattendu de Luis-Donaldo Colosio, dauphin du président sortant Carlos Salinas et candidat officiel à la succession. Que signifient ces événements et quelles issues politiques permettront d’éviter que les contradictions de la société … Continuer la lecture de Le Mexique , entre Zapata et la tentation autoritaire →
Le forum de Sao-Paulo, par Löwy Michael
En 1924, José Carlos Mariátegui, le plus grand penseur marxiste latino-américain – dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance – écrivait ceci, dans un article intitulé ” Le Premier Mai et le Front Unique ” : ” Former un front uni c’est avoir une action solidaire face à un problême concret, face … Continuer la lecture de Le forum de Sao-Paulo →
Lectures critiques
La science politique face aux transitions démocratiques en Amérique latine, par Cohen James
Depuis une dizaine d’années on assiste au développement d’une véritable industrie internationale d’études politiques sur les transitions démocratiques en Europe de l’Est, dans le Tiers-Monde et tout particulièrement en Amérique latine. Ces études ont parfois atteint une grande rigueur, mais à l’intérieur d’un champ défini en termes strictement politologiques. Nous examinerons ici de plus près … Continuer la lecture de La science politique face aux transitions démocratiques en Amérique latine →
Quel avenir pour la gauche latino-américaine?, par Cohen James
Le cycle révolutionnaire des années 60 en Amérique latine est arrivé à son terme, on le sait depuis quelques années déjà. Mais à l’heure de la globalisation économique et des plans d’ajustement structurel, sous quel signe et au nom de quels idéaux la gauche latino-américaine peut-elle bien renouveler sa lutte ? Dans un livre qui … Continuer la lecture de Quel avenir pour la gauche latino-américaine? →
Mouvements sociaux et nouvelles formes de subjectivité.
Mouvements sociaux et pouvoir politique : développements en Amérique latine, par Fals Borda Orlando
Plus de vingt ans[[Orlando Fals Borda est un éminent sociologue latino-américain, professeur émérite de l’université nationale de Colombie et ancien ministre de l’agriculture. L’article qui suit, écrit en 1990, est devenu un texte de référence parmi ceux qui réfléchissent sur l’évolution des mouvements sociaux en Amérique latine. Si certains détails factuels dans ce texte paraissent … Continuer la lecture de Mouvements sociaux et pouvoir politique : développements en Amérique latine →
Théses sur la vidéo-politique, par Landi Oscar
Lorsqu’enfin nous l’éteignons, après avoir pris cette décision plusieurs fois sans trouver la volonté de la concrétiser, le téléviseur entre de façon désenchantée dans le monde des objets et nous pouvons le percevoir comme un appareil de plus. Il suffit d’appuyer sur le bouton de télécommande pour que, de nouveau, il se transforme et nous … Continuer la lecture de Théses sur la vidéo-politique →
Les mouvements des femmes en Amérique latine : un questionnement exogène, par Le Doaré Hélène
Aprendi a ser mulher, sai do corredor e da sala, ganhei mundo Juntei meus pedaços e me fiz inteira Aprendi a ser plural : mulheres em movimento continuo Nosotras las mujeres siempre nos juntamos por algo, para recibir, para aprender; no hay tiempo que perder, pués ——– Les nouvelles formes d’insertion internationale, dans un double … Continuer la lecture de Les mouvements des femmes en Amérique latine : un questionnement exogène →
Politique culturelle , culture politique ( une expérience de gouvernement dans la ville de Sao-Paulo, par Chaui Marilena
Le défi Entre 1989 et 1992, dans la ville de São Paulo, le Parti des Travailleurs a été à la tête du gouvernement municipal qui a vu, pour la première fois dans les cinq siècles d’existence du Brésil, un parti de gauche avec de solides origines populaires au pouvoir. Le défi imposé par les conditions … Continuer la lecture de Politique culturelle , culture politique ( une expérience de gouvernement dans la ville de Sao-Paulo →
Présentation.
L’Amérique latine sous le signe de l’exclusion, par Cohen James
Les transformations profondes dont l’Amérique latine est à l’heure actuelle le laboratoire sont aux antipodes de celles imaginées par la gauche il y a 20 ans. La tendance dominante est celle du néo-libéralisme, avec sa logique sociale perverse : d’une part, l’intégration des classes dominantes dans l’élite du système mondial et d’autre part l’exclusion sociale … Continuer la lecture de L’Amérique latine sous le signe de l’exclusion →
Quelles transitions à la démocratie ?
Au delà des transitions à la démocratie en Amérique latine, par Cavarozzi Marcelo
Au-delà des transitions à la démocratie en Amérique latine Les transitions à la démocratie : convergences et voies divergentes En 1982, le ministre mexicain des finances, Jesús Silva Herzog, est arrivé aux États-Unis pour annoncer que son pays Wavait plus continuer à rembourser sa dette extérieure. La déclaration de Silva Herzog fut rapidement suivie de … Continuer la lecture de Au delà des transitions à la démocratie en Amérique latine →
Le Mexique néo-libéral : globalisation autoritaire avec transition à la démocratie?, par Zermeno Sergio
Nous tenterons ici de répondre à ce qui apparaît comme le paradoxe le plus frappant de la société mexicaine, et d’une certaine manière de toute l’Amérique latine en cette fin de millénaire : a) d’une part la tendance vers un renforcement de certains traits propres aux régimes démocratiques : la renaissance du jeu des partis, … Continuer la lecture de Le Mexique néo-libéral : globalisation autoritaire avec transition à la démocratie? →
Colonialité du pouvoir et démocratie en Amérique latine, par Quijano Anibal
Tutti i cittadini erano eguali di fronte a la legge, ma non tutti erano cittadini nella Cacania di Robert Musil. Ana Maria Merlo: ” Allez enfants, paria di Francia”. Il Manifesto, Rome, 14 mai 1993. La citoyenneté en question Dans les sociétés appelées modernes, la citoyenneté est une institution de la sphère politique du pouvoir. … Continuer la lecture de Colonialité du pouvoir et démocratie en Amérique latine →
Démocratie et citoyenneté en Amérique latine, par Cammack Paul
Démocratie latino-américaine et théorie empirique Il est à la fois curieux et éclairant de constater que l’épanouissement de la démocratie en Amérique latine et ailleurs dans les années 80 a coïncidé avec l’échec patent des efforts béhavioristes pour forger les bases d’une compréhension scientifique de la politique en général et de la démocratie en particulier. … Continuer la lecture de Démocratie et citoyenneté en Amérique latine →
Démocratie , libéralisme et socialisme “rénové” au Chili, par Cohen James
En octobre 1988 les électeurs chiliens ont voté « non » à 54 % au référendum organisé par le général. Pinochet. Le dictateur leur demandait de se prononcer sur sa proposition de rester en place pendant huit années supplémentaires. Cette victoire inattendue de l’opposition a créé une dynamique entraînant Pinochet à négocier, bien malgré lui, … Continuer la lecture de Démocratie , libéralisme et socialisme “rénové” au Chili →
Septembre 1994: École de la régulation et critique de la raison économique
Numéro coordonné par Carlo Vercellone et Farida Sébaï
L’école de la régulation face à de nouveaux problémes, par Negri Toni
L’école de la régulation ne fait-elle pas désormais partie d’un passé révolu ? Le modèle de relations sociales sur lequel est fondée son analyse n’est-il pas définitivement dépassé, y compris dans les nouvelles moutures proposées par un certain nombre d’auteurs de cette école, et n’est-il pas responsable de l’enterrement de l’approche régulationniste ? L’ATR ne … Continuer la lecture de L’école de la régulation face à de nouveaux problémes →
Régulation : “operaismo ” et subjectivités antagonistes, par Cocco Giuseppe
1. Introduction L’essor de l’école française de la régulation, dans la deuxième moitié des années 1970, constitue une sorte d’extension disciplinaire des courants de pensée qui ont participé au renouveau du marxisme et à la relance de la théorie de l’antagonisme, dans l’Europe du deuxième après-guerre. Les premiers travaux des jeunes économistes de la régulation … Continuer la lecture de Régulation : “operaismo ” et subjectivités antagonistes →
La rigidité de la division du travail à la baisse : la leçon théorique des migrations internationales, par Moulier Boutang Yann
L’absence de prise en compte des migrations internationales et de la mobilité du travail en général dans le programme de travail et dans l’édifice, par ailleurs assez articulé et bien illustré empiriquement par l’étude des trajectoires nationales, de la théorie de la régulation est frappante. La thèse de J.P. de Gaudemar[[J.P. de Gaudemar , Mobilité … Continuer la lecture de La rigidité de la division du travail à la baisse : la leçon théorique des migrations internationales →
Régulation et ” compromis fordiste”, par Cours-Saliés Pierre
Les mondes éloquents ont été perdus. René Char, Le marteau sans maître. Place, formes et dynamique des luttes sociales font problème dans les analyses, proposées par l’ «Ecole de la régulation», de la phase d’expansion après 1945. Il ne s’agit pas d’opposer un historicisme du mouvement ouvrier à des concepts synthétisant une époque et un … Continuer la lecture de Régulation et ” compromis fordiste” →
L’école de la régulation après la crise, par Husson Michel
Ce court article avance quelques éléments d’appréciation critique quant aux apports de l’école de la régulation à la compréhension du capitalisme contemporain. Il ne s’agit donc pas ici de dresser un bilan exhaustif : notre méthode, pragmatique, consistera à revenir sur les discours normatifs tenus au début des années quatre-vingt par les principaux économistes de … Continuer la lecture de L’école de la régulation après la crise →
A propos de la régulation, par Amin Samir
I 1. Le capitalisme, comme tout système vivant, est fondé sur un ensemble de contradictions, qu’il surmonte sans cesse pour tout le temps historique de son existence, sans bien entendu les supprimer. Le façonnement des forces sociales, des mécanismes et des institutions qui lui permettent de surmonter quelques-unes de ses contradictions, constitue dans un lieu … Continuer la lecture de A propos de la régulation →
Aglietta in England : Bob Jessop’s contribution to the regulation approach, par Bonefeld Werner
1. Introduction The main contribution to the Regulation Approach (RA) in the UK has come from B. Jessop[[There is no distinctive British regulation school. in Britain, the only theoretical contribution to the RA has come from Bob Jessop. A popularisation of post-fordist ideas could be found in the pages of Marxism Today (see the collection … Continuer la lecture de Aglietta in England : Bob Jessop’s contribution to the regulation approach →
Werner in Wunderland or notes on a marxism beyond pessimism and false optimism, par Hay Colin
The claim that Marxist theory is in crisis is not a particularly new or original one (Althusser, 1978 ; Callinicos, 1982 ; McCarney, 1990 ; Poulantzas, 1967). Indeed, it might well be argued that, like the question of the relationship between structure and struggle, it is a perennial theme within Marxist theory (cf. Bonefeld, 1993). … Continuer la lecture de Werner in Wunderland or notes on a marxism beyond pessimism and false optimism →
Pour une reprise de la critique de l’économie politique, par Vincent Jean-Marie
Il y a quatre ans à peine, lors de l’effondrement des “régimes socialistes réels” d’Europe de l’Est, beaucoup se sont précipités pour décréter le triomphe définitif du capitalisme comme mode d’organisation économique et sociale. Aujourd’hui, on vit toutefois des lendemains qui déchantent: le nouvel ordre mondial promis par George Bush se révèle n’être qu’un nouveau … Continuer la lecture de Pour une reprise de la critique de l’économie politique →
L’approche en termes de régulation: richesse et difficultés, par Vercellone Carlo
Pour une analyse critique des rapports entre économie, histoire et transformation sociale Cet article[[ La rédaction définitive de cet article doit beaucoup à la lecture attentive de Monsieur Denis Berger que je tiens à remercier vivement. . est, en quelque sorte, une présentation’ générale de ce numéro de Futur Antérieur consacré à l’approche en termes … Continuer la lecture de L’approche en termes de régulation: richesse et difficultés →
De “Régulation des crises du capitalisme” à la ” Violence de la monnaie” et au delà, par Aglietta Michel
Entretien réalisé par Toni Negri , Fadela. SebaÏ, Carlo Vercellone. 1 La formation de l’ATR F.T. Quelles ont été les principales insatisfactions théoriques et politiques qui ont été à la base de votre premier ouvrage sur les Etats-Unis, et plus en général, de la formation de l’école de la régulation ? M.A. Les premiers travaux … Continuer la lecture de De “Régulation des crises du capitalisme” à la ” Violence de la monnaie” et au delà →
De l’approche de la régulation à l’écologie: une mise en perspective historique, par Lipietz Alain
Entretien réalisé par Giuseppe Cocco, Fadela Sebaï, Carlo Vercellone. F.A. On te propose tout d’abord d’essayer de retracer la conjoncture économique et théorique dans laquelle va naître l’école de la régulation, mais à partir d’un élément qui n’est pas toujours suffisamment explicité. Quel était le programme politique, voire la conception de la transformation sociale, qui … Continuer la lecture de De l’approche de la régulation à l’écologie: une mise en perspective historique →
La théorie de la régulation Origines , spécificités et perspectives, par Coriat Benjamin
Avertissement Le texte qu’on va lire prend fondamentalement appui sur celui d’une conférence prononcée à Nagoya en 1986, à l’invitation de chercheurs japonais qui avaient souhaité entendre une présentation de l’école française dite de la Théorie de la Régulation. C’est dire que la communication prononcée alors est fortement déterminée. D’abord parce que, à l’époque, l’ATR … Continuer la lecture de La théorie de la régulation Origines , spécificités et perspectives →
A l'entour de la régulation. Débats et controverses.
Régulation : “operaismo ” et subjectivités antagonistes, par Cocco Giuseppe
1. Introduction L’essor de l’école française de la régulation, dans la deuxième moitié des années 1970, constitue une sorte d’extension disciplinaire des courants de pensée qui ont participé au renouveau du marxisme et à la relance de la théorie de l’antagonisme, dans l’Europe du deuxième après-guerre. Les premiers travaux des jeunes économistes de la régulation … Continuer la lecture de Régulation : “operaismo ” et subjectivités antagonistes →
La rigidité de la division du travail à la baisse : la leçon théorique des migrations internationales, par Moulier Boutang Yann
L’absence de prise en compte des migrations internationales et de la mobilité du travail en général dans le programme de travail et dans l’édifice, par ailleurs assez articulé et bien illustré empiriquement par l’étude des trajectoires nationales, de la théorie de la régulation est frappante. La thèse de J.P. de Gaudemar[[J.P. de Gaudemar , Mobilité … Continuer la lecture de La rigidité de la division du travail à la baisse : la leçon théorique des migrations internationales →
Régulation et ” compromis fordiste”, par Cours-Saliés Pierre
Les mondes éloquents ont été perdus. René Char, Le marteau sans maître. Place, formes et dynamique des luttes sociales font problème dans les analyses, proposées par l’ «Ecole de la régulation», de la phase d’expansion après 1945. Il ne s’agit pas d’opposer un historicisme du mouvement ouvrier à des concepts synthétisant une époque et un … Continuer la lecture de Régulation et ” compromis fordiste” →
L’école de la régulation après la crise, par Husson Michel
Ce court article avance quelques éléments d’appréciation critique quant aux apports de l’école de la régulation à la compréhension du capitalisme contemporain. Il ne s’agit donc pas ici de dresser un bilan exhaustif : notre méthode, pragmatique, consistera à revenir sur les discours normatifs tenus au début des années quatre-vingt par les principaux économistes de … Continuer la lecture de L’école de la régulation après la crise →
A propos de la régulation, par Amin Samir
I 1. Le capitalisme, comme tout système vivant, est fondé sur un ensemble de contradictions, qu’il surmonte sans cesse pour tout le temps historique de son existence, sans bien entendu les supprimer. Le façonnement des forces sociales, des mécanismes et des institutions qui lui permettent de surmonter quelques-unes de ses contradictions, constitue dans un lieu … Continuer la lecture de A propos de la régulation →
Introduction
L’approche en termes de régulation: richesse et difficultés, par Vercellone Carlo
Pour une analyse critique des rapports entre économie, histoire et transformation sociale Cet article[[ La rédaction définitive de cet article doit beaucoup à la lecture attentive de Monsieur Denis Berger que je tiens à remercier vivement. . est, en quelque sorte, une présentation’ générale de ce numéro de Futur Antérieur consacré à l’approche en termes … Continuer la lecture de L’approche en termes de régulation: richesse et difficultés →
La régulation par ses auteurs
De “Régulation des crises du capitalisme” à la ” Violence de la monnaie” et au delà, par Aglietta Michel
Entretien réalisé par Toni Negri , Fadela. SebaÏ, Carlo Vercellone. 1 La formation de l’ATR F.T. Quelles ont été les principales insatisfactions théoriques et politiques qui ont été à la base de votre premier ouvrage sur les Etats-Unis, et plus en général, de la formation de l’école de la régulation ? M.A. Les premiers travaux … Continuer la lecture de De “Régulation des crises du capitalisme” à la ” Violence de la monnaie” et au delà →
De l’approche de la régulation à l’écologie: une mise en perspective historique, par Lipietz Alain
Entretien réalisé par Giuseppe Cocco, Fadela Sebaï, Carlo Vercellone. F.A. On te propose tout d’abord d’essayer de retracer la conjoncture économique et théorique dans laquelle va naître l’école de la régulation, mais à partir d’un élément qui n’est pas toujours suffisamment explicité. Quel était le programme politique, voire la conception de la transformation sociale, qui … Continuer la lecture de De l’approche de la régulation à l’écologie: une mise en perspective historique →
La théorie de la régulation Origines , spécificités et perspectives, par Coriat Benjamin
Avertissement Le texte qu’on va lire prend fondamentalement appui sur celui d’une conférence prononcée à Nagoya en 1986, à l’invitation de chercheurs japonais qui avaient souhaité entendre une présentation de l’école française dite de la Théorie de la Régulation. C’est dire que la communication prononcée alors est fortement déterminée. D’abord parce que, à l’époque, l’ATR … Continuer la lecture de La théorie de la régulation Origines , spécificités et perspectives →
Postfaces
L’école de la régulation face à de nouveaux problémes, par Negri Toni
L’école de la régulation ne fait-elle pas désormais partie d’un passé révolu ? Le modèle de relations sociales sur lequel est fondée son analyse n’est-il pas définitivement dépassé, y compris dans les nouvelles moutures proposées par un certain nombre d’auteurs de cette école, et n’est-il pas responsable de l’enterrement de l’approche régulationniste ? L’ATR ne … Continuer la lecture de L’école de la régulation face à de nouveaux problémes →
Pour une reprise de la critique de l’économie politique, par Vincent Jean-Marie
Il y a quatre ans à peine, lors de l’effondrement des “régimes socialistes réels” d’Europe de l’Est, beaucoup se sont précipités pour décréter le triomphe définitif du capitalisme comme mode d’organisation économique et sociale. Aujourd’hui, on vit toutefois des lendemains qui déchantent: le nouvel ordre mondial promis par George Bush se révèle n’être qu’un nouveau … Continuer la lecture de Pour une reprise de la critique de l’économie politique →
Une polémique anglo-saxonne
Aglietta in England : Bob Jessop’s contribution to the regulation approach, par Bonefeld Werner
1. Introduction The main contribution to the Regulation Approach (RA) in the UK has come from B. Jessop[[There is no distinctive British regulation school. in Britain, the only theoretical contribution to the RA has come from Bob Jessop. A popularisation of post-fordist ideas could be found in the pages of Marxism Today (see the collection … Continuer la lecture de Aglietta in England : Bob Jessop’s contribution to the regulation approach →
Werner in Wunderland or notes on a marxism beyond pessimism and false optimism, par Hay Colin
The claim that Marxist theory is in crisis is not a particularly new or original one (Althusser, 1978 ; Callinicos, 1982 ; McCarney, 1990 ; Poulantzas, 1967). Indeed, it might well be argued that, like the question of the relationship between structure and struggle, it is a perennial theme within Marxist theory (cf. Bonefeld, 1993). … Continuer la lecture de Werner in Wunderland or notes on a marxism beyond pessimism and false optimism →
Septembre 1994: Les coordinations de travailleurs dans la confrontation sociale
Les coordinations dans les luttes sociales; l’émergence d’un modèle original de mobilisation?, par Denis Jean-Michel
Depuis[[Cet article est tiré d’un travail plus complet, réalisé dans le cadre d’une étude doctorale. Les différents points abordés ici ne seront donc qu’effleurés. les grèves étudiantes de l’hiver 1986, les coordinations n’ont jamais cessé d’être au premier plan de l’actualité sociale et économique en France. Si l’on peut dire qu’elle est un produit des … Continuer la lecture de Les coordinations dans les luttes sociales; l’émergence d’un modèle original de mobilisation? →
Art , travail, salaire : la coordination des intermittents du spectacle à Lyon, par Figuière Laurent
Entretien réalisé par Maurizio Lazzarato- Est-ce que tu peux faire un court historique de la coordination ? – On s’est constitué sur un truc tout bête. Il y a eu un problème Assedic il y a deux ans qui était lié à une interprétation très laxiste de règles d’indemnisation par l’Assedic de Lyon qui a … Continuer la lecture de Art , travail, salaire : la coordination des intermittents du spectacle à Lyon →
Vers un statut d’intermittent de la recherche, par Nicolas-le Strat Pascal
S’il y a un fait marquant à relever dans le champ de la recherche en sciences sociales, c’est bien l’émergence d’une force de travail intermittente. Alors que, de tradition, l’activité de recherche dans ce secteur s’exerçait dans le cadre d’une salarisation stable, à plein temps et avec une garantie d’emploi (fonctionnaire ou contractuel de la … Continuer la lecture de Vers un statut d’intermittent de la recherche →
Vers de nouvelles formes de coopération dans le travail, par Rozenblatt Patrick
Au détour d’une page de ses “Mémoires imparfaites”, Pierre Naville, alors prisonnier, se souvient du “Penser, c’est perdre le fil” de Paul Valéry et le commente : C’était intrigant… Je n’y voyais goutte… comme l’auteur, peut-être. Aujourd’hui, j’y vois ceci : le fil des idées, le lien logique, tombe toujours dans la routine, tombe dans … Continuer la lecture de Vers de nouvelles formes de coopération dans le travail →
Les coordinations : production de subjectivités ou nouvelles institutions?, par Pellegrin -Rescia Marie-Louise.
Si une réaction, plutôt pessimiste, a clos le Séminaire sur les coordinations – organisateurs et public paraissant en effet déçus par le travail effectué -, je voudrais montrer que la déception ressentie est en relation avec notre façon à nous d’entendre les coordinations et non pas avec ce qui a été dit par leurs représentants. … Continuer la lecture de Les coordinations : production de subjectivités ou nouvelles institutions? →
La lutte des assistantes sociales : un mouvement de femmes salariées conjugué au masculin, par Josette Trat
Le 16 septembre 1991, débutait la plus longue grève qu’ait connue la profession des assistant(e)s de service social. Neuf semaines plus tard, le 15 novembre 1991, les assistantes sociales (AS) d’Île-de-France, décidaient de reprendre le travail sans avoir obtenu satisfaction sur leurs revendications essentielles, résumées par trois mots d’ordre : homologation du diplôme d’Etat (DEASS) … Continuer la lecture de La lutte des assistantes sociales : un mouvement de femmes salariées conjugué au masculin →
La coordination rurale, par Manguy Yves
Elle a vu le jour fin 91, quelques semaines après la grande manif de la FNSEA à Paris. Elle est née dans le sud de la France, dans le département du Gers. Pour bien saisir les raisons de son rapide succès, il est important de situer le contexte historique qui a permis la naissance de … Continuer la lecture de La coordination rurale →
Problèmes de représentation(s) des paysans et du salariat, par Veauvy Christiane
La coordination rurale est aujourd’hui l’une des coordinations les moins bien connues. Ceci ne provient pas seulement de la date de sa création, relativement récente (1991, département du Gers)[[La coordination des instituteurs, par exemple, était en place dès 1986 (B. Geay, 1991)., mais aussi des conditions de son analyse : étant indissociable de celle des … Continuer la lecture de Problèmes de représentation(s) des paysans et du salariat →
De l’agriculture dont on ne parle pas, par Georges Edel
Le discours médiatique sur l’agriculture est le discours des acteurs dominants de cette composante de notre économie deux secteurs sont confondus sous la même appellation d’agriculture, le secteur agricole proprement dit et le secteur agro-alimentaire qui, même s’il est administrativement classé dans “agriculture”, est en réalité une industrie avec ses impératifs propres. Cette industrie agro-alimentaire … Continuer la lecture de De l’agriculture dont on ne parle pas →
A propos de la coordination étudiante ou l’émergence d’un sujet virtuel, par Denis Jean-Michel
Patrick : Comment situer l’émergence des coordinations dans le milieu de la jeunesse à la fin des années quatre-vingt par rapport aux luttes sociales des années soixante-dix, notamment aux luttes qui avaient valorisé l’auto-organisation des travailleurs ? Bruno : Il y a d’abord un problème de situation sémantique car le terme coordination a, dans le … Continuer la lecture de A propos de la coordination étudiante ou l’émergence d’un sujet virtuel →
La coordination infirmière : un lieu critique, par Le Doaré Hélène
Il est des moments, dans la vie de chacun, qui, même s’ils ont un caractère trivial, étroitement quotidien et une temporalité ramassée sont comme des fulgurances qui illuminent des mécanismes fondamentaux de comportement de soi, des autres. Sur un plan collectif, l’on peut dire que, d’une certaine façon, la Coordination Infirmière a joué ce rôle … Continuer la lecture de La coordination infirmière : un lieu critique →
De la jubilation à la déreliction, l’utilisation du minitel dans les luttes infirmières (-) Note de travail, par Kergoat Daniéle
JE VIENS DE RÉALISER QUE AVEC CE SUPER OUTIL ON VA POUVOIR CONTINUER A DISCUTER ENSEMBLE. ON PARLAIT L’AUTRE JOUR EN AG DE FAIRE DES COMMISSIONS DE RÉFLEXION SUR LE STATUT, LE TRAVAIL DE NUIT …ETC… ON PEUT LES ÉCRIRE LADESSUS ET EN DISCUTER A DISTANCE C’EST GENIAL… FAUDRAIT DIRE A ALTER – JE SAIS … Continuer la lecture de De la jubilation à la déreliction, l’utilisation du minitel dans les luttes infirmières (-) Note de travail →
Les coordinations : une proposition de communisme, par Negri Toni
Je crois qu’au cours du séminaire de l’Université européenne de la recherche où ont été présentées (en 1992-1993) certaines des interventions qui apparaissent dans ce supplément de Futur Antérieur, deux idées essentielles ont été étudiées avec beaucoup d’attention et développées avec insistance. La première consiste à saisir dans la forme de l’organisation des coordinations (c’est-à-dire … Continuer la lecture de Les coordinations : une proposition de communisme →
Lip précurseur des coordinations ?, par Lantz Pierre
Le souvenir du mouvement Lip de 1973 est si vif que l’on est amené à y voir la préfiguration des coordinations dans les conflits sociaux du travail qui émergent à partir de la fin 1986. Pour Rozenblatt “la quête” des Lip “tend à concrétiser l’utopie d’un contrôle ouvrier sur la production (…) ; ils tentent … Continuer la lecture de Lip précurseur des coordinations ? →
La bataille de Longwy, par Nioriel Gérard
Décembre 1978. Le gouvernement Barre rend public son plan de “sauvetage” de la sidérurgie. Bilan: 21 000 postes de travail doivent être supprimés en moins de deux ans ; deux sites sont pratiquement condamnés à mort: Denain et Longwy. Dans la cité lorraine, les 6500 suppressions d’emplois prévues signifient la disparition d’un sidérurgiste sur deux … Continuer la lecture de La bataille de Longwy →
Le problème de la centralité dans l’animation d’un conflit: l’exemple du conflit de la sidérurgie de, par Zarifian Philippe
Je voudrais, dans cet article, défendre une thèse. Cette thèse est que tout conflit d’une certaine ampleur est placé devant un problème de centralité. J’entends par centralité la construction et la mise en oeuvre immédiate, dans la temporalité particulièrement serrée d’une lutte sociale, d’un point de vue d’ensemble sur les enjeux du conflit et la … Continuer la lecture de Le problème de la centralité dans l’animation d’un conflit: l’exemple du conflit de la sidérurgie de →
L’émergence d’une forme unifiant le social et le politique, par Rozenblatt Patrick
Il en est des coordinations comme de toutes les formes sociales, les analyses qui peuvent être produites à partir de leur étude sont susceptibles de diffuser, au-delà de certains éléments de convergences, des thèses diverses voire contradictoires qui traduisent les regards particuliers, toujours teintés d’idéologie ou d’engagement partisan, des acteurs ou des chercheurs qui les … Continuer la lecture de L’émergence d’une forme unifiant le social et le politique →
Introduction
L’émergence d’une forme unifiant le social et le politique, par Rozenblatt Patrick
Il en est des coordinations comme de toutes les formes sociales, les analyses qui peuvent être produites à partir de leur étude sont susceptibles de diffuser, au-delà de certains éléments de convergences, des thèses diverses voire contradictoires qui traduisent les regards particuliers, toujours teintés d’idéologie ou d’engagement partisan, des acteurs ou des chercheurs qui les … Continuer la lecture de L’émergence d’une forme unifiant le social et le politique →
Les coordination et le monde rural.
La coordination rurale, par Manguy Yves
Elle a vu le jour fin 91, quelques semaines après la grande manif de la FNSEA à Paris. Elle est née dans le sud de la France, dans le département du Gers. Pour bien saisir les raisons de son rapide succès, il est important de situer le contexte historique qui a permis la naissance de … Continuer la lecture de La coordination rurale →
Problèmes de représentation(s) des paysans et du salariat, par Veauvy Christiane
La coordination rurale est aujourd’hui l’une des coordinations les moins bien connues. Ceci ne provient pas seulement de la date de sa création, relativement récente (1991, département du Gers)[[La coordination des instituteurs, par exemple, était en place dès 1986 (B. Geay, 1991)., mais aussi des conditions de son analyse : étant indissociable de celle des … Continuer la lecture de Problèmes de représentation(s) des paysans et du salariat →
De l’agriculture dont on ne parle pas, par Georges Edel
Le discours médiatique sur l’agriculture est le discours des acteurs dominants de cette composante de notre économie deux secteurs sont confondus sous la même appellation d’agriculture, le secteur agricole proprement dit et le secteur agro-alimentaire qui, même s’il est administrativement classé dans “agriculture”, est en réalité une industrie avec ses impératifs propres. Cette industrie agro-alimentaire … Continuer la lecture de De l’agriculture dont on ne parle pas →
Les coordinations au féminin.
La lutte des assistantes sociales : un mouvement de femmes salariées conjugué au masculin, par Josette Trat
Le 16 septembre 1991, débutait la plus longue grève qu’ait connue la profession des assistant(e)s de service social. Neuf semaines plus tard, le 15 novembre 1991, les assistantes sociales (AS) d’Île-de-France, décidaient de reprendre le travail sans avoir obtenu satisfaction sur leurs revendications essentielles, résumées par trois mots d’ordre : homologation du diplôme d’Etat (DEASS) … Continuer la lecture de La lutte des assistantes sociales : un mouvement de femmes salariées conjugué au masculin →
La coordination infirmière : un lieu critique, par Le Doaré Hélène
Il est des moments, dans la vie de chacun, qui, même s’ils ont un caractère trivial, étroitement quotidien et une temporalité ramassée sont comme des fulgurances qui illuminent des mécanismes fondamentaux de comportement de soi, des autres. Sur un plan collectif, l’on peut dire que, d’une certaine façon, la Coordination Infirmière a joué ce rôle … Continuer la lecture de La coordination infirmière : un lieu critique →
De la jubilation à la déreliction, l’utilisation du minitel dans les luttes infirmières (-) Note de travail, par Kergoat Daniéle
JE VIENS DE RÉALISER QUE AVEC CE SUPER OUTIL ON VA POUVOIR CONTINUER A DISCUTER ENSEMBLE. ON PARLAIT L’AUTRE JOUR EN AG DE FAIRE DES COMMISSIONS DE RÉFLEXION SUR LE STATUT, LE TRAVAIL DE NUIT …ETC… ON PEUT LES ÉCRIRE LADESSUS ET EN DISCUTER A DISTANCE C’EST GENIAL… FAUDRAIT DIRE A ALTER – JE SAIS … Continuer la lecture de De la jubilation à la déreliction, l’utilisation du minitel dans les luttes infirmières (-) Note de travail →
Les racines des coordinations.
Les coordinations : une proposition de communisme, par Negri Toni
Je crois qu’au cours du séminaire de l’Université européenne de la recherche où ont été présentées (en 1992-1993) certaines des interventions qui apparaissent dans ce supplément de Futur Antérieur, deux idées essentielles ont été étudiées avec beaucoup d’attention et développées avec insistance. La première consiste à saisir dans la forme de l’organisation des coordinations (c’est-à-dire … Continuer la lecture de Les coordinations : une proposition de communisme →
Lip précurseur des coordinations ?, par Lantz Pierre
Le souvenir du mouvement Lip de 1973 est si vif que l’on est amené à y voir la préfiguration des coordinations dans les conflits sociaux du travail qui émergent à partir de la fin 1986. Pour Rozenblatt “la quête” des Lip “tend à concrétiser l’utopie d’un contrôle ouvrier sur la production (…) ; ils tentent … Continuer la lecture de Lip précurseur des coordinations ? →
La bataille de Longwy, par Nioriel Gérard
Décembre 1978. Le gouvernement Barre rend public son plan de “sauvetage” de la sidérurgie. Bilan: 21 000 postes de travail doivent être supprimés en moins de deux ans ; deux sites sont pratiquement condamnés à mort: Denain et Longwy. Dans la cité lorraine, les 6500 suppressions d’emplois prévues signifient la disparition d’un sidérurgiste sur deux … Continuer la lecture de La bataille de Longwy →
Le problème de la centralité dans l’animation d’un conflit: l’exemple du conflit de la sidérurgie de, par Zarifian Philippe
Je voudrais, dans cet article, défendre une thèse. Cette thèse est que tout conflit d’une certaine ampleur est placé devant un problème de centralité. J’entends par centralité la construction et la mise en oeuvre immédiate, dans la temporalité particulièrement serrée d’une lutte sociale, d’un point de vue d’ensemble sur les enjeux du conflit et la … Continuer la lecture de Le problème de la centralité dans l’animation d’un conflit: l’exemple du conflit de la sidérurgie de →
Naissance d'un sujet collectif virtuel.
Art , travail, salaire : la coordination des intermittents du spectacle à Lyon, par Figuière Laurent
Entretien réalisé par Maurizio Lazzarato- Est-ce que tu peux faire un court historique de la coordination ? – On s’est constitué sur un truc tout bête. Il y a eu un problème Assedic il y a deux ans qui était lié à une interprétation très laxiste de règles d’indemnisation par l’Assedic de Lyon qui a … Continuer la lecture de Art , travail, salaire : la coordination des intermittents du spectacle à Lyon →
Vers un statut d’intermittent de la recherche, par Nicolas-le Strat Pascal
S’il y a un fait marquant à relever dans le champ de la recherche en sciences sociales, c’est bien l’émergence d’une force de travail intermittente. Alors que, de tradition, l’activité de recherche dans ce secteur s’exerçait dans le cadre d’une salarisation stable, à plein temps et avec une garantie d’emploi (fonctionnaire ou contractuel de la … Continuer la lecture de Vers un statut d’intermittent de la recherche →
A propos de la coordination étudiante ou l’émergence d’un sujet virtuel, par Denis Jean-Michel
Patrick : Comment situer l’émergence des coordinations dans le milieu de la jeunesse à la fin des années quatre-vingt par rapport aux luttes sociales des années soixante-dix, notamment aux luttes qui avaient valorisé l’auto-organisation des travailleurs ? Bruno : Il y a d’abord un problème de situation sémantique car le terme coordination a, dans le … Continuer la lecture de A propos de la coordination étudiante ou l’émergence d’un sujet virtuel →
Regards croisés
Les coordinations dans les luttes sociales; l’émergence d’un modèle original de mobilisation?, par Denis Jean-Michel
Depuis[[Cet article est tiré d’un travail plus complet, réalisé dans le cadre d’une étude doctorale. Les différents points abordés ici ne seront donc qu’effleurés. les grèves étudiantes de l’hiver 1986, les coordinations n’ont jamais cessé d’être au premier plan de l’actualité sociale et économique en France. Si l’on peut dire qu’elle est un produit des … Continuer la lecture de Les coordinations dans les luttes sociales; l’émergence d’un modèle original de mobilisation? →
Vers de nouvelles formes de coopération dans le travail, par Rozenblatt Patrick
Au détour d’une page de ses “Mémoires imparfaites”, Pierre Naville, alors prisonnier, se souvient du “Penser, c’est perdre le fil” de Paul Valéry et le commente : C’était intrigant… Je n’y voyais goutte… comme l’auteur, peut-être. Aujourd’hui, j’y vois ceci : le fil des idées, le lien logique, tombe toujours dans la routine, tombe dans … Continuer la lecture de Vers de nouvelles formes de coopération dans le travail →
Les coordinations : production de subjectivités ou nouvelles institutions?, par Pellegrin -Rescia Marie-Louise.
Si une réaction, plutôt pessimiste, a clos le Séminaire sur les coordinations – organisateurs et public paraissant en effet déçus par le travail effectué -, je voudrais montrer que la déception ressentie est en relation avec notre façon à nous d’entendre les coordinations et non pas avec ce qui a été dit par leurs représentants. … Continuer la lecture de Les coordinations : production de subjectivités ou nouvelles institutions? →